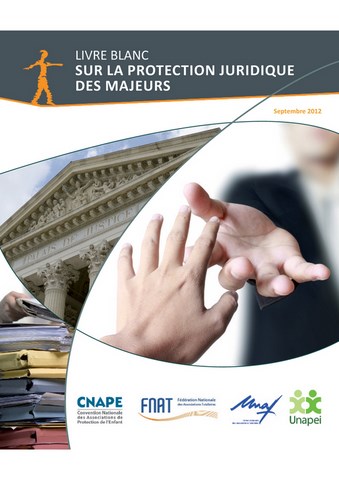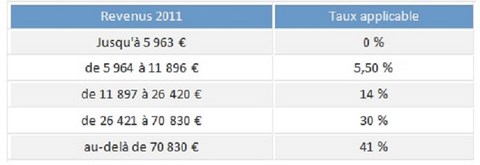Soyez vigilant sur les locaux vacant!

Soyez vigilant sur les locaux vacants ! Champ d'application territorial étendu
Une taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, dans les communes dont la liste est fixée par décret.
Elle est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l'emphytéote qui dispose du logement.
Le périmètre de cette taxe est étendu aux communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants (contre 200 000 actuellement) où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant.
La liste des communes où cette taxe est applicable vient d'être fixée par décret. Ce texte entre en application à compter du 13 mai 2013.
Dès lors, certains majeurs protégés propriétaire de locaux vacants dans ces communes vont être assujettis à cette taxe.
Source : Revue Fiduciaire
Décret 2013-392 du 10 mai 2013, JO du 12, p. 7959
Allocation aide pour parent dépendant
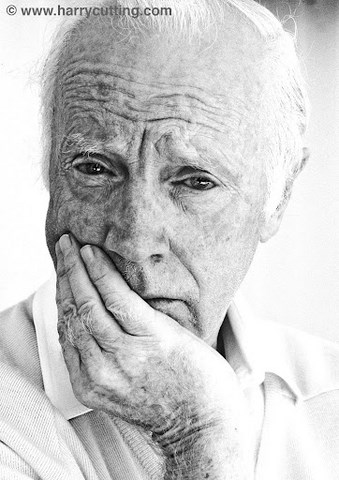
L'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie est imposable
L'Administration fiscale vient de préciser que les allocations journalières d'accompagnement d'une personne en fin de vie, versées à un salarié qui suspend ou réduit son activité professionnelle pour rester aux côtés d'un proche, sont imposables.
Destinées à compenser la perte de salaire, ces allocations journalières constituent un revenu de remplacement et sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que le salaire qu'elles remplacent.
Source : intérêts privés. / BOI-RSA-CHAMP-20-30-20-20130416
Application du droit du partage
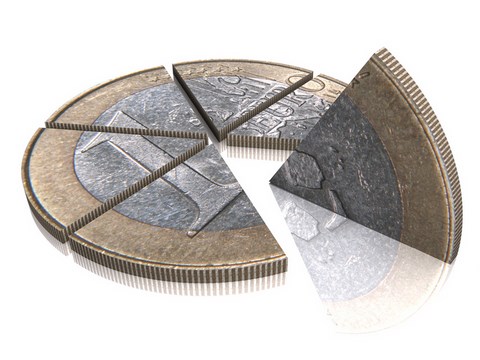
Conditions d'application du droit de partage : Précisions
Il résulte de ces dispositions fiscales quatre conditions cumulatives à l'exigibilité du droit de partage :
- l'existence d'un acte,
- l'existence d'une indivision entre les copartageants,
- la justification de l'indivision
- et l'existence d'une véritable opération de partage, c'est-à-dire transformant le droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot.
Par conséquent, en l'absence d'acte, un partage verbal n'est pas soumis au droit de partage.
Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d'un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n'est pas soumis au droit de partage.
Source : Réponse ministérielle à la question n°9548 parue au joan du 22/01/13
C'est d'actualité: justificatifs et IRPP

Déclaration des revenus : précisions sur les pièces justificatives à fournir
A compter de la déclaration des revenus effectuée cette année (déclaration des revenus de 2012), le contribuable n'est plus tenu de joindre toutes les pièces justificatives à sa déclaration de revenus papier, cette dispense existant déjà pour la déclaration en ligne.
Il doit toutefois les conserver afin d'être en mesure de les communiquer à l'administration si celle-ci le demande.
L'administration fiscale vient de rappeler que les pièces justificatives que le contribuable est dispensé de joindre à sa déclaration s'entendent des seuls documents établis par des tiers, à savoir les documents qui ne sont établis ni par l'usager ni par la direction générale des finances publiques.
Ces pièces justificatives sont notamment les factures, les reçus de dons ou de cotisations syndicales, l'imprimé fiscal unique.
La dispense ne s'applique donc pas aux documents établis par le contribuable lui-même, qui complètent, précisent ou explicitent les éléments portés sur la déclaration.
Ainsi, doivent notamment continuer à être joints à la déclaration les renseignements sur papier libre, les mentions expresses, l'état détaillé des frais réels ou les engagements qui doivent être pris par le contribuable pour bénéficier d'un avantage fiscal.
Source : Patrimoine.com
Concession funéraire et héritage

Transmission des concessions funéraires
Selon la Cour de cassation, les concessions funéraires sont hors du commerce ce qui signifie qu'elles ne peuvent faire l'objet d'une cession à titre onéreux.
En revanche, elles peuvent faire l'objet d'une donation entre vifs si l'acte administratif accordant la concession et le règlement municipal ne l'interdisent pas. Dans ce cas, s'agissant d'un droit réel immobilier, l'acte de donation doit être établi devant notaire en application de l'article 931 du code civil.
La concession peut également être transmise par voie de succession. En l'absence de dispositions testamentaires, la concession funéraire est transmise lors du décès du concessionnaire originaire aux descendants du fondateur ou à leur conjoint, ce qui crée, en cas de pluralité de descendants, une indivision perpétuelle entre les héritiers.
L'un des cohéritiers peut renoncer à ses droits sur la concession.
Une telle renonciation doit être reçue par acte notarié non pour sa validité mais pour son efficacité, l'authenticité étant requise dans un but de publicité s'agissant des actes portant mutation de droits réels immobiliers (article 28-1°-a du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière).
Source : Réponse ministérielle à la question n°°00588 parue au JO de Sénat du 25/04/13
Société: le majeur protégé et le surendettement

Surendettement du majeur protégé
Une cour d'appel peut confirmer la décision du juge d'homologuer les recommandations de la commission de surendettement subordonnant le bénéfice des mesures de redressement à la vente, par la débitrice placée sous curatelle, de son logement et à la liquidation de ses comptes d'épargne lui permettant de régler les deux tiers de son passif mais doit, dans son arrêt déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes en application de l'article L. 332-3 du code de la consommation.
Les faits :
Une personne placée en curatelle a saisi la commission de surendettement, laquelle a recommandé un certain nombre de mesures : remboursement du Crédit Foncier pendant 12 mois, sans régler les autres créanciers, vendre le bien immobilier lui appartenant et liquider la totalité du portefeuille titre.
Toutefois, ne pouvant se résoudre à quitter son domicile, la débitrice assistée de son curateur saisit le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'annulation de la recommandation de la commission de surendettement.
La procédure :
La cour d'appel constate qu'elle possède un patrimoine permettant de régler les 2/3 du passif et approuve les 1ers juges pour avoir homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement (CA Aix, 20 janvier 2011, RG n°09/22430).
La cour de cassation quant à elle suit l'appréciation souveraine des juges du fond.
Commentaire :
Le logement du majeur protégé bénéficie d'une protection renforcée. Si bien que le maintien de son cadre de vie habituel constitue une priorité consacrée par le législateur lui-même (article 426 du code civil).
Dès lors, tout acte visant à vendre le logement du majeur nécessite l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille.
Cet arrêt affirme que le principe de préservation du logement cède lorsque le majeur est surendetté. Le droit du surendettement l'emporte sur celui des majeurs protégés. L'intérêt du majeur protégé cède devant celui des créanciers.
Source : AJ Famille. Dalloz.
http://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2013/04/11-25.462.pdf
Expulsion d'un locataire et respect de la procédure
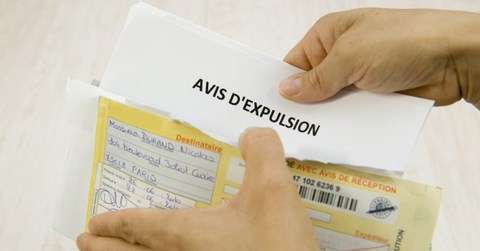
L'huissier doit rechercher la nouvelle adresse du locataire parti
Les faits :
Une locataire a été condamné a réglé l'arriéré de loyers dans un certain délai. Ce qu'elle n'a pas fait. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26 avril 2007 ec qui a eu pour conséquence que la locataire ait effectué le règlement de la dette.
Néanmoins, les nouveaux acquéreurs ont demandé l'expulsion de la locataire. Un procès-verbal lui a été signifié et l'expulsion réalisée. Cependant, la locataire avait une nouvelle adresse.
La locataire demande l'annulation de la procédure car la signification ne lui a pas été faite.
La procédure :
Les juges du fond indiquaient que le locataire n'apportait pas la preuve d'avoir communiqué sa nouvelle adresse et que la signification faite à son ancienne adresse était valable.
La Cour de Cassation censure ce raisonnement en indiquant :
"Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à justifier l'absence de toute diligence de l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
Voir l'arrêt : http://www.juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20130110-1123151
Source : Juricaf
Indemnisation dans le cas de victime mineure

CIVI : l'acceptation de l'offre d'indemnisation en cas de victime mineure doit être soumise à l'autorisation du juge aux affaires familiales
"Quelle est la nature du constat d'accord prévu par l'article 706-5-1 du Code de procédure pénale et un tel constat d'accord, lorsqu'il concerne un mineur, oblige-t-il ou non les représentants légaux de l'enfant à le soumettre à l'autorisation du juge des tutelles ?"
Telle était la question soumise par le tribunal de grande instance de Paris à l'avis de la Cour de cassation.
Selon la haute juridiction, hors le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d'un mineur ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction, doivent recueillir l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, préalablement à l'acceptation de l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle emporte pour le mineur renonciation à un droit.
Source : Jurisclasseur. Cass., avis, 25 mars 2013, n° 15007
Fiscalité: pensez au paiement différé ou fractionné!

Fiscalité des donations ou successions: Pensez au paiement différé ou fractionné !
Le principe :
L'impôt sur la succession ou une donation doit être payé comptant. Toutefois, il est possible de demander à l'Administration fiscale un délai de paiement et de bénéficier ainsi d'un fractionnement dudit règlement ou de son différé.
Cette demande de crédit faite au Fisc est encore plus intéressante cette année en raison du taux d'intérêt légal particulièrement bas : seulement 0,04% !
Le crédit accordé cette année est donc gratuit.
Cas dans lesquels le régime du paiement fractionné ou différé a vocation à s'appliquer :
Report du paiement pour l'héritier nu-propriétaire.
L'impôt sera exigible à l'issue d'un délai de six mois à compter de la cession totale ou partielle de la nue-propriété, ou bien de sa réunion avec l'usufruit.
Etalement des droits.
La seconde hypothèse est relative à l'application seule du fractionnement des droits. Ce régime s'applique à toutes les mutations par décès.
Le nombre de versements dépendra du pourcentage que représentent les droits par rapport au montant taxable.
Ces versements s'échelonneront sur une période maximale de cinq ans.
Cependant, ce délai est porté de cinq à dix ans et le nombre de versement est doublé lorsque l'actif est composé au minimum pour moitié de biens non liquides tels que des immeubles, des parts d'intérêts dans des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, des droits d'auteur, des fonds de commerce ou des valeurs mobilières non cotées.
Cumul du différé et du fractionné.
Les droits de donation ou de succession peuvent être différés pendant cinq ans puis fractionnés pendant dix ans lorsque les mutations portent sur les parts sociales ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, non cotée en Bourse, à condition que le bénéficiaire reçoive au moins 5 % du capital social de la société concernée et que des garanties soient constituées au profit du Trésor.
Source : Agefi.Actifs
Tutelle ou curatelle: le majeur protégé peut-il choisir son lieu de vie?

Tutelle ou curatelle : le majeur protégé peut-il choisir son lieu de vie ?
Qu'elle soit sous tutelle, ou sous curatelle la personne protégée est toujours libre de choisir son lieu de résidence et d'en changer (Cour d'Appel de DOUAI, 8 février 2013).
I - RAPPEL DES FAITS
Par jugement du 23 septembre 2010, Madame X a été placée sous curatelle renforcée par décision du juge des tutelles et l'association A a été désignée pour exercer les fonctions de curatrice.
Par requête datée du 14 février 2012, Madame X demande au juge des tutelles l'autorisation de quitter le foyer où elle réside pour s'installer dans la maison située à Z qu'elle possède en indivision avec sa mère, celle-ci étant placée désormais en EHPAD (Etablissement d' Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes).
Le docteur C, psychiatre, indique dans un certificat du 17 févier 2012 que l'état de santé de la requérante n'est pas compatible avec une orientation dans un logement individuel.
Le médecin précise que celle-ci nécessite une structure suffisamment “contenante” afin d'éviter toute déviance du comportement et une mise en danger de la patiente.
La curatrice partage l'avis médical, estimant le retour à domicile non envisageable à ce jour, mais constate que Madame X vit mal ses différences avec les autres résidents du foyer, car elle est jeune et ne peut se projeter dans un avenir à long terme dans cette résidence.
Le docteur C certifie à nouveau, le 5 septembre 2012, que l'état de santé de la requérante n'est pas compatible avec un retour en domicile individuel.
Lors de son audition par le juge des tutelles le 24 septembre 2012, Madame X confirme sa volonté de retourner vivre à domicile ; elle ne veut pas rester en maison de retraite où elle affirme n'avoir aucun contact avec les autres résidents plus âgés qu'elle.
De plus, elle estime que cela lui coûte cher. Dans sa maison, elle n'aurait pas de loyer à payer.
Si elle ne rentre pas chez elle, son fils déposera plainte.
II - DÉCISION DU JUGE DES TUTELLES
Par ordonnance du 28 septembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance a rejeté la requête en vue d'un changement de domicile présentée par Mme X.
Le juge relève les éléments suivants à l'appui de sa décision :
- les inquiétudes de l'association A,
- les 2 certificats médicaux,
- le caractère prématuré de la demande au regard de son état de santé et du processus de soin et de l'accompagnement vers l'autonomie,
- la nécessité pour Madame X de démontrer son aptitude à l'autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
III - RECOURS FORMÉ CONTRE LA DÉCISION DU JUGE DES TUTELLES
Madame X a fait appel de la décision du juge des tutelles (par lettre RAR) et soutient :
- quelle ne veut plus vivre dans la maison de retraite où ne résident que des personnes beaucoup plus âgées qu'elle ;
- qu'elle y est très seule et ne s'estime pas plus en sécurité là que chez elle.
Le représentant de l'association A demande la confirmation de l'ordonnance qui rejette la demande de retour à domicile, faisant valoir les éléments des 2 certificats médicaux.
IV - MOTIFS DE LA DECISION DE LA COUR D'APPEL
L'article 459-2 du code civil dispose que "La personne protégée choisit le lieu de sa résidence. Elle entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non. Elle a le droit d'être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci. En cas de difficulté, le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué statue.”
Cet article consacre expressément le principe du libre choix par la personne protégée de son lieu de résidence, ce qui implique également la liberté d'en changer. Il ne peut être porté atteinte à ce principe que par le juge, saisi en cas de “difficulté”.
Or, force est de constater qu'en l'espèce, la personne protégée a saisi le juge des tutelles d'une requête aux fins d'être autorisée à quitter son lieu d'hébergement actuel pour s'installer dans la maison qu'elle possède en indivision avec sa mère située à Z.
Préalablement à cette saisine, aucune difficulté n'a été constatée ni par l'association curatrice, ni par un tiers, ni par le juge, la requérante étant totalement valide, disposant d'un logement personnel vacant et peu coûteux et étant en mesure d'expliciter avec discernement les raisons de son choix de vouloir vivre ailleurs qu'en maison de retraite.
Le curateur lors des débats devant la cour, et le médecin dans le contenu des 2 certificats rédigés par lui, font en réalité prévaloir un principe de précaution, considérant que le risque d'une “rechute” de Madame X serait limité du fait de sa résidence “dans une structure contenante”.
Une telle approche, si elle peut paraître légitime de la part du curateur et du médecin au regard du passé récent de Madame X, ne permet pas, en l'absence de toute difficulté effectivement constatée et avérée, de porter atteinte au droit de la personne protégée de choisir son lieu de vie, sauf à instaurer un régime d'autorisation préalable du juge dans toute situation de retour à domicile présentant un risque potentiel pour la santé de la personne protégée ; or, tel n'est ni l'esprit, ni la lettre de la loi.
Au surplus, en l'espèce, Madame X est placée en curatelle renforcée, régime qui, s'agissant de la protection de la personne, n'implique en principe qu'une simple assistance dans les actes personnels, et suppose que la personne dispose du discernement suffisant pour poser et assumer ses choix personnels.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire n'y avoir lieu à autorisation, Madame X pouvant, en l'état, librement choisir son lieu de résidence et en changer.
EN CONCLUSION
La Cour d'appel pose le principe selon lequel :
- il n'y a pas lieu à soumettre à autorisation préalable le choix de son lieu de résidence par la personne protégée, ni à autoriser ou non celle-ci à quitter le foyer logement à où elle réside actuellement,
- rappelle que la personne protégée est, en l'état, libre de choisir son lieu de résidence et d'en changer.
Cette décision a le mérite de rappeler clairement que la liberté de choisir le lieu de sa résidence est un droit fondamental, peu importe que la personne soit sous protection juridique ou non.
En conséquence, le placement d'une personne sous curatelle ou tutelle ne lui retire nullement sa liberté de choisir le lieu de sa résidence.
Sources : Me CANINI, Avocat. Arrêt de la Cour d'appel de Douai du 8 février 2013 - N° RG : 12/06650
Retraites : Nouvelle taxe depuis le 1er avril 2012
Retraite : la nouvelle taxe entre en vigueur le 1er avril 2013 !
Instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) s'appliquera sur les pensions de retraite à partir du 1er avril. Cette taxe de 0,3% doit générer 350 millions d'euros en 2013 et 700 millions d'euros en 2014 pour financer la dépendance des personnes âgées.
> Quelles sont les pensions concernées ?
Cette contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA) est due sur les pensions de retraite versées par tous les régimes de retraite obligatoires – régimes de base et complémentaires – du privé comme du public ; ainsi que sur les pensions d'invalidité.
Toutefois, certaines pensions sont exonérées : l'allocation de solidarité aux personnes âgées (APSA), l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), le minimum vieillesse, l'allocation veuvage et certaines pensions militaires.
> Existe-t-il d'autres exonérations ?
Une exonération est prévue en faveur des personnes qui n'ont pas payé l'impôt sur le revenu en 2012 ; soit parce que compte tenu du niveau de leurs revenus le montant de leur impôt était nul ; soit parce que leur impôt n'a pas été mis en recouvrement car il était inférieur au seuil de recouvrement de 61 euros.
Concrètement, si la personne est d'ores et déjà redevable taux réduit de la CSG de 3,8 %, elle n'aura pas à payer cette nouvelle contribution.
> A combien s'élève-t-elle ?
Au taux de 0,3%, la nouvelle contribution est calculée sur le montant brut de vos pensions, hors majoration pour tierce personne.
Elle vient s'ajouter à la CSG au taux de 6,6% et à la CRDS de 0,5 %.
Au total, ce sont donc 7,4 % qui seront désormais prélevés directement par les caisses de retraite sur le montant des pensions.
Les dates de dépôt des déclarations IR
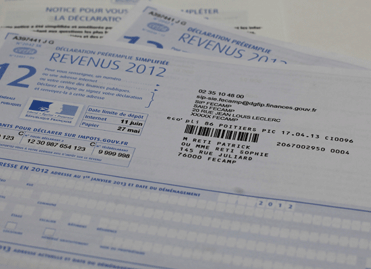
Dates limites de dépôt des déclarations IR
Les délais accordés aux contribuables pour déposer leur déclaration de revenus 2012 (formulaires 2042 et annexes) sous forme papier est fixée au lundi 27 mai 2013.
Pour les déclarations par internet, les délais sont les suivants :
- lundi 3 juin 2013 pour les départements 01 à 19;
- vendredi 7 juin 2013 pour les départements 20 à 49 ;
- mardi 11 juin 2013 pour les départements 50 à 974.
Ces délais concernent aussi les contribuables qui doivent déclarer les renseignements relatifs à l'ISF sur leur déclaration de revenus.
Cette année, sont concernées les personnes dont le patrimoine net taxable au 1er janvier 2013 est supérieur à 1,3 M€ et inférieur à 2 570 000 €.
Pour plus de détail sur les dates d'envois des déclarations notamment voir également fiscalonline.com
Voir ci-dessous le tableau récapitulatif.
Source : Fiscalonline.

Assurance décès et majeur protégé

Seule l'assurance décès au sens strict reste interdite à la souscription
Les deux premiers alinéas de l'article L. 132-3 du Code des assurances disposent qu' « il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle ».
Un député interroge le ministère de la justice car certains juges des tutelles refuseraient, selon lui, de valider un contrat d'assurance décès sur la tête d'une personne protégée, alors que le dernier alinéa de cet article indique que « ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes ».
La chancellerie répond que l'interdiction formulée au premier alinéa de cet article « ne concerne que l'assurance « en cas de décès » prise au sens strict ». En revanche, le dernier alinéa de l'article L. 132-3 autorise la souscription de contrats d'assurance « en cas de vie » comprenant une clause de « contre-assurance », par laquelle l'assureur s'engage, en cas de décès de l'assuré avant l'échéance du contrat, à rembourser au bénéficiaire désigné ou aux ayants droit les sommes versées pour alimenter le contrat. En effet, il s'agit ici de favoriser la constitution d'un capital au bénéfice des personnes protégées, puisque le « risque » assuré est la survie de la personne vulnérable ».
Rép.Min.n°6911, JO AN 05 mars 2013
http://recherche.assemblee-nationale.fr/questions/out/S10/ZN0FKBFMTUZ3RZ66BIP.pdf
Source : Agefi Actifs
Retraites : Création d'une contribution de solidarité

Retraites : Création d'une contribution additionnelle de solidarité
L'article 17 de la loi de Financement de la sécurité sociale pour 2013, crée une contribution additionnelle sur les pensions de retraite et d'invalidité au profit de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
Il s'agit de faire participer les retraités au financement de la politique de prise en charge de la dépendance, laquelle est jusqu'à présent financée uniquement par les salariés et par les revenus du capital.
Cette réforme s'applique aux pensions et allocations servies à compter du 1er avril 2013, au taux de 0,3 %.
Toutefois, sont exonérés :
- les personnes dont les revenus sont modestes et notamment celles qui perçoivent le minimum vieillesse.
La réforme limite l'assiette de la contribution additionnelle sur les retraites, aux retraités qui sont assujettis à la CSG au taux de 6,6 %, à l'exclusion de ceux qui bénéficient du taux réduit de 3,8 % (c'est-à-dire ceux dont la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année précédente est inférieure à 61 € et qui sont assujettis à la taxe d'habitation) ;
- les titulaires de pensions de retraite ou d'invalidité non redevables de la CSG et de la CRDS ;
- les retraités non assujettis à la taxe d'habitation, c'est-à-dire, pour une personne seule vivant en France métropolitaine, celle percevant un revenu fiscal de référence inférieur à 10 024 € par an (ou 11.861 € en Martinique, Guadeloupe et la Réunion, et 12 402 € en Guyane).
Source : Club Patrimoine
Convention Abripargne, Atelier n°2

L'aide sociale et la gestion patrimoniale : la politique de récupération
Intervenants :
Mr. HILD / Jiminy Conseil
Mr. RHLIOUCH / Fapès Diffusion
Mme LEMASSON / IRTS Montpellier
Mme MOISDON-CHATAIGNER / Maître de conférences
Une personne handicapée peut, lorsque ses ressources sont insuffisantes, bénéficier d'une aide pour le maintien à domicile ou le placement dans un établissement ou chez un particulier, dans la mesure où elle présente un certain taux d'incapacité reconnu par la CDAPH ou est dans l'impossibilité de se procurer un emploi en milieu ordinaire compte tenu de son handicap.
Cela relève de la solidarité de la collectivité envers ses plus faibles. Néanmoins, dans certains cas, il ne s'agit que d'une avance : les sommes versées sont récupérables.
Jusqu'en 2005, la politique des récupérations n'était pas uniforme sur tout le territoire, entrainant une inégalité de traitement.
La loi de 2005 a revu les cas de récupération pour les personnes handicapées.
Il est temps de faire une synthèse globale de la politique de récupération des départements en fonction des différents types d'aide sociale et de lister les solutions patrimoniales pour concilier les intérêts de la personne et ne pas contrevenir à cette législation.
Frais d'obsèque: quelle prise en charge par la CNAV?

Frais d'obsèques : quelle prise en charge par la Cnav ?
Une circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) en date du 25 janvier 2013 précise dans quelle mesure les frais d'obsèques peuvent être pris en charge par la Cnav.
Au décès d'un assuré, toute personne, si elle en fait la demande auprès de la Cnav, a la possibilité d'obtenir le remboursement d'une partie des frais d'obsèques acquittés.
Ce remboursement est proposé dans la limite d'une somme de 2 286,74 euros prélevée sur les sommes dues au décès des titulaires de pensions de vieillesse.
Pour en bénéficier, il suffit de présenter la facture des frais d'obsèques et l'acte de décès, la qualité d'héritier ou d'ayant droit n'est pas nécessaire. Ainsi, par exemple, un héritier ayant renoncé à la succession peut tout à fait bénéficier de ce remboursement.
À noter : l'acte de décès est établi par la commune où le défunt est décédé ou par celle où il résidait.
Source : service.public.fr
Statut des employés en ESAT

Les handicapés qui travaillent dans un ESAT ne sont pas des salariés
Les personnes accueillies en raison de leur handicap dans les établissements ou services d'aides par le travail – ESAT – (ex-CAT) ne bénéficient pas du statut de salarié soumis au code du travail.
Elles n'ont donc pas de contrat de travail avec ledit établissement.
A fortiori, elles ne peuvent pas faire l'objet d'un licenciement.
source : Revue Fiduciaire
Voir l’arrêt de la chambre sociale de la cour de Cassation du 06.02.2013
Convention Abripargne, Atelier n°1

le mandat de protection future :quelles perspectives pour les intervenants tutélaires ?
Intervenants :
Me Olivia MINETTI
Maîtres MORIN et VOISIN MONCHO
Me Valentine CLEMENT (animatrice)
Maître Winckler-Azoulay
Le mandat de protection future constituait l'innovation juridique majeure de la loi de 2007 réformant les tutelles.
Dans une réponse ministérielle du 20 novembre 2012, le ministère de la justice rapporte le nombre de mandats mis en œuvre – c'est-à-dire déclenchés pour cause de vulnérabilité du mandant - depuis l'entrée en vigueur de la réforme des tutelles, soit le 1er janvier 2009.
Le nombre total s'élèverait à 1077. C'est en Ile-de-France, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur et en Rhône-Alpes qu'on en dénombre le plus.
Au début de l'année, le nombre de mandats mis en œuvre n'était que de 538.
Pourquoi si peu d'engouement pour un dispositif permettant d'organiser à l'avance sa protection ? quels sont les freins à sa mise en place ? Quelle diversification d'activité permet-il pour un intervenant tutélaire ?
Les interventions des professionnels permettront :
- de diagnostiquer les plus et les limites actuels à la conclusion d'un MDPF,
- de faire ressortir des pistes d'améliorations,
- de mettre en avant l'intérêt de le développer et de le promouvoir pour les intervenants tutélaires.
Les débats avec l'audience auront pour but également de comparer la théorie avec les réalités de la pratique.
Cumul ASPA et revenue d'activité? Bientôt possible...

Adoption d'une proposition de loi autorisant le cumul de l'ASPA avec des revenus d'activité
Les sénateurs ont adopté hier une proposition de loi visant à autoriser le cumul de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) avec des revenus professionnels dans la limite de 1,2 SMIC, un cumul déjà autorisé pour les pensions de retraite et les revenus professionnels.
Selon les auteurs de ce texte, la mesure constitue "une des solutions susceptibles de réduire le taux de pauvreté".
Source : Patrimoine.com
Particulier employeur et gestion d'affaire

La gestion d'affaires permet de procéder au licenciement du salarié à la place du particulier employeur
Les faits :
Une salariée, engagée en qualité d'auxiliaire de vie auprès d'un particulier employeur, est licenciée pour faute grave par la fille de son employeur, laquelle est nommée tutrice de son père peu de temps après le licenciement.
La salariée réclame devant les juridictions du travail la nullité de son licenciement au motif que ce dernier ne pouvait valablement être mené par une personne étrangère à la relation contractuelle.
Elle estime que la tutelle n'ayant été ordonnée que postérieurement à son licenciement, la fille de son employeur ne disposait de ce fait d'aucune légitimité pour mener celui-ci, dont la procédure, encadrée par les articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-6 et L. 7221-1, est d'ordre public et n'admet à ce titre aucune dérogation.
La procédure :
La cour d'appel (CA Paris, 21 juin 2011, n° 09/08873 : JurisData n° 2011-015122) puis la Cour de cassation ne donnent pas droit à ses demandes pour les raisons suivantes :
1 - L'employeur était, avant même le début de la tutelle, "dans l'incapacité de s'occuper de ses affaires en raison de la dégradation de son état de santé" ;
2 - La fille de l'employeur était "l'interlocutrice habituelle" de la salariée ;
3 - "Le caractère conservatoire pour les intérêts de l'employeur de la mesure de licenciement prononcé pour faute grave" était constitué par "une atteinte à son patrimoine".
La Cour de cassation considère que les conditions de la gestion d'affaires sont caractérisées, et que le licenciement est régulier.
Source: Cass. soc., 29 janv. 2013, n° 11-23.267 : JurisData n° 2013-001078
Convention Abripargne, Atelier n°9

Le Portail de la Justice : Avancées, nouvelles pratiques ».
Intervenants :
Mr CALMEL / CSWIN Directeur Technique
Mr CHEVAL / Tutelle au quotidien
Mr GATTI / Directeur Logiciel Uni-T
Mr De Montgolfier / Mjpm Privé
Le Portail de la justice est un moyen internet de communication entre les personnes chargées de la protection des majeurs et les greffiers et magistrats des tribunaux d'instance.
Il a pour objectif de proposer aux personnes chargées de la protection des majeurs (tuteurs, curateurs familiaux, associatifs ou gérants de tutelles privé), un système de communication internet sécurisé, alternatif aux envois papiers.
L'ensemble des envois concernés ( requêtes, inventaires et comptes de gestion et leurs pièces justificatives) ont fait l'objet d'une normalisation. Celle-ci vise à favoriser la possibilité d'adresser ces contenus à tout tribunal d'instance en charge des tutelles, quelque soit sa situation géographique, tout en respectant les particularismes locaux.
Pour le moment le portail majeurs protégés est en phase d'expérimentation.
Un état des lieux peut déjà être effectué.
Quelles avancées pour les intervenants tutélaires dans leurs relations avec les tribunaux ? quels avantages en pratique dans le suivi des mesures et les décisions à prendre ? quelle est la place des éditeurs de logiciels dans cette nouvelle approche de la mesure de protection ?
Les interventions des professionnels permettront :
- De définir les avantages en pratique dans le suivi des mesures et des décisions à prendre,
- De déterminer la place des éditeurs de logiciels dans cette nouvelle approche.
Un échange avec la salle s'en suivra pour évaluer les avancées avec ce nouveau système et l'éventuel changement des pratiques dans l'avenir.
Défaut de dépôt de compte de gestion

Absence de dépôt de compte annuel de gestion : dessaisie du représentant légal
Le tuteur qui n'établit pas les comptes de gestion peut se voir retirer la tutelle
Si le juge constate que le tuteur n'a pas établi de comptes de gestion depuis plusieurs années, il peut alors le décharger de ses fonctions et nommer à sa place un nouveau tuteur.
C'est ce que rappelle la cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 2013, dans une situation où le représentant était la sœur de la majeure protégée durant 12 ans.
Condition Fiscale pour le LEP
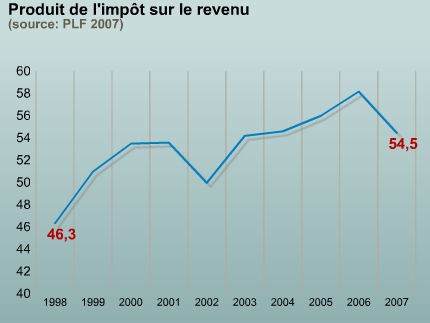
LEP : plafond d'IR inchangé en 2013
Le montant d'imposition à ne pas dépasser pour l'obtention ou la conservation d'un livret d'épargne populaire (LEP) est maintenu à 769 € en 2013.
En conséquence, les personnes qui ont été redevables en 2012 d'un impôt sur le revenu inférieur à cette limite peuvent obtenir en 2013 soit l'ouverture d'un LEP, soit la prolongation de leur livret si elles en possèdent déjà un.
Le montant d'impôt à retenir est celui calculé avant imputation des divers crédits d'impôts.
Source : Patrimoine.com
Taux des livrets réglementés au 1er février 2013

Taux des livrets réglementés:
Etat des lieux au 1er Février 2013
La rémunération des différents livrets et produits bancaires réglementés est revue à intervalles réguliers dans l'année.
3 décrets ont apporté des modifications au plafond du LDD et du Livret A.
Voici donc, pour rappel, les caractéristiques des principaux produits d'épargne réglementée, au 1er Février 2013:
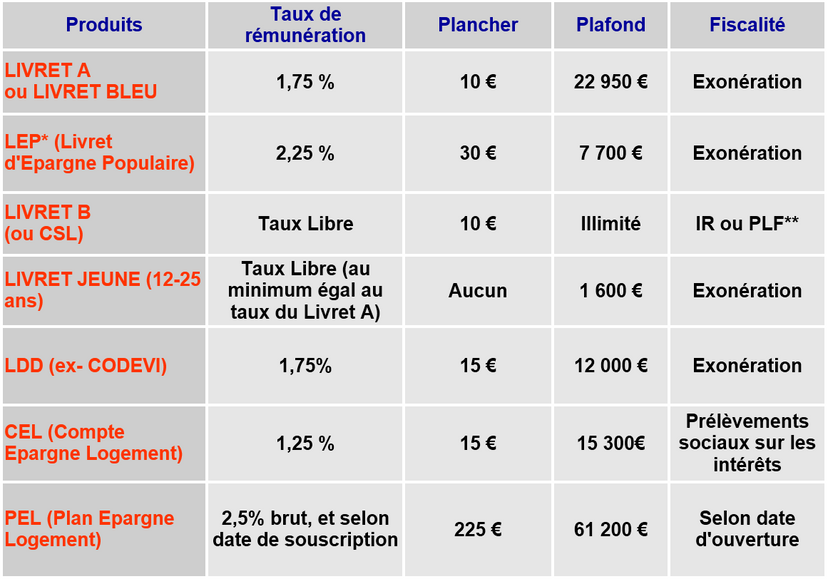
* Accessible pour les personnes payant un impôt inférieur à 769 € en 2013.
** Impôt sur le Revenu (ou Prélèvement Libératoire Forfaitaire selon les foyers)
Selon la situation particulière du majeur protégé, certains livrets sont à privilégier.
La multi-détention d'un même livret pour une personne n'étant pas conforme à la législation en vigueur, notre conseil est donc d'effectuer la vérification auprès des majeurs sous votre protection.
En cas de double détention, il conviendra de clôturer au plus vite le compte le plus récent ou le moins important.
Nouveau barème des saisie dur salaire

Barème 2013 : saisies sur salaire
Comme chaque année, les seuils permettant de calculer la fraction saisissable des rémunérations ont été revalorisés en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation.
Le nouveau barème est applicable à compter du 1er février 2013.
D'autres nouveautés, relatives notamment à l'ordre de paiement des créances, sont également à signaler.
Définition
On parle de saisie sur salaire, lorsque ce prélèvement intervient sans le consentement du débiteur, sur décision du Tribunal d'instance. La somme est alors versée au greffe du tribunal.
A l'inverse, en cas de cession sur salaire, c'est le débiteur lui-même qui accepte de céder à son créancier une partie de son salaire. Dans ce cas, il doit déclarer sa décision au Tribunal d'instance.
Les montants 2013
Seule une partie déterminée du salaire du débiteur peut être saisie.
Le montant qui peut être saisi ou cédé est déterminé par un barème publié chaque année par décret.
Important ! Ce barème tient compte de la rémunération annuelle brute et est corrigé en fonction du nombre de personnes à la charge du salarié.
Le nouveau barème 2013 vient de paraître et s'applique, non pas au 1er janvier comme de coutume, mais à compter du 1er février 2013 (voir ci-après).
Saisie et cession sur salaire : nouveautés 2013
Outre le nouveau barème fixant la fraction de salaire saisissable, certaines nouveautés sont entrées en vigueur cette année concernant les saisies et cessions sur salaire :
1°) - La principale concerne l'ordre de paiement en cas de créanciers multiples. Depuis le 1er janvier 2013, les créanciers ayant la plus faible créance sont en effet privilégiés en cas de pluralité de saisie. Ils sont ainsi payés prioritairement dès lors que leur créance n'excède pas 500 euros.
2°) - Autre nouveauté : le juge, pour déterminer le montant des retenues sur salaire, peut désormais s'adresser aux organismes sociaux et fiscaux pour obtenir des informations sur la rémunération du salarié et la composition de sa famille.
Décret n° 2013-44 du 14 janvier 2013 révisant le barème des saisies et cessions des rémunérations, Jo du 16
Décret n° 2012-1401 du 13 décembre 2012 pris pour l'application de l'article L. 3252-8 du code du travail, Jo du 15
Source : Edition Tissot
Juin 2013 à NICE: La 1ere convention pour les MJPM, 40 intervenants de renom

Il s'agit de la 1ère Convention Nationale sur la protection des biens de la personne vulnérable. Elle est organisée à l'initiative de Jacques Delestre, JD Consultant, expert et formateur des mandataires judiciaires auprès des Majeurs Protégés.
Cette convention nationale a pour objectif de déterminer et de résoudre les difficultés pratiques rencontrées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Jeudi 20 et vendredi 21 juin 2013 seront deux journées de formation, organisées autour de débats participatifs et de lieux d'échanges, qui permettront de présenter des expériences, des avancées, de mettre l'accent sur les blocages mais aussi de réfléchir ensemble sur les leviers possibles, d'une façon transversale.
Voici la liste des intervenants
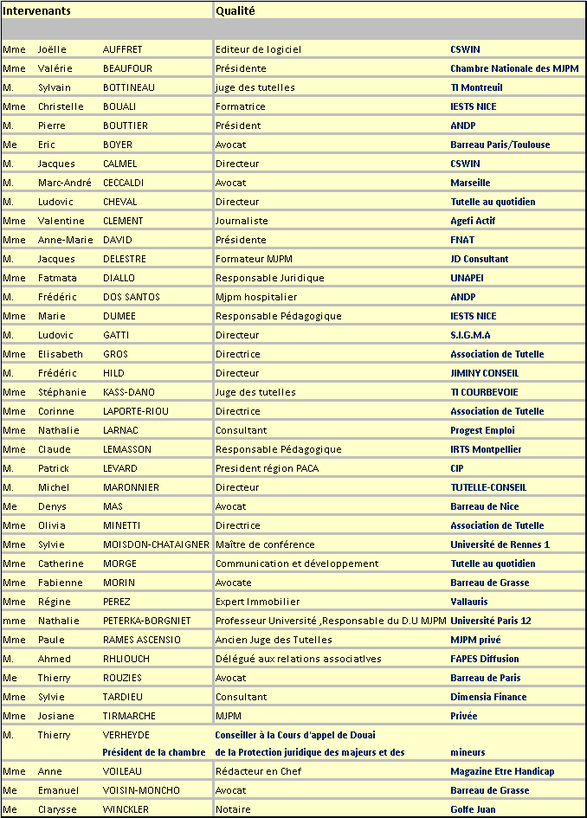
Allez sur le site, la liste est régulièrement mise à jour
Fin de la mise à jour des mesures en 2013

Curatelle et tutelle : en 2013, fin des anciennes mesures de protection !
L'une des innovations essentielles de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection des majeurs vulnérables est la nécessité pour le juge des tutelles de procéder à des révisions périodiques des mesures de protection juridique.
Le principe, posé par l'article 441 du code civil, est que le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder 5 ans.
Par conséquent, les anciennes mesures (ouvertes avant le 1er janvier 2009) devront toutes être révisées avant le 1er janvier 2014 ; à défaut elles seront caduques.
EN CONCLUSION :
L'année 2013 devrait être l'année de tous les dangers pour les juges des tutelles qui devront examiner et réviser des centaines de mesures en respectant la procédure rigoureuse instaurée par la réforme du 5 mars 2007, dont les dispositions sont interprétées restrictivement par la Cour de Cassation.
Rappelons que la volonté du législateur était de restituer aux régimes de protection des personnes majeures vulnérables leur caractère exceptionnel.
Source : Legavox
1er février: nouveau taux du livret A
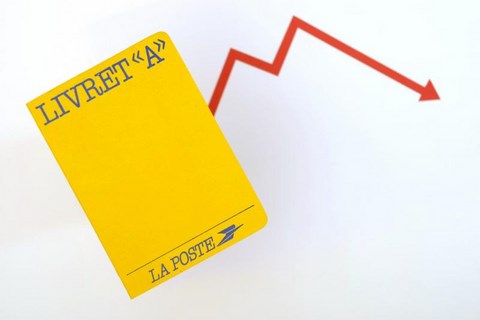
Livret A : le taux d'intérêt à 1,75%
Comme pressenti, le taux d'intérêt du livret A va baisser de 2,25% à 1,75% au 1er février 2013. Cette mesure a été annoncée mardi 15 janvier par le Ministre de l'Economie, Pierre Moscovici.
Le taux d'intérêt résulte d'une moyenne automatique opérée tous les 6 mois (au 1/02 et au 1/08) entre l'inflation et les taux d'intérêt à court terme, augmentée de 0,25 point.
Les chiffres de l'inflation estimée en décembre dernier à 1,2 % auraient dû faire baisser le taux à 1,5% en appliquant strictement la formule de calcul.
Le Ministre de l'Economie a annoncé qu'il allait suivre la recommandation de Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France, de déroger à la formule de calcul au nom de "circonstances exceptionnelles" ou de la sauvegarde du "pouvoir d'achat" des épargnants, comme l'autorisent les textes.
On attend fin janvier l'avis (ou arrêté) fixant le taux d'intérêt au 1er février.
Voir le communiqué de la Banque de France :
Source AFP/ les clés de la banque
Fin du PFL

Fiscalité des intérêts en 2013 : Le prélèvement libératoire change de nom, mais ne disparaît pas réellement pour autant !
La fiscalité des intérêts issus des placements à rendements garantis (intérêts, arrérages, revenus d'obligation, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements, comptes courants et comptes courants d'associés) évolue.
Le prélèvement libératoire ne disparaît pas pour autant !
Son nom change, l'administration fiscale utilise maintenant le terme d'acompte fiscal, mais son effet reste rigoureusement identique. Il ne s'agit plus alors d'une option liée à chaque livret épargne, que l'on activait directement auprès de chaque banque, mais d'une option globale que le contribuable choisi au moment de sa déclaration d'impôt. De ce point de vue, c'est donc plus simple.
Attention toutefois, l'option fiscale du Prélèvement Libératoire Forfaitaire ne sera plus accessible aux épargnants dont le montant total des intérêts de tous leurs placements épargne de taux (livrets épargne fiscalisés, comptes à terme, comptes rémunérés, coupons d'obligations, etc.) au cours de l'année sera supérieur à 2 000 €. Il vous faudra alors surveiller de près vos intérêts perçus afin de ne pas dépasser ce seuil ! Pour les contribuables dont la tranche marginale d'imposition est inférieure à 30 %, aucun intérêt d'opter pour le prélèvement libératoire.
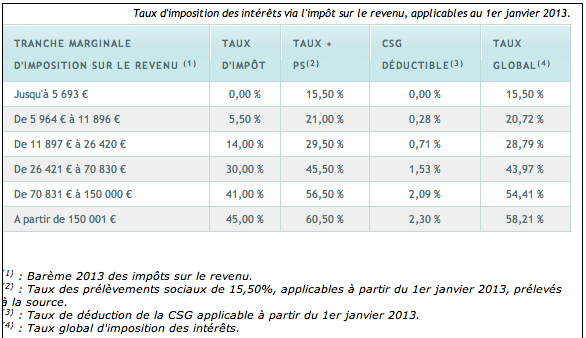
Relèvement du plafond du Livret A au 1er Janvier 2013

Hausse du montant du revenu de solidarité active
Le revenu de solidarité active (RSA) va être revalorisé de 1,75 % au 1er janvier 2013.
Le montant forfaitaire mensuel du RSA pour une personne seule sans enfant, par exemple, sera donc égal à 483,24 euros (contre 474,93 euros depuis le 1er janvier 2012).
Le montant du RSA varie en effet selon la composition et les ressources du foyer du demandeur.
Pour les personnes sans revenu d'activité, le RSA prend la forme d'un revenu minimum garanti égal à un montant forfaitaire (RSA socle).
Par contre, si le bénéficiaire du RSA et/ou son conjoint travaillent mais que les ressources du foyer sont inférieures à un niveau minimum garanti, le RSA prend la forme d'un complément de revenu (RSA chapeau ou RSA d'activité).
Le bénéfice du RSA est ouvert, sous certaines conditions, aux personnes âgées d'au moins 25 ans et aux personnes âgées de 18 à 25 ans si elles sont parents isolés ou si elles justifient d'une certaine durée d'activité professionnelle.
Voir le communiqué de la CAF :
http://www.caf.fr/sites/default/files/cnaf/Documents/DCom/Presse/Communiques_P2012/rsa2013.pdf
Source : Service-public.fr
Désignation d'un curateur et sentiments
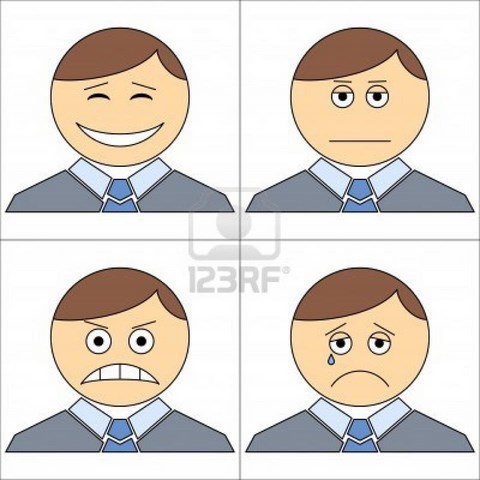
Désignation judiciaire d'un curateur: les sentiments exprimés par le majeur protégé ne peuvent être écartés sans motivation
Une majeure, placée sous curatelle renforcée avec la nomination d'un mandataire judiciaire, a formé un recours contre cette décision, préférant que sa nièce soit désignée comme curateur si cette mesure était maintenue.
La cour d'appel a rejeté sa demande, jugeant que la désignation de la nièce n'était pas opportune, en raison de la trop grande vulnérabilité de la majeure protégée (CA Agen, 13 oct. 2010).
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel sur ce point.
Au visa des articles 449 et 450 du Code civil, elle estime en effet qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser ce qui interdisait, malgré les sentiments exprimés par la majeure protégée, de confier la curatelle à sa nièce, les juges du second degré n'ont pas donné de base légale à leur décision.
Source : LexisNexis. Cass. 1re civ., 5 déc. 2012, n° 11-26.611, F P+B+I
Particulier employeur et temps de travail

CESU et temps de travail
Les particuliers employeurs CESU ont tendance à omettre qu'ils sont soumis à la plupart des règles du Code du travail.
Ainsi, en matière de durée du travail, lorsque le temps nécessaire à l'exécution des travaux dont un jardinier était chargé excède la durée prévue à son contrat, ce dernier est en droit de demander un rappel de salaire correspondant aux heures réellement accomplies. Ce d'autant que l'employeur était incapable de prouver le nombre d'heures réellement accomplies par le salarié et qu'il savait que le salarié dépassait ses horaires. Cass. soc., 17 oct. 2012, n°10-14248.
Pour voir l'arrêt :
Source : Documentissime
Relèvement du plafond du Livret A au 1er Janvier 2013

Le plafond du livret A fait l'objet d'un deuxième relèvement de 25 % à compter du 1er janvier 2013.
Une communication relative au livret A a été présentée au Conseil des ministres du 19 décembre 2012.
Le plafond du livret A bénéficie d'un deuxième relèvement de 25 % de son plafond, pour être porté à 22.950 € au 1er janvier 2013.
Cette évolution sera suivie dans les prochaines semaines d'une réforme des paramètres de l'épargne réglementée qui doit permettre de financer les organismes HLM et les collectivités locales à un coût raisonnable, tout en garantissant le pouvoir d'achat de l'épargne populaire.
Cette communication précise que le prochain ajustement du taux du livret A aura lieu le 1er février prochain.
Source : Le Monde du Droit
vers une réglementation des contrats de généalogistes
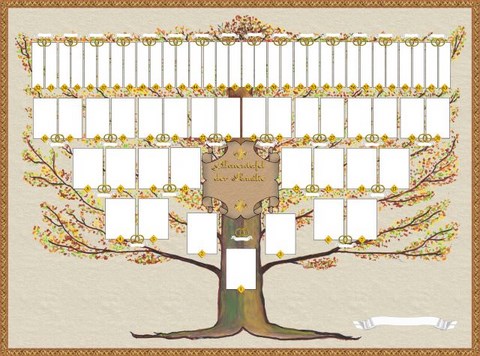
Vers une réglementation des contrats de généalogistes ?
Une proposition de loi sur la profession et la rémunération des généalogistes vient d'être déposée par un député.
Dans sa recommandation n° 96-03 du 20 septembre 1996 concernant les contrats de succession proposés par les généalogistes, la Commission des clauses abusives a relevé des clauses excessives figurant dans les contrats de révélation de succession, en particulier sur le paiement des frais de recherche. Afin de mettre un terme à de telles dérives, il est proposé de préciser que le notaire est chargé de rechercher les héritiers, qu'il peut se faire aider dans sa mission par un généalogiste agréé selon les conditions fixées par voie réglementaire, par le ministre de la Justice. La rémunération de ce dernier consiste en des honoraires versés par le notaire selon un barème fixé par voie réglementaire, ces honoraires étant déduits de l'actif successoral.
Voir la proposition : http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion0374.asp
Source : Club Patrimoine
Mariage d'un protégé et appréciation du juge

L'autorisation à mariage d'un majeur protégé relève de l'appréciation souveraine des juges du fond
Un majeur, placé sous le régime de la curatelle renforcée, a sollicité du juge des tutelles l'autorisation de se marier, conformément à l'article 460 du Code civil, aux termes duquel "le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, du juge".
Par ordonnance en date du 24 juin 2010, cette autorisation lui a été refusée.
Pour confirmer cette décision, les juges d'appel ont estimé "qu'en considération de l'évolution psychopathologique des troubles présentés par l'intéressé et de sa perte de maîtrise des réalités financières, celui-ci n'était pas en mesure de donner un consentement éclairé au mariage" (CA Paris, 6 sept. 2011).
Le majeur protégé a alors formé un pourvoi en cassation, rejeté par la Cour.
La Cour rappelle tout d'abord que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le demandeur et portant sur l'article 460 du Code civil a déjà fait l'objet d'une décision du Conseil constitutionnel. Le Conseil ayant déclaré l'article 460 du Code civil conforme à la Constitution (Cons. const., 28 juin 2012, déc. n° 2012-260 QPC : JurisData n° 2012-014296).
La Cour de cassation affirme ensuite très clairement que la décision d'autoriser le mariage d'un majeur sous curatelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, rendant ainsi inopérants les moyens critiquant les motifs retenus par les juges pour rejeter l'autorisation.
Source : Cass. 1re civ., 5 déc. 2012, n° 11-25.158, F P+B+I. LexisNexis.
APA, vers un recours sur succession
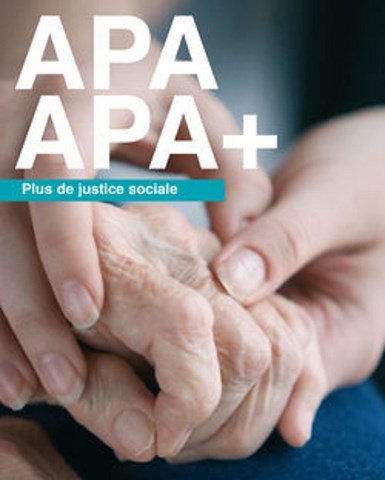
APA : Vers un recours sur succession des sommes versées ?
Le Sénat a examiné jeudi 13 décembre une proposition de loi visant à autoriser le recouvrement sur succession des sommes versées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, "sur la partie de l'actif net successoral excédant 150 000 €".
L'objectif principal affiché par les auteurs de cette proposition est de "remédier aux difficultés rencontrées par les conseils généraux et de faire contribuer ceux qui le peuvent au financement de la prise en charge de la dépendance".
Fort heureusement, cette proposition vient d'être rejetée dans l'attente de la présentation par le gouvernement d'un projet de loi sur la dépendance.
Néanmoins, la question du financement de la dépendance confrontée aux réalités économiques actuelles risque de justifier une remise en cause des avantages de l'APA.
Particulier Employeur, Hausse du smic horaire le 1er Janvier 2013

Particulier employeur : revalorisation du SMIC
Le nouveau montant du SMIC applicable à compter du 1er janvier 2013 vient d'être officialisé.
Le SMIC est revalorisé de 0,3 %, ce qui porte le taux horaire du SMIC à 9,43 euros bruts.
Le SMIC mensuel pour 35 h est de 1.430,22 euros bruts.
Si votre majeur protégé est particulier employeur, n'oubliez pas d'appliquer cette augmentation à son ou ses salariés à compter du 01.01.2013.
Source : Editions Tissot
Procuration et succession

LE TITULAIRE D'UNE PROCURATION DOIT JUSTIFIER DES DEPENSES POUR LE DEFUNT
Lorsqu'une personne âgée décède, le conjoint peut se trouver désemparé et incapable de gérer les problèmes de la vie quotidienne.
Généralement, un ou plusieurs de ses enfants, obtiennent procuration pour s'occuper des questions administratives, mais aussi parfois pour gérer les comptes bancaires et les achats de tous les jours.
Le mandant (le père) donne alors à un de ses enfants (le mandataire), le pouvoir de faire un ou des actes juridiques en son nom.
Cette gestion doit être effectuée dans l'intérêt unique du bénéficiaire, de façon raisonnée, mais aussi de manière sérieuse.
Ce mandat ne sera pas anodin puisque lors du règlement de la succession, cet héritier devra rendre compte à ses cohéritiers de l'utilisation des fonds qu'il a pu retirer. La charge de la preuve pèsera sur lui.
Le 7 novembre 2012, la Cour de cassation a considéré qu'il incombe au bénéficiaire d'un mandat, ayant procuration sur les comptes bancaire de son père, de rendre compte de l'utilisation des fonds retirés à la banque.
Cela peut se faire notamment au moyen d'un simple cahier décrivant, par exemple, semaine par semaine (date), le montant des sommes retirées à la banque (en euros) et leur emploi (ex : courses alimentaires, achat de vêtements, coiffeur, etc.), avec tickets de caisse ou factures à l'appui.
A défaut, les sommes dont l'emploi n'est pas justifié, déduction faite des dépenses estimées pour les besoins du défunt, doivent être rapportées à la succession et déduites de la part de succession qui lui revient.
Source : Club Patrimoine
Délaissement de personne vulnérable
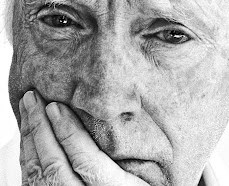
Délaissement de personne vulnérable : un acte positif exprimant une volonté définitive d'abandon
Dans un arrêt du 9 octobre 2012, la Cour de cassation rappelle que le délit de délaissement de personne vulnérable suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime.
L'article 223-3 du Code pénal incrimine le fait de délaisser, en un lieu quelconque, une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. Ce délit est classé parmi les infractions de mise en danger de la personne.
La chambre criminelle rappelle dans sa décision du 9 octobre 2012 les contours de ses éléments constitutifs.
Les faits :
Un individu avait été condamné du chef de délaissement de personne hors d'état de se protéger caractérisé, selon les juges du fond, par une série de manquements commis au préjudice de sa mère. Il avait tout d'abord et par deux fois, congédié les infirmiers chargés de soigner les plaies de sa mère grabataire sans mettre en place les protections minimales du lit, lui occasionnant ainsi des blessures. Refusant ensuite l'aide d'une auxiliaire de vie malgré la prescription du médecin et laissant sa mère macérer pendant plusieurs semaines dans ses excréments, il avait finalement, en dernière extrémité, sollicité son médecin traitant qui, devant l'état d'inconscience de la patiente, l'avait faite hospitaliser.
L'analyse de la Cour de Cassation :
En ce qui concerne l'élément matériel de l'infraction :
La Cour rappelle que le délaissement résulte d'un acte positif. En effet, la Cour rappelle constamment la nécessité d'un acte positif dans la réalisation du délit, excluant toute attitude simplement négative ou passive.
Elle décide ainsi que le fait de ne pas venir chercher des personnes vulnérables (en l'espèce, des enfants), qui, à la suite d'un malentendu entre leurs parents, se retrouvent seuls sur le port d'Ajaccio et doivent être placés provisoirement, ne rentre pas dans les prévisions de l'article 223-3 du code pénal (Crim.23.02.2000).
Cette infraction se distingue donc des diverses formes d'abandon passif telles l'omission de porter secours, la non-dénonciation de crime ou de délit, ou encore l'infraction de privation de soin.
Quant à l'élément moral :
La Cour précise que l'acte positif de délaissement doit clairement exprimer de la part de son auteur, la volonté d'abandonner définitivement la victime, de s'en défaire totalement. Le délaissement de personne vulnérable dépasse donc la simple négligence, le défaut de surveillance ou encore l'absence d'intérêt.
En l'espèce, le fait que le prévenu se soit finalement résigné à solliciter un médecin, fût-ce « en dernière extrémité », exclut donc la volonté d'abandonner définitivement sa mère en dépit de ses manquements moraux difficilement contestables.
La Cour rappelle régulièrement cette exigence de volonté d'abandon définitif. Elle avait eu l'occasion d'affirmer par le passé que faire obstacle à la venue d'une aide-ménagère au bénéfice d'une personne âgée ne constituait pas un acte positif exprimant la volonté de l'auteur d'abandonner définitivement la victime (Crim.13.11.2007).
La jurisprudence admet en revanche que l'abandon d'un enfant par sa mère dans le but de se soustraire à son obligation d'en prendre soin, sans volonté de retour, constitue un délaissement de personne vulnérable (Paris, 2 juill. 1982).
Cette rigueur dans l'appréciation des éléments constitutifs du délit s'explique certainement par le fait que, contrairement à une certaine conception du droit pénal, les infractions de mise en danger de la personne ne s'intéressent pas exclusivement au comportement de l'auteur. Souvent, ce comportement doit se doubler de la réalisation d'un dommage effectif, qui peut faire basculer le simple manquement à un devoir moral dans la catégorie des infractions pénales.
L'article 223-4 du code pénal confère au délaissement de personne vulnérable une qualification criminelle en cas de mort, ou d'infirmité permanente de la victime. L'évolution de la répression d'un même comportement en fonction de la gravité du dommage demeure un élément d'insécurité juridique qui doit être compensé par une appréciation prétorienne rigoureuse des éléments constitutifs de l'infraction.
Les décisions en la matière sont peu nombreuses mais non moins utiles face à de nombreuses infractions de mise en danger de la personne dont les frontières sont souvent poreuses et la répression sévère et variable.
Livret A: rappel des regles des versements

Livret A : rappel des règles sur le relèvement du plafond depuis le 1er octobre 2012
Dans un communiqué du 9 novembre 2012, le ministère de l'économie et des finances rappelle les règles concernant le relèvement du plafond du livret A s'appliquant depuis le 1er octobre 2012.
D'après l'article L221-4 du code monétaire et financier, les versements effectués sur un livret A ne peuvent pas porter le montant inscrit sur le livret au-delà du plafond fixé par décret.
Par conséquent, il n'est pas possible, pour un particulier, d'effectuer un versement dépassant le nouveau plafond fixé à 19 125 euros.
À noter : l'ajout des intérêts au 31 décembre peut porter la valeur du livret au-delà de ce plafond.
Le relèvement du plafond du livret A à 19 125 euros est entré en vigueur au 1er octobre 2012.
Source : service-public.fr
Succession et procuration sur compte bancaire.

Successions : une procuration sur un compte bancaire oblige à justifier l'utilisation des fonds
Lors du règlement de la succession, l'héritier qui avait une procuration sur les comptes du défunt peut être amené à rendre compte à ses cohéritiers de l'utilisation des fonds qu'il a pu retirer.
C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation à l'occasion d'une affaire où un père avait donné procuration sur ses comptes bancaires à l'une de ses filles. Celle-ci avait procédé à d'importants retraits de fonds. Au décès du parent, ses autres enfants ont demandé et obtenu qu'elle soit condamnée à restituer à la succession les sommes dont elle ne pouvait justifier l'emploi au profit de son père.
Une jurisprudence bien établie reconnait aux héritiers le droit de demander des justifications au mandataire du défunt qui a bénéficié d'une procuration sur les comptes de ce dernier.
Cet héritier peut même être amené à restituer les fonds s'il ne justifie pas les avoir utilisé dans l'intérêt ou pour les besoins du défunt.
En effet, si une procuration permet d'agir sur le compte bancaire d'une autre personne c'est dans l'intérêt de celle-ci et non dans l'intérêt du mandataire.
Dans certains cas, par exemple de manœuvres frauduleuses, cet héritier pourra même se voir reprocher un recel successoral et être privé de sa part sur les fonds ainsi recélés.
source: service-public.fr
Concubins: la dette de l'un n'engage pas l'autre !

Concubins : La dette de l'un n'engage pas l'autre !
C'est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.
Les faits :
Deux personnes vivent en concubinage. L'un des concubins contracte seul un prêt auprès d'une société de crédit. Suite à des impayés, l'organisme financier poursuit les deux concubins pour le paiement.
La procédure :
Le tribunal d'instance les condamne tous deux solidairement au remboursement de la dette. Le jugement est cassé.
Pour la Cour de cassation, un concubin n'est pas tenu au remboursement d'une dette contractée par l'autre s'il n'a pas lui-même signé le contrat. Et ce, même s'il avait connaissance de l'engagement pris par l'autre et en avait profité.
Il s'agit d'une jurisprudence constante pour les concubins.
Quid pour les couples mariés ?
Les dispositions du code civil qui prévoient la solidarité des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, ne sont pas applicables aux concubins.
Si un époux passe seul un contrat qui a pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, son conjoint sera automatiquement engagé et pourra se voir réclamer la totalité de la dette.
Qu'en est-il pour les partenaires pacsés ?
Une dette contractée par l'un des partenaires pour les besoins de la vie courante engagera automatiquement l'autre partenaire.
Exigez un écrit avant de prêter de l'argent: une nécessité !

Exiger un écrit avant de prêter de l'argent : une nécessité !
Mme A. réclame à quatre personnes le remboursement de sommes qu'elle leur aurait prêtées sans leur demander d'écrit.
Mme A. peut seulement justifier des chèques qu'elle leur a remis. Au total, sa réclamation porte sur plus de 50.000 €.
Les quatre personnes répliquent que l'argent ne correspond pas à un prêt, mais à un droit d'entrée que Mme A. leur aurait versé pour devenir associée dans leur société.
Les juges donnent gain de cause à Mme A car aucun élément ne prouve l'existence de ce droit d'entrée, qui n'est d'ailleurs pas mentionné dans les statuts.
La décision est censurée par la Cour de cassation : il incombe à Madame A. de prouver que ses chèques correspondent bien à des prêts.
En pratique, tout prêteur prendra soin de demander un écrit à l'emprunteur, même si la somme est remise par chèque.
Source : intérêts privés
Cass. civ. 1er ch., 12 juillet 2012, n° 10-24333
La renonciation à succession démentie par les actes: attention!

Attention à une renonciation démentie par les actes !
En l'espèce une personne décède et laisse 3 enfants dont un refuse la succession 2 ans plus tard et les deux autres 26 ans plus tard.
La Cour d'Appel, faisant remonter la renonciation au jour de l'ouverture de la succession, bloque les poursuites effectuées par la commune suite à un arrêté de péril sur l'immeuble reçu par succession.
La Cour de Cassation indique : "Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la multiplicité et la nature des actes effectués par les consorts X..., à l'occasion des diverses procédures, ne traduisaient pas leur volonté claire et non équivoque d'accepter la succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale."
Source : Patrimoine.com
Exonération de la plus value immobilière : ATTENTION !

Exonération de la plus-value au titre de la résidence principale : attention au contrôle !
Les plus-values réalisées lors de la cession de la résidence principale sont exonérées.
Cette exonération s'applique également aux dépendances immédiates et nécessaires cédées simultanément avec cet immeuble.
L'exonération est de caractère général.
Elle est acquise lorsque les conditions sont remplies quels que puissent être les motifs de la cession, la nature de l'habitation, l'importance du prix de cession ou de la plus-value et l'affectation que l'acquéreur envisage de donner à l'immeuble, même s'il est destiné à être démoli en vue de l'édification de nouvelles constructions.
L'administration précise que sont considérés comme résidences principales au sens de l'article 150 U-II-1° du CGI, les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle et effective du propriétaire.
La résidence habituelle doit s'entendre du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l'année.
« Il s'agit d'une question de fait qu'il appartient à l'administration d'apprécier sous le contrôle du juge de l'impôt. Dans le cas où le contribuable réside six mois de l'année dans un endroit et six mois dans un autre, la résidence principale est celle pour laquelle l'intéressé bénéficie des abattements en matière de taxe d'habitation ». (BOI-RFPI-PVI-10-40-10-20120912)
Il doit s'agir de la résidence effective du contribuable.
Une utilisation temporaire d'un logement ne peut être regardée comme suffisante pour que le logement ait le caractère d'une résidence principale susceptible de bénéficier de l'exonération.
Lorsqu'un doute subsiste, le contribuable est tenu de prouver par tous moyens l'effectivité de la résidence.
Un arrêt récent de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 04.10.2012 rappelle ces principes.
Voir l'arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026474286&fastReqId=1288833484&fastPos=139
Source : Fiscalonline
Choisir le prélèvement mensuel: c'est maintenant!

Opter avant le 16 décembre pour le paiement mensuel de l'IR, des impôts locaux et de l'ISF !
Les contribuables qui souhaitent, dès janvier 2013, payer mensuellement leur impôt sur le revenu, leur taxe d'habitation (et contribution à l'audiovisuel public perçue en même temps), leur taxe foncière, mais qui n'ont pas encore adhéré au système du prélèvement mensuel ont jusqu'au 15 décembre 2012 pour opter pour le paiement mensuel pour chacun de ces impôts.
Nouveauté !
Il en va de même pour l'impôt de solidarité sur la fortune (seulement pour les redevables qui déclarent leur ISF sur leur déclaration de revenus et qui ont un patrimoine net taxable compris entre 1,3 et 3 M€).
Pour l'option pour le prélèvement mensuel, le contribuable doit avoir un compte bancaire domicilié en France.
Le contribuable peut opter pour le paiement mensuel de ses impôts auprès de son centre de prélèvement service ou de son centre des finances publiques ou encore directement sur le site Internet www.impots.gouv.fr.
En outre, les impôts sont payables en ligne jusqu'à 5 jours après la date limite de paiement. Quelle que soit la date de l'ordre de paiement, le compte bancaire n'est prélevé que 10 jours après la date limite de paiement de l'impôt concerné (ou le premier jour ouvrable suivant).
Source : impots.gouv.fr
Détention : comment obtenir une carte nationale d'identité ?
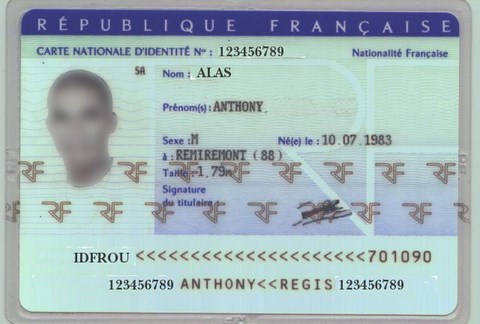
Détention : comment obtenir une carte nationale d'identité ?
Une circulaire du ministère de la justice en date du 23 octobre 2012 précise les modalités de demande et de délivrance de la carte nationale d'identité (CNI) pour les personnes détenues.
La circulaire détaille d'abord l'ensemble des pièces à fournir :
• formulaire de demande Cerfa,
• justificatif d'état civil,
• justificatif de la nationalité française,
• déclaration de perte ou de vol,
• justificatif de domicile ou de résidence,
• photographies d'identité,
• timbre fiscal.
Elle explicite ensuite la procédure à suivre (traitement de la demande, transmission du dossier aux services préfectoraux, suivi de la demande, réception de la CNI...), les cas particuliers (transfert ou libération des personnes détenues) et les conditions d'utilisation de la CNI en détention et de communication de la CNI lors des sorties de prison.
Pour en savoir plus
Légifrance, le service public de la diffusion du droit
Ministère de la justice
Source : service-public.fr
Particulier employeurs: suppression du forfait

Les députés suppriment la déclaration au forfait des particuliers-employeurs.
Les députés ont adopté dans la nuit de mercredi à jeudi la mesure obligeant les particuliers employeurs à acquitter les cotisations sociales sur une assiette forfaitaire égale au montant du salaire minimum de croissance multiplié par le nombre d'heures de travail.
Au cours des débats, le rapporteur de la commission des affaires sociales a finalement retiré son amendement (N°449) qui introduisait un abattement de 8 points sur les cotisations patronales versées par les particuliers employeurs afin de compenser pour partie la suppression de l'assiette forfaitaire.
En contrepartie, et dans le souci de « maintenir un allègement du coût du travail pour les particuliers employeurs au titre des cotisations patronales qu'ils versent pour l'emploi de leurs salariés, de façon à compenser pour partie la suppression du mécanisme d'assiette forfaitaire », les députés ont adopté un amendement (N°760 Rect) des membres du groupe socialiste, instituant une déduction forfaitaire de 0,75 euros par heure travaillée (applicable aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2013) dont les modalités d'indexation seront fixés par décret.
Source : Club Patrimoine
http://www.particulier-employeur-zen.com/fin-des-cotisations-au-forfait-au-1er-janvier-2013-quelles-consequences
Les comptes à termes: une pratique entourée
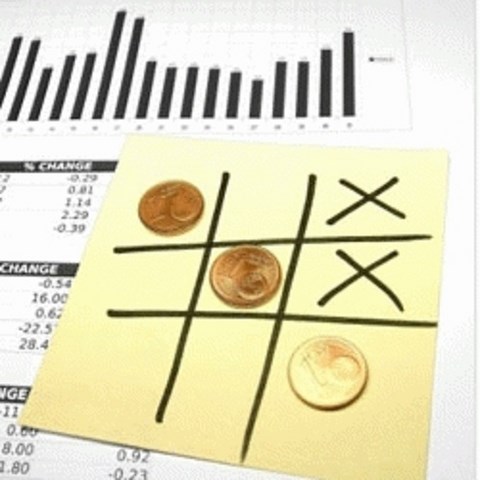
L'Autorité de Contrôle Prudentiel publie une recommandation sur la commercialisation des comptes à terme
Face à la multiplication des offres bancaires d'ouverture de comptes à terme à destination des particuliers, l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) a publié ce jour une nouvelle recommandation visant à apporter une plus grande transparence dans la commercialisation, la gestion et la clôture de ces contrats.
Elle vise tout particulièrement les conventions qui comportent plusieurs comptes à terme ou attachés à un livret d'épargne, voire à un contrat d'assurance vie, pour lesquels elle a pu constater que le fonctionnement et la rémunération effective sont parfois difficiles à appréhender.
Cette recommandation s'appliquerait à compter du 1er juin 2013 aux établissements de crédit ainsi qu'aux intermédiaires en opérations de banque et service de paiement (IOBSP).
L'ACP souhaite que les publicités soient davantage encadrées en suivant l'adage « les communications ne doivent pas privilégier les caractéristiques les plus avantageuses au détriment des conditions moins favorables du produit. »
Sa recommandation exige un nombre suffisamment important d'informations pré contractuelles sur :
- le retrait anticipé,
- le taux d'intérêt,
- la durée du contrat,
devant conduire les professionnels à revoir leur stratégie de communication en profondeur.
Par ailleurs, l'ACP impose aux banques et aux IOBSP de fournir au client avant la conclusion d'un compte à terme un document distinct du contrat « hormis le cas où un document d'information pré contractuelle contiendrait déjà ces informations ».
Source : Agefi Actifs
Assurance vie: changement de clause et manoeuvre dolosive

Assurance vie : changement de clause et manoeuvre dolosive
Les faits :
A la suite du décès de son époux, Mme X. a modifié, par avenant, la clause désignant le bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie au profit de sa fille.
Elle a fait assigner cette dernière et l'époux de celle-ci en nullité de l'avenant.
La procédure :
Dans un arrêt du 6 janvier 2011, la cour d'appel de Douai a annulé cet avenant au contrat d'assurance-vie.
Les juges du fond ont constaté que deux procurations au profit de la fille avaient été établies sur les comptes de Mme X et que les comptes de cette dernière avaient postérieurement subi des modifications substantielles.
Ils ont également relevé que la clause désignant le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie de Mme X. avait été modifiée, en présence de sa fille et de son gendre, quelques jours à peine après le décès de son époux, alors qu'elle se trouvait dans un état de faiblesse dû à l'âge et à la tristesse.
La décision :
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 12 juin 2012.
Elle estime que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé que les choix relatifs à la gestion de ses avoirs bancaires résultaient de manoeuvres dolosives employées par la fille et le gendre et en l'absence desquelles Mme X. n'aurait pas signé l'avenant litigieux.
La Haute juridiction judiciaire considère qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
Source : Le monde du Droit
Assurance vie et délai de versement

Assurance vie : quels délais de versement ?
Jusqu'au 17 décembre 2007, l'assureur n'avait aucune obligation concernant la rémunération des capitaux issus d'une assurance-vie, après le décès du souscripteur.
Cela n'est plus le cas.
La loi du 17 décembre 2007 a modifié l'article L. 132-23-1 du Code des assurances fixant un délai de versement aux bénéficiaires des sommes figurant sur le contrat d'assurance-vie. Cette limite est valable en cas de décès et lors de la clôture du contrat.
Les sommes dues au bénéficiaire sont revalorisées à 1,5 fois le taux d'intérêt légal pendant les deux premiers mois.
Au-delà de ce délai, les sommes seront revalorisées au double du taux d'intérêt légal en vigueur.
A noter que le délai commence à compter du jour où le dossier complet arrive à l'assureur.
L'envoi du courrier en recommandé avec accusé de réception est par conséquent fortement conseillé. Il représentera la preuve de la date de réception des pièces justificatives.
Source : Club Patrimoine
Interview d'un juge des tutelles

« L'altération des facultés ne nécessite pas forcément la mise sous tutelle »
Interview d'Emilie Pecqueur, juge des tutelles au tribunal d'instance d'Arras dans le Pas-de-Calais.
Beaucoup moins médiatique que certains de ses confrères, le juge des tutelles a un rôle clé : il est l'interlocuteur incontournable lorsqu'une mesure de protection juridique est en jeu. Emilie Pecqueur, juge des tutelles au tribunal d'instance d'Arras, nous parle de son métier.
Quel est le rôle du juge des tutelles ?
Le juge des tutelles est en charge de la protection des majeurs vulnérables dont les capacités mentales ou physiques sont altérées. Il prononce des mesures de protection juridique comme le mandat spécial, la curatelle et la tutelle, mais aussi des habilitations entre conjoints. Il a également en charge les mesures d'accompagnement judiciaire pour des personnes qui ont du mal à gérer leurs biens sans avoir pour autant des facultés altérées et pour lesquelles un accompagnement administratif est nécessaire. Dans le cas particulier du mandat de protection future, le juge des tutelles peut intervenir s'il y a des difficultés (des conflits par exemple) dans la mise en place du mandat.
Y a-t-il un seul ou plusieurs juges des tutelles dans un tribunal d'instance ?
Cela dépend de la taille du tribunal d'instance. Le tribunal d'instance d'Arras compte quatre juges d'instance. Parmi eux, nous sommes deux juges des tutelles à nous répartir l'ensemble des 3300 dossiers de demande de protection juridique en cours. Tout juge d'instance a compétence pour être juge des tutelles sur désignation du Président du tribunal de grande instance. Quand ma collègue ou moi-même sommes absentes, les autres juges d'instance du tribunal peuvent reprendre nos dossiers.
Lorsque les proches d'une personne âgée estiment nécessaire de la placer sous mesure de protection juridique, ils doivent en faire la demande écrite au juge des tutelles. Est-ce vous qui étudiez directement toutes ces demandes ?
Dans un premier temps, le greffier du tribunal d'instance enregistre la requête qui doit être accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin agréé par le Procureur de la République établissant la nécessité de la mesure de protection. Il me transmet ensuite le dossier. Je rencontre la personne (sauf cas exceptionnels, notamment des contre-indications médicales), les requérants, toutes les personnes qui se proposent pour exercer le mandat et toute autre personne que j'estime utile d'entendre.
Quels sont les délais entre le dépôt de la demande et le prononcé du jugement ?
Les délais sont variables en fonction des tribunaux, les juges des tutelles y sont souvent en sous-effectif… Tout dépend également du nombre de personnes à rencontrer, des conflits éventuels existants dans la famille. Il faut compter 2 à 3 mois minimum et 1 an maximum car, au-delà de ce délai, la requête devient caduque.
Comment choisissez-vous le tuteur ?
La personne à protéger peut avoir auparavant désigné auprès d'un notaire la personne qu'elle souhaite avoir comme tuteur. Sinon, la loi donne la priorité au conjoint, puis aux membres de la famille, aux proches. Si la personne n'a pas de proches ou si aucun membre de la famille n'est en mesure d'assumer ce rôle, je nomme une association mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs ou un mandataire à titre privé. Actuellement, 48 % des mesures sont exercées par les familles (dont 60 % des tutelles), les autres sont prises en charge par des professionnels.
Les tuteurs peuvent-ils être aidés pour exercer leur mandat ?
Lorsque le juge reçoit la personne qui se propose pour exercer la mesure, il lui donne les explications nécessaires. Si par la suite le tuteur est confronté à des difficultés, il peut téléphoner au tribunal. A Arras, le greffe assure un accueil téléphonique et peut répondre aux questions ou inviter à la personne à écrire au juge. Je sais, par ailleurs, qu'au tribunal d'instance de Quimper, une personne assure une permanence physique et reçoit les tuteurs pour les aider à mettre en forme leurs requêtes, à réaliser les inventaires de patrimoine, à établir les comptes de gestion. Mais certains tribunaux manquent de personnels pour effectuer un accueil satisfaisant des personnes ayant besoin d'aide.
La loi prévoit en principe la mise en place d'un système de soutien aux tuteurs familiaux. Dans le Pas-de-Calais, des associations tutélaires se sont regroupées pour proposer cette aide aux tuteurs familiaux sous l'égide de l'UDAF.
Vous arrive-t-il souvent de ne pas donner suite à une demande de mise sous tutelle émanant des proches ? Pour quelles raisons ?
Souvent, non, mais cela m'arrive… je dirais dans 5 à 10% des cas. Il faut faire attention à une chose : le fait qu'une personne ait une altération de ses facultés ne nécessite pas forcément la mise en place d'une mesure de protection juridique. Parfois la mesure va engendrer des contraintes supplémentaires inutiles, notamment si les dispositions déjà mises en place (procuration sur le compte…) fonctionnent bien.
Je constate que la question de la mise sous tutelle se pose souvent pour les personnes âgées lors de leur entrée en maison de retraite alors qu'elle n'a plus vraiment lieu d'être, les risques d'abus étant limités. En effet, c'est souvent à leur domicile que les personnes âgées ont besoin d'être protégées, contre des vendeurs peu scrupuleux par exemple…
J'ai également pu observer, dans ma pratique, des comportements très protecteurs de la part des enfants, qui veulent prendre des décisions à la place de leurs parents sur des questions qui relèvent de leur liberté. Peut-être cela participe-t-il de la mauvaise réputation du juge des tutelles : il est là pour protéger la personne, pas pour assouvir les désirs du reste de la famille !
Source : aidons les autres.
Interview réalisé par Mme Puillandre, chargée de mission au Cleirppa (centre d'études et de conseil en gérontologie sociale).
Avis du médecin et renouvellement d'une mesure de protection

Durée du renouvellement d'une mesure de protection et avis obligatoire du médecin
L'arrêt rendu par la Cour de cassation, le 10 octobre 2012, est l'occasion pour les magistrats de la première chambre civile de rappeler que le juge ne peut, par une décision spécialement motivée, renouveler une mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans que sur avis conforme d'un médecin choisi sur la liste établie par le procureur de la République.
Les faits :
En l'espèce, Mme X est placée sous curatelle renforcée le 9 avril 1999.
Par un jugement du 23 février 2010, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne rejette la requête en mainlevée de la mesure et fixe la durée de celle-ci à 10 ans.
Pour motiver sa décision, le tribunal énonce que l'examen du médecin psychiatre avait mis en évidence que l'altération des facultés mentales de Mme X. résultant d'une schizophrénie avec déficit cognitif apparaissaient peu susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science.
La décision :
La Cour de cassation casse et annule le jugement de première instance au motif qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision.
Source Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 11-14.441
Multiples détentions du LIVRET A: attention, le décret est paru!

Attention aux multiples détentions de Livret A : un décret vient de paraître
Le décret visant à lutter contre les multi détentions du Livret A vient de paraitre au Journal Officiel.
Après l'augmentation des plafonds des livret A et LDD effective depuis le 1er octobre 2012 à la suite des décrets du 18 septembre 2012, le gouvernement renforce la surveillance des épargnants.
Le 6 octobre dernier, le décret n° 2012-1128 du 4 octobre 2012 relatif aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A est paru. Il concerne à la fois les établissements de crédits distribuant les livrets A et leurs clients. Ce décret a pour but de vérifier et d'empêcher la détention de plusieurs livrets A par un épargnant. Ainsi, les établissements de crédit devront solliciter l'Administration fiscale avant toute ouverture d'un livret A.
Ce décret entrera en vigueur le 1er janvier 2013.
Que contient le décret ?
Information du client
- Dans un premier temps, le décret précise les modalités d'information du client par les banques saisies d'une demande d'ouverture d'un livret A :
• L'établissement saisi d'une demande d'ouverture devra informer le client de la réglementation interdisant de disposer de plusieurs livrets A et du fonctionnement de la procédure de contrôle préalable à l'ouverture d'un livret A.
• Si le client possède déjà un livret A, il devra donner son acceptation à l'administration fiscale de lui communiquer les coordonnées par l'intermédiaire de sa banque.
Procédure de contrôle préalable
- Le décret décrit ensuite la procédure de contrôle préalable à l'ouverture du livret A :
• L'établissement saisi d'une demande d'ouverture doit en premier lieu interroger l'administration fiscale sur l'existence éventuelle d'un précédent livret A.
• L'administration fiscale doit répondre sous 48 heures et préciser, en cas de détention préalable et en cas d'accord formalisé par le client sur le contrat d'ouverture du livret A, les coordonnées du ou des anciens livrets.
Si le client ne possède pas d'ancien livret A, l'ouverture du nouveau livret A peut avoir lieu immédiatement.
Conséquence de la détention préalable d'un livret A
- Le client qui possède déjà un livret A et souhaite en ouvrir un autre, devra fermer l'ancien livret détenu :
• soit par ses propres moyens,
• soit en confiant à la banque le soin de le faire.
Dans cette dernière hypothèse, la banque pourra ouvrir le nouveau livret dès qu'elle aura reçu une attestation de clôture de la part de l'établissement où l'ancien livret A était ouvert.
Si le client décide de se charger lui-même de la fermeture de son ancien livret, il devra fournir cette même attestation à la banque dans un délai de 3 mois maximum après la demande d'ouverture.
- Ce délai écoulé, la banque devra de nouveau consulter l'administration fiscale si le client maintient sa demande.
- Le décret ajoute que l'établissement saisi d'une demande de clôture d'un livret A est tenu d'y procéder dans les 15 jours ouvrés.
Source : décret 2012-1128 du 04.10.2012. Fidroit.
Pension versée à un enfant majeur

La pension n'est pas déductible si l'enfant majeur n'a pas demandé les prestations auxquelles il a droit
Les sommes versées par un contribuable à un enfant majeur ne revêtent pas un caractère alimentaire, et ne peuvent donc pas être déduites de son revenu imposable (CGI art. 156), dès lors que l'état de besoin de cet enfant procède de circonstances qui ne sont pas indépendantes de sa volonté.
En l'espèce, un contribuable demandait à déduire comme pension alimentaire 4 500 € versés en 2007 à sa fille majeure. Déduction remise en cause par l'administration fiscale.
La cour administrative d'appel refuse à son tour cette déduction au contribuable en jugeant que sa fille, mère de deux enfants à charge et propriétaire de sa résidence principale, s'était volontairement privée de ressources et ne pouvait donc pas être regardée comme étant dans le besoin.
Le montant de ses revenus nets de frais professionnels (13 128 € en 2007) aurait permis de la regarder comme étant en état de besoin en 2007.
Mais elle s'était volontairement privée de ressources en s'abstenant d'accomplir les démarches qui lui auraient permis, d'une part, d'obtenir du père de ses deux enfants, dont elle a divorcé, qu'il contribue financièrement à l'entretien de ceux-ci et, d'autre part, de bénéficier des prestations sociales auxquelles sa situation familiale lui ouvrait droit.
Source : Revue Fiduciaire/ CAA Nantes 26 juillet 2012, n° 11-2462
ISF et personnes à charge

ISF : l'administration fiscale précise le champ d'application de la réduction pour personne à charge
La loi du 29 juillet 2011 réformant la fiscalité du patrimoine a notamment relevé à 300 €, contre 150 € auparavant, le montant de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune pour personne à charge et a élargi son champ d'application aux personnes dont le redevable assure la charge d'entretien à titre exclusif ou principal.
Toutes les personnes dont le redevable assure la charge d'entretien peuvent dorénavant être prises en compte pour le calcul de la réduction d'ISF même si elles ne sont pas comptées à sa charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
Dès lors, il est désormais possible qu'un redevable bénéficie de cette réduction d'impôt à raison d'une personne qui n'appartient pas à son foyer fiscal au regard de l'ISF mais dont il assure la charge d'entretien à titre exclusif ou principal (par exemple, un enfant majeur poursuivant des études, quel que soit son âge, ou un aïeul vivant sous le toit du redevable).
L'administration fiscale précise que ces modifications s'appliquent à l'ISF dû à compter de l'année 2012 (BOI-PAT-ISF-40-20).
Source : Patrimoine.com
CMU Complémentaire: Relèvement des plafonds de ressources

Relèvement du plafond des ressources pour la CMU.C.
Le plafond annuel des ressources prises en compte pour l'attribution gratuite de la protection complémentaire en matière de santé (CMU-C) est relevé par le décret n° 2012-1080 du 25 septembre 2012.
Il s'élève à 7.934,40 € pour une personne seule à compter du 1er juillet 2012, contre 7.771,20 € auparavant (CSS, art. D.?861-1 modifié).
Ce plafond s'applique également pour le bénéfice de l'aide médicale d'État (C. action soc. et familles, art. L.251-1).
Quant au plafond de ressources pris en compte pour le bénéfice de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire santé (ACS) (CSS, art. L.863-1), qui consiste en une aide financière pour l'acquisition d'un contrat d'assurance maladie complémentaire de santé individuel, sous la forme d'une réduction forfaitaire sur le montant de la cotisation (ou prime) annuelle à payer à un organisme complémentaire de santé (par exemple, une mutuelle) et qui bénéficie aux personnes qui ont des revenus trop modestes pour financer une couverture complémentaire santé mais trop élevés pour avoir accès à la CMU-complémentaire, il est relevé et porté à 10.711,44 €.
Source : D. n° 2012-1080, 25 sept. 2012 : JO 27 sept. 2012, p. 15221. LexisNexis
Handicap et retraite anticipée

Retraite anticipée « travailleurs handicapés » : la CNAV précise certains cas particuliers
Un mécanisme de retraite anticipée permet aux personnes handicapées de partir en retraite avant l'âge légal, au plus tôt à 55 ans, en fonction de divers critères. A l'origine ouvert aux assurés atteint d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %, ce dispositif a ensuite été élargi à ceux ayant accompli les durées d'assurances et de cotisations requises alors qu'ils avaient la qualité de travailleur handicapé (c. séc. soc. art. L. 351-1-3, modifié par la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, art. 97).
Cette qualité est en principe reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés (CDAPH, anciennement COTOREP). Cependant, la loi prévoit aussi que « l'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT), vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle, vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé » (c. trav. art. L. 5213-2).
Or, certaines personnes se sont vues refuser, pour différentes périodes, la qualité de travailleurs handicapés par la CDAPH ou la COTOREP, tout en ayant fait l'objet d'un placement ou d'une orientation professionnelle en établissement de travail spécialisé. Cette situation peut-elle être assimilée à la qualité de travailleur handicapé ?
Confrontée à cette question, la CNAV relève que depuis l'entrée en vigueur de la loi « handicap » du 11 février 2005, seuls les ESAT relèvent du milieu de travail protégé. Les entreprises adaptées (ex-ateliers protégés) et les centres de distribution de travail à domicile (CDTD) font à présent partie du milieu ordinaire du travail et ne sont donc pas visés par l'assimilation.
Dès lors, pour les périodes postérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 au titre desquelles l'assuré n'est pas reconnu comme travailleur handicapé par la CADPH, l'assimilation à la qualité de travailleur handicapé concerne exclusivement les personnes exerçant leur activité au sein d'ESAT.
Pour les périodes antérieures, l'ensemble des structures ayant vocation à accueillir les travailleurs handicapés ne pouvant avoir accès à un emploi en milieu ordinaire du travail relevait du secteur protégé. Pour cette raison, la CNAV admet d'assimiler à la qualité de travailleur handicapé, les personnes non reconnues comme tel, mais ayant fait l'objet sur l'attestation délivrée par l'organisme compétent (COTOREP, notamment) d'un signalement de placement ou d'orientation dans un établissement d'aide par le travail, quelles qu'en soient la nature et la dénomination (ESAT, CAT, atelier protégé, CDTD, etc.).
Source : lettre CNAV du 06.09.2012. Revue Fiduciaire.
Connaissez-vous le congé pour travaux?

Reprise du logement pour travaux
Un propriétaire louant un logement peut-il donner congé à son locataire afin de le remettre aux normes et de le restructurer ?
La Cour de cassation considère que l'intention de reprendre un immeuble pour l'améliorer, le rénover ou même le démolir et le reconstruire peut justifier un congé pour motif légitime et sérieux (cass.civ.3ème du 7.2.96 n°94.14339).
Elle a ainsi pu faire droit à un congé quand les travaux étaient destinés à améliorer les équipements et le confort de l'immeuble ainsi que pour la distribution des logements. Il faut que la libération des lieux par le locataire soit nécessaire (CA de Paris du 08.02.93, n°93/012197).
La procédure :
Il faut se référer à l'article 15 l de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Il impose au bailleur de respecter le préavis de 6 mois avant le terme du bail pour donner congé à son locataire.
Le congé doit en outre être adressé par lettre recommandée avec avis de réception ou délivré par huissier.
Source : Le Particulier.
Majeurs protégés: le tableau pour l'épargne de précaution

Majeur protégé employeur: ne pas oublier d'appliquer la hausse du SMIC !

Particulier Employeur : ne pas oublier d'appliquer la hausse du SMIC !
Au 1er juillet dernier, le SMIC a été relevé de 2% passant à 9,40 € par heure.
Ce montant se substitue aux minima des conventions collectives et notamment à celle concernant les particuliers employeurs qui y sont inférieurs.
En cas de paiement par CESU, il convient de vérifier l'application de cette augmentation et de lui ajouter les 10% pour congés payés.
Dès lors, le salaire brut doit être au moins de 10,34 € de l'heure.
Quant au salaire net :
* Si les cotisations sont calculées sur le salaire réel, cela correspond à 7,96 €.
* Si les cotisations sont calculées sur la base forfaitaire, cela correspond à 7,94 €.
Source : Intérêts privés.
Assurance vie et couple marié

Assurance vie et couple marié sous le régime de la communauté légale : quelles règles ?
En présence d'un couple marié sous le régime communautaire légal (qui s'applique automatiquement, en France, si aucun contrat de mariage n'a été rédigé), il faut distinguer les biens communs et les biens propres.
Les biens propres :
La personne en est l'unique propriétaire. Ils sont composés du patrimoine qui lui appartenait avant son mariage ou ceux reçus en donation ou par succession.
Les biens communs :
Ils sont composés des revenus perçus durant l'union (salaires, loyers, intérêts de placements financiers) et des biens acquis en commun.
Ils sont supposés appartenir pour moitié à chacun des deux époux.
Quelle règle en cas de souscription d'un contrat d'assurance vie par une personne mariée ?
Si un contrat d'assurance vie est souscrit par une personne mariée et qu'il est alimenté avec des biens communs (le salaire par exemple), au décès de son conjoint, ce contrat réintégrera automatiquement sa succession.
La personne souscriptrice sera considérée comme propriétaire d'une moitié du contrat, l'autre devant être partagée entre les héritiers. Et ce même si elle l'a géré seul.
Quelles solutions pour éviter cela ?
La plus simple :
Il s'agit d'investir dans le contrat uniquement des biens propres, en conservant des traces des investissements (fonds provenant d'une vente d'un bien vous appartenant par exemple) et en signalant à l'assureur leur provenance avec une clause de remploi.
Dans ce cas, au décès du conjoint du souscripteur, le contrat, alimenté avec des biens propres, ne réintégrera pas la succession.
Autre piste :
Ouvrir une assurance vie en souscription conjointe, au nom de monsieur et madame, avec dénouement au premier décès.
Ainsi, lorsque l'un des époux disparaît, le contrat est automatiquement dénoué, et n'est donc plus réintégré dans la succession. L'époux survivant conserve alors l'intégralité des sommes investies dessus.
Seul inconvénient dans ce cas : les bénéficiaires du contrat, en général les enfants, doivent attendre le décès du second conjoint pour toucher leur capital.
Protection juridique des majeurs: sortie du LIVRE BLANC
Protection Juridique des majeurs : Publication du Livre Blanc
Trois ans après la réforme en profondeur du droit de la protection juridique des majeurs, les quatre fédérations du secteur (CNAPE, FNAT, UNAF et Unapei) dressent un bilan du dispositif.
Dans un livre blanc réalisé à partir d'entretiens avec des professionnels – juges, notaires, avocats, associations –, ils proposent également 25 solutions pour améliorer l'accompagnement des personnes protégées.
Anne-Marie David, présidente de la Fédération nationale des associations tutélaires (FNAT) et porte-parole de l'inter fédération du secteur répond à La Croix.
Interview de Mme DAVID :
La Croix : Qui est concerné aujourd'hui par la protection juridique des majeurs ?
Anne-Marie David : En 2011, près de 800 000 personnes bénéficiaient d'une mesure de protection juridique. La population concernée est en augmentation constante depuis plusieurs années, principalement en raison du vieillissement de la population et du développement de pathologies comme Alzheimer, qui réduisent l'autonomie des malades.
Pour faire face à ces évolutions, la loi a été modifiée en 2007 puis est entrée en vigueur en 2009. Elle restreint la mise sous tutelle ou sous curatelle aux personnes dont l'altération des facultés est attestée par une expertise médicale. On apprécie la vulnérabilité d'une personne par rapport à son degré d'autonomie et sa capacité à défendre ses intérêts.
La loi de 2007 est-elle toujours adaptée ?
A-M. D. : Nous validons entièrement l'esprit de la loi de 2007, qui est fondée sur le bien-être de la personne et qui cherche à coller au plus près de ses besoins spécifiques. L'envers de la médaille, c'est que cela complique sa mise en œuvre. Par exemple, à chaque fois qu'il faut prendre une décision se rapportant aux comptes d'une personne protégée, il faut solliciter les juges, or les délais d'échange avec les tribunaux peuvent prendre jusqu'à trois mois, car la justice manque de moyens.
Mais lorsqu'une personne est isolée ou en situation de grande fragilité, il faut une grande réactivité, sous peine de voir sa situation se détériorer rapidement. De manière générale, il faut simplifier les procédures.
Quelles sont vos propositions pour améliorer le dispositif ?
A-M. D. : Nous souhaiterions la création d'un Observatoire national de protection juridique, piloté par l'État, mais qui pourrait intervenir à l'échelle régionale ou départementale. Actuellement il n'existe pas vraiment d'instance qui analyse l'évolution des besoins de la population et qui vérifie que les droits des personnes protégées sont bien respectés.
Nous proposons aussi de renforcer la professionnalisation des mandataires en créant un véritable diplôme d'État, afin d'améliorer la qualité de l'accompagnement. La fonction d'accompagnant doit être reconnue comme un métier à part entière, qui implique une volonté de s'engager auprès des personnes vulnérables via un cursus solide.
Par ailleurs, nous proposons d'organiser la justice de la protection des majeurs en s'inspirant du modèle de la justice des mineurs : de même qu'il existe un juge des enfants, nous voudrions que les juges des tutelles travaillent exclusivement sur la protection juridique des majeurs. Or, actuellement, ils sont également juges d'instance.
Cela ne risque-t-il pas de coûter très cher ?
A-M. D. : Tout dépend. Nous demandons par exemple de développer l'aide aux tuteurs familiaux. Cette aide est prévue par la loi mais n'est pas proposée partout, pour des raisons de budget. Mais si cette aide était vraiment disponible, l'État ferait à long terme des économies substantielles puisque il y aurait davantage de mandataires familiaux non rémunérés, et moins de mandataires judiciaires. Nous avons bon espoir d'être entendu sur ce point.
Propos recueillis par CATHERINE MONIN.
Source : la Croix
Livret A: relévement du plafond
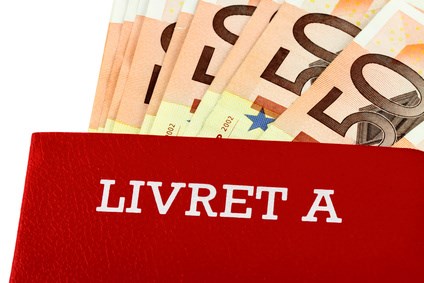
Livret A et livret de développement durable : relèvement des plafonds
Le plafond du livret A, au 1er octobre prochain, va être augmenté de 25 % passant à 19 125 euros tandis que celui du livret de développement durable va être doublé passant à 12 000 euros. Par ailleurs, le ministre a annoncé la mise en place d'un deuxième relèvement de 25 % du plafond du livret A d'ici la fin de l'année 2012.
Le livret A et le livret de développement durable (ex-codevi) sont des comptes d'épargne rémunérés dont les fonds sont disponibles à tout moment. Tous les établissements bancaires peuvent les proposer. Les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.
Source : service public.fr
Expulsion d'un locataire surendetté

La suspension des procédures d'expulsion d'un locataire surendetté est conforme à la constitution
Un locataire surendetté peut obtenir la suspension des mesures d'expulsions engagées par son bailleur. C'est au juge d'instance de le décider en déterminant « si la situation du débiteur l'exige » (article L 331-3-2 du code de la consommation).
Confronté à cette situation, un bailleur avait souhaité savoir, au travers d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), si cette mesure portait une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté individuelle. La Cour de Cassation a refusé l'utilisation de cette procédure, estimant que la question ne présentait pas « un caractère sérieux », nécessaire à sa transmission au Conseil constitutionnel. Selon la Haute Cour, la suspension temporaire des procédures d'expulsion n'a « ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire de l'immeuble de son droit de propriété ».
Rappelant l'objectif d'intérêt général de cette mesure (faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers), la Cour de cassation considère que les atteintes au droit de la propriété et à la liberté individuelle qui en découlent « sont proportionnées à cet objectif ».
Source : Intérêts privés
Taxe supplémentaire sur la fortune: modalités

Modalités de déclaration et de paiement de la contribution exceptionnelle sur la fortune
La DGFiP a présenté les modalités et le calendrier de mise en œuvre de la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012.
Contribuables qui ont déclaré leur ISF 2012 avec leur déclaration de revenus et dont le patrimoine est supérieur ou égal à 1,3 million d'euros et inférieur à 3 millions d'euros :
Ces contribuables n'ont pas à déposer une nouvelle déclaration.
L'administration fiscale se chargera de calculer le montant de la contribution à partir des éléments déjà déclarés.
Ils recevront, début octobre :
- leur avis d'impôt sur le revenu ;
- leur avis d'ISF qui comportera également le montant de leur contribution exceptionnelle sur la fortune.
Pour ces impôts (IR, ISF et contribution exceptionnelle sur la fortune), la date limite de paiement est le 15 novembre 2012.
Pour les contribuables mensualisés à l'impôt sur le revenu, le solde de leur impôt, s'il augmente sensiblement entre 2011 et 2012, sera automatiquement prélevé en décembre.
Contribuables qui ont déclaré et payé leur ISF au 15 juin et dont le patrimoine est supérieur à 3 millions d'euros :
Une déclaration spécifique pour la contribution exceptionnelle sur la fortune 2012 leur sera adressée début octobre.
La déclaration et le paiement associé devront être effectués pour le 15 novembre 2012.
Voir communiqué de presse :
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/12945.pdf
Source : Intérêts Privés.
Délai supplémentaire pour payer l'IR

Paiement avant le 17 septembre du solde de l'impôt sur le revenu 2012
Les avis de mis en recouvrement de l'impôt sur le revenu des personnes non mensualisées, ou celles n'ayant pas opté pour le prélèvement à l'échéance, sont à régler avant le 17 septembre minuit.
Le solde de l'impôt sur le revenu de 2012 ou l'IR 2012 - à défaut de paiement de tiers provisionnel pour ceux dont l'impôt sur les revenus 2011 était inférieur à 342 euros - pourra être payé, sans pénalité, par télépaiement, jusqu'au 22 septembre.
En se rendant sur le site impots.gouv. du ministère des Finances et de l'Economie, les redevables disposent d'un délai supplémentaire de 5 jours en cas de paiement par virement.
Un espace abonné leur est dédié, ainsi que la possibilité d'accéder au compte fiscal personnel en ligne.
Pour les personnes ayant choisi le prélèvement à l'échéance, quelle que soit la date d'adhésion, le compte bancaire à débiter sera prélevé fin septembre.
Rappelons que les personnes qui ont déclaré leurs revenus par internet cette année pour la première fois et qui n'ont pas adhéré au prélèvement mensuel, doivent obligatoirement régler leur impôt par le prélèvement à l'échéance ou le paiement direct en ligne.
Pour ceux ayant télé-déclaré leurs revenus, ils peuvent désormais corriger en ligne, jusqu'au 30 novembre 2012, une erreur ou une omission dans leur déclaration.
A noter qu'il est possible d'adhérer au prélèvement mensuel pour l'impôt sur le revenu à compter de 2013, en souscrivant l'option avant le 15 décembre 2012. Dans ce cas, le premier prélèvement sera effectué en janvier 2013.
Enfin, via le compte fiscal en ligne, le contribuable peut aussi consulter les autres avis d'imposition dès leur émission, comme celui de la Taxe foncière 2012, et à partir de début octobre, celui de la Taxe d'habitation et des prélèvements sociaux 2012.
Source : Net.iris
Durcissement des taxes sur les locaux vacants

Relèvement de la taxe sur les logements vacants
Une taxe sur les logements vacants peut être réclamée, sous certaines conditions, dans les communes des agglomérations de plus de 200 000 habitants où il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements (liste fixée par décret).
La 2e loi de finances rectificative pour 2012, publiée vendredi au Journal officiel, relève les différents taux d'imposition de cette taxe.
Ceux-ci sont respectivement portés de 10 % à 12,5 % la première année d'imposition, de 12,5 % à 15 % la 2e année et de 15 % à 20 % à compter de la 3e année. Ce relèvement s'applique pour les impositions établies à compter de 2013.
Source : Patrimoine.com
AAH: Montant revalorisé !

Allocation aux adultes handicapés : 776,59 euros à partir de septembre 2012
Le montant maximum de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) doit être porté à 776,59 euros par mois à compter des allocations dues au titre du mois de septembre 2012 (contre 759,98 euros auparavant).
C'est ce qu'indique un décret publié au Journal officiel du 15 avril 2012.
L'AAH a pour objet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées pour qu'elles puissent faire face aux dépenses de la vie courante. L'allocation est attribuée à partir d'un certain taux d'incapacité, sous réserve de remplir des conditions de résidence, de nationalité, d'âge et de ressources. Son montant varie en fonction des ressources de la personne handicapée. Ainsi, une personne ne disposant d'aucune ressource peut percevoir le montant maximum de l'AAH.
La demande d'allocation doit être faite auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui aidera la personne et la renseignera sur ses autres droits éventuels.
Source : service-public.fr / Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Défaut d'information: banque sanctionnée!

Informations non cohérentes : Une banque sanctionnée
La Cour de cassation sanctionne une banque qui a « fait seule le choix d'un investissement unique, à savoir celui d'un placement dépendant des seuls aléas du marché immobilier » au lieu de proposer une diversification des investissements à sa cliente.
Si cette dernière « avait été complètement informée des risques encourus, elle n'aurait pas à l'évidence accepté de souscrire à cette opération qui s'est avérée financièrement désastreuse, contrairement aux prévisions de la caisse qui lui laissait espérer un rendement minimum de 6,5 % par an ».
L'information délivrée par la caisse à sa cliente de souscrire des parts de SCPI n'était pas cohérente avec l'investissement proposé et ne mentionnait pas les caractéristiques les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.
Source : Actifs. Cass. Com, n°11-11891, 10 juillet 2012
Locataire âgé et droit au relogement

Age du locataire et droit au relogement
Pour mémoire : Il résulte des dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989, que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail en donnant congé aux locataires âgés de plus de 70 ans et dont les ressources sont inférieures à une fois et demie le montant du SMIC uniquement s'il lui offre un logement correspondant.
En l'espèce, un locataire, éligible aux dispositions protectrices légales précitées, décède huit mois avant le terme du bail, laissant une épouse de moins de 70 ans.
La cour de cassation a donné raison aux premiers juges, ayant constaté que la locataire était âgée de moins de 70 ans avant la date d'échéance du contrat, d'en avoir déduit qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier de la protection du locataire âgé, et qu'à compter du décès de son mari, le bailleur n'était plus obligé de faire une offre de relogement avant le terme du bail pour s'opposer au renouvellement de celui-ci.
Apport de l'arrêt : Cette décision précise les conditions d'application des dispositions protectrices des locataires âgés. Dans la mesure où la locataire ne bénéficiait pas de la protection légale à la date d'échéance du bail, le bailleur n'était pas tenu de lui faire une offre de relogement. L'art.15 III de la loi de 1989 prévoit en effet que l'âge du locataire est apprécié à la date d'échéance du contrat.
Source : Juritravail. (Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 mai 2012, n° 11-17.010, n° 456 P + B, Chaung et a. c/ Sté Résidence de la République)
Taxe d'habitation et départ du locataire

Qui paye la taxe d'habitation en cas de départ du locataire ?
Les faits :
Un propriétaire a reçu un courrier du centre des impôts lui demandant d'acquitter la taxe d'habitation à la place de son locataire parti sans donner de préavis, il y a quelques mois.
Doit-il payer cette taxe ?
La réponse :
Oui. L'administration fiscale peut se retourner contre un propriétaire si son locataire a déménagé sans avoir payé sa taxe d'habitation.
Comment éviter cela ?
Lorsqu'un locataire donne son congé, il convient de lui demander de présenter ses quittances de taxe d'habitation. S'il ne peut les produire ou s'il déménage, le propriétaire a 3 mois pour informer le comptable du Trésor du départ du locataire. A défaut, il sera tenu du paiement de la taxe à sa place (article 1686 alinéa 2 du code général des impôts).
Une exception existe-t-elle ?
Non. Ce texte ne prévoit aucune exception, même en cas de bonne foi du propriétaire.
Source : Le Particulier
Crédit renouvelable: le délai de forclusion

Crédit renouvelable et délai de forclusion :
L'établissement de crédit qui souhaite engager une action en paiement contre un emprunteur en raison d'impayés doit former son recours dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance (article L311-52 du Code de la consommation).
Le point de départ de ce délai apparaît, en pratique crucial pour l'établissement de crédit s'il veut avoir une chance de recouvrer sa créance dans la mesure où le délai de forclusion ne peut être ni suspendu ni arrêté.
Or, la détermination du point de départ du délai reste une difficulté majeure.
Il convient de rappeler que la Cour de cassation a déjà eu l'occasion d'affirmer qu'en matière de crédit renouvelable le délai biennal de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée (Cass. ass. plén., 6 juin 2003 : Bull. civ. 2003, ass. plén., n° 6).
De même, elle a jugé que le dépassement de crédit faisait également courir le délai biennal de forclusion (Cass. 1re civ. 30 mars 2005 : Bull. civ. 2005, I, n° 159).
Ces solutions ont été consacrées par le législateur lors de la réforme de 2010.
Désormais, l'article L311-52 du Code de la consommation dispose que l'évènement qui fait courir le délai « est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47. »
Deux arrêts récents de la Première chambre civile du 15 décembre 2011 ont été l'occasion pour la Cour de cassation de rappeler l'importance de la forclusion biennale de l'article L311-52 du Code de la consommation et d'apporter quelques précisions.
Dans sa première décision, la Cour de cassation apporte une solution aux difficultés soulevées par la clause de double montant.
Il convient de préciser qu'une clause de double montant prévoit, pour un même crédit renouvelable, un montant disponible et un montant maximum auquel l'emprunteur peut prétendre après un certain temps sans incident de paiement.
Il s'agit en fait pour l'établissement de crédit d'octroyer un second prêt sans avoir à passer par les exigences formalistes d'un tel acte.
Les faits :
En l'espèce, une société de crédit a consenti le 23 octobre 1998 à un particulier un crédit renouvelable d'un montant de 20.000 francs, mentionnant que le montant maximum du découvert global pouvant être autorisé était de 140.000 F (21.342,86 €). Le montant du crédit a été dépassé au mois de février 2003. Par acte du 10 juillet 2007, la société de crédit a alors assigné M. X. en paiement de la somme de 21.437,29 €.
La procédure :
La Cour d'appel de Besançon a rejeté la fin de non-recevoir, tirée de la forclusion biennale. Les juges du fond ont relevé que l'emprunteur n'avait jamais dépassé le montant maximal du découvert, soit 140.000 F ou 21.342,86 €, et que le délai de forclusion courant à compter du mois de janvier 2007, date du premier impayé non régularisé au regard de ce montant, n'était pas expiré à la date de l'assignation du 10 juillet 2007.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 311-37 du code de la consommation (devenu art L311-52) en précisant que « le simple rappel du plafond légal n'emportant pas substitution de celui-ci au montant du crédit octroyé, le dépassement de ce montant constituait, à défaut de restauration ultérieure, le point de départ du délai biennal de forclusion » (Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-25.598, P+B+I, D c/ Sté Médiatis : JurisData n°2011-028391).
Dans la seconde décision, la Cour de cassation est venu apporter des précisions sur l'influence d'un avenant sur le délai de forclusion.
Les faits :
En l'espèce, une société de crédit a consenti, en mars 2000, une ouverture de crédit utilisable par fractions d'un montant maximum de 140 000 francs, avec un découvert autorisé à l'ouverture du compte de 20 000 francs.
Par la suite, ce contrat a fait l'objet d'un avenant portant le montant maximum du découvert autorisé à 21 500 euros et la fraction disponible choisie à 15 000 euros.
Le banquier a sollicité de l'emprunteur le remboursement du solde du crédit mais le débiteur lui a opposé la forclusion biennale de l'article L311-37 du code de la consommation.
La procédure :
Les juges du fond ont écarté ce moyen de défense en considérant que l'avenant conclu le 23 mars 2005 avait repris le solde antérieur et s'était substitué au contrat initial.
Ainsi, ils ont considéré que peu importait que l'emprunteur ait dépassé le montant maximum du découvert autorisé dès le mois de décembre 2000.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation qui considère que « la seule souscription d'un tel avenant ne pouvait emporter renonciation à se prévaloir de la forclusion édictée par les dispositions d'ordre public de l'article L311-37 du Code de la consommation….. auxquelles il ne peut être renoncé que de façon non équivoque pourvu que le délai soit accompli ». (Cass. 1re civ., 15 déc. 2011, n° 10-10.996, P+B+I, R c/ Sté Laser Cofinoga : JurisData n° 2001-0283).
Source : Juritravail
Indivision et expulsion

Expulsion d'un occupant d'un bien indivis : mesure conservatoire
Pour mémoire :
L'article 815-2 du code civil indique que : « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l'indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l'égard des tiers. A défaut de fonds de l'indivision, il peut obliger ses coïndivisaires à faire avec lui les dépenses nécessaires ».
La Haute juridiction a réaffirmé que l'action tendant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un immeuble indivis et au paiement d'une indemnité d'occupation a pour objet la conservation des droits indivisaires et constitue à ce titre un acte conservatoire que tout indivisaire peut accomplir seul, sans avoir à justifier d'un péril.
Source : Juritravail. (Cour de cassation, 1re chambre civile, 4 juill. 2012, n° 10-21.967, n° 800 P + B + I)
Reprise du logement loué: nouveau décret

Bail d'habitation : décret modifiant la procédure de reprise des lieux abandonnés.
Pour mémoire :
La procédure de reprise des lieux loués en cas d'abandon par le locataire est régie par le législateur pour réduire considérablement les délais de la procédure d'expulsion (Loi n° 2010-1609, 22 déc. 2010, art. 4, I, 1° : JO, 23 déc.).
Elle est entrée en vigueur au 13 août 2011 avec la publication du décret d'application en date du 10 août 2011 (Décret n° 2011-945, 10 août 2011, art. 1er à 8 : JO, 12 août, rect. 10 sept.).
Cette procédure insérée dans la loi du 6 juillet 1989 reste applicable uniquement au bail d'habitation principale à l'exclusion des baux professionnels, commerciaux ou meublés pour lesquels les délais existants sont relativement plus courts (Loi n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 14-1, créé par L. n° 2010-1609, 22 déc. 2010, art. 4, I, 1° : JO, 23 déc.).
Le décret du 30 mai 2012 a modifié celui du 10 août 2011 en apportant une modification technique concernant le sort des biens ayant une valeur marchande.
En effet, initialement le texte réglementaire ayant instauré la procédure de reprise distinguait le sort réservé aux biens sans valeur marchande et de ceux paraissant au contraire présenter une certaine valeur.
Le sort de ces derniers ne pouvait pas être réglé par le juge chargé de constater la résiliation du bail et il fallait alors saisir le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble, comme en matière d'expulsion.
Apport du décret :
Désormais, le juge qui constate la résiliation du bail pour abandon peut autoriser la vente aux enchères des biens ayant une valeur marchande, si ceux-ci n'ont pas été récupérés dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance ayant constaté la résiliation du bail et contenant sommation d'avoir à les récupérer (Décret n° 2011-945, 10 août 2011, art. 3 et 5, modifié par le décret n° 2012-783, 30 mai 2012, art. 6 et depuis le 1er juin 2012 codifié sous les articles R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d'exécution).
Par voie de conséquence, la vente aux enchères ne pourra pas intervenir avant le délai de contestation de l'ordonnance rendue sur requête et l'huissier pourra à l'issue de ce délai, vider entièrement les lieux des biens qu'il contient.
Source : Juritravail
(Décret n° 2012-783, 30 mai 2012, art. 6 : JO, 31 mai)
Comment choisir un tuteur?

Le choix du tuteur par un majeur protégé doit être conforme à son intérêt.
Le droit civil français pose un certain nombre de règles afin d'assurer la protection effective de ceux qui ne peuvent pourvoir seuls à leurs intérêts, en raison d'une altération de leurs facultés intellectuelles.
Dans tous les cas, c'est l'intérêt de la personne à protéger qui doit guider la mise en place d'une mesure de protection et son organisation. Un des éléments importants de cette protection réside dans le choix du curateur ou du tuteur, un choix encadré par l'article 449 du Code civil.
Il résulte de ce texte qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger dans le cadre d'un mandat de protection future, « le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ».
L'alinéa trois de l'article précisant que le juge doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles ainsi que leur sincérité.
Ces dispositions résultent de façon claire de la nécessaire prise en compte des intérêts de la personne protégée ou à protéger.
Cependant, il est des situations où l'intérêt même de la personne à protéger nécessite de déroger à cette règle en nommant un curateur ou un tuteur professionnel dénommé mandataire judiciaire à la protection des majeurs (M.J.P.M).
Cette nomination peut parfois se faire contre la volonté de la personne protégée, comme l'illustre l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 29 mai 2012.
Dans le cas présent, le Juge des tutelles avait ordonné la mise sous curatelle puis sous tutelle d'une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer, et désigné un M.J.P.M. La personne protégée et son fils s'opposèrent à cette décision, demandant tous deux en appel à ce que le fils fût nommé tuteur. Cependant, malgré les liens forts unissant manifestement la mère et son fils, la Cour d'appel de Paris, sans remettre en cause la sincérité de ces liens, a confirmé la décision du Juge des tutelles. En dépit de la volonté exprimée par la personne protégée, la Cour d'appel a donc confirmé la désignation d'un tuteur extérieur au cercle familial.
Pourquoi une telle solution ?
En l'espèce, les juges ont constaté l'existence d'un conflit au sein de la famille entre le fils et ses propres enfants, et mis en évidence des transferts d'argent entre la mère et son fils, consécutifs aux difficultés économiques de ce dernier non résolues au jour de l'audience, susceptibles de mettre en péril la situation financière de la personne protégée. Les juges de la Cour d'appel ont ainsi considéré que la volonté exprimée par la personne protégée n'était pas conforme à son intérêt, dont elle n'avait pas conscience. Dès lors, si le juge doit prendre en compte les souhaits exprimés par le majeur protégé, il peut contourner cette intention si la protection de la personne et les circonstances de fait l'imposent objectivement.
Source Legavox. Me Montourcy. Cour d'appel de Paris – 29 mai 2012 (Pôle 2, Chambre 7)
Comment répartir un capital décès?
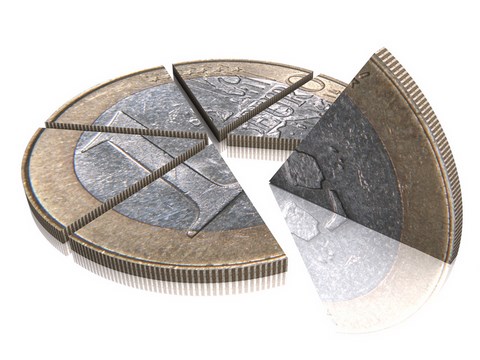
Répartition d'un capital décès
Les faits :
Un fils est décédé le 24 décembre 2001 en laissant pour lui succéder ses père et mère. En 2006, sa mère a été déclarée coupable de recel successoral sur la somme de 94 124,07 euros représentant le montant de la moitié devant revenir à son père du capital-décès qu'elle a intégralement perçu. Un litige s'est élevé entre eux s'agissant de la prise en compte de la somme recelée dans les opérations de partage.
La procédure :
Pour déterminer la part successorale de chacun des héritiers, l'arrêt (CA Agen, 15 sept. 2010) retient d'abord que l'actif successoral inclut le montant total du capital-décès litigieux, puis que la mère n'a aucun droit sur la somme recélée, enfin que celle-ci doit donc être déduite de la part de la mère dans l'actif successoral, tandis que la part du père doit être augmentée d'autant.
La Cour de cassation casse cet arrêt.
La somme recélée doit être distraite de l'actif successoral pour être exclusivement partagée entre les autres héritiers. Or la méthode de la cour d'appel aboutit à attribuer au seul cohéritier étranger au recel une somme supérieure de moitié à celle qui a été recélée (violation par la cour d'appel de l'article 792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006).
Source : LexisNexis. Cass. 1re civ., 6 juin 2012, n° 10-27.668 F-D.
Démembrement et répartition des revenus fonciers

Impact du démembrement sur les revenus fonciers
Les revenus issus de la location d'un bien immobilier démembré sont soumis à l'impôt sur le revenu (catégorie des revenus fonciers) de l'usufruitier : il est le seul redevable de cet impôt.
Il bénéficie donc également du mécanisme du déficit foncier le cas échéant.
Le nu-propriétaire ne percevant pas de loyers, il ne doit rien déclarer. Cependant, s'il effectue des grosses réparations dans le logement loué par l'usufruitier, il pourra les déduire de ses autres revenus fonciers (dans la limite de 25 000€ par an). Il pourra également déduire les intérêts d'emprunt du prêt contracté à cette occasion.
Notez que l'usufruitier est, comme un véritable propriétaire, redevable de la taxe foncière pendant toute la période d'usufruit. La taxe d'habitation est quant à elle due de manière classique par le locataire du bien.
Un retard de versement payant!

Un retard de versement payant !
Quelques années après le décès d'un souscripteur, la compagnie d'assurance vie vient informe la personne bénéficiaire du contrat. Pourtant, le bénéficiaire était désigné nominativement sur le contrat.
La compagnie doit-elle verser des intérêts capitalisés après la mort du souscripteur ?
Réponse :
Oui !
La rémunération du contrat est une obligation légale en vertu de l'article L.132-5 du Code des assurances. Cet article oblige les compagnies d'assurance vie à rémunérer le capital garanti pendant la période de recherche des bénéficiaires et ce depuis « le premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à réception des pièces nécessaires au règlement des capitaux. »
Le bénéficiaire peut demander à la compagnie un relevé détaillé des intérêts versés et inscrits au contrat.
Source : Mieux vivre
ISF et démembrement de propriété

ISF et démembrement de propriété
En cas de démembrement de propriété, c'est à l'usufruitier de déclarer au titre de l'ISF la valeur totale du bien dans son actif.
Mais qu'en est-il du passif ? Le nu-propriétaire peut-il déduire des sommes dans son passif ? Une décision récente de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation vient de rappeler la règle en la matière.
La décision :
Seules les dépenses de grosses réparations constituent une dette à la charge personnelle du nu-propriétaire, susceptible d'être déduite du patrimoine imposable de ce dernier. En l'espèce les dépenses de travaux de démolition et de reconstruction, de construction d'une piscine et d'aménagement du terrain constituaient des dépenses d'amélioration supportées par l'usufruitier et déductibles de son actif à l'ISF.
Source : Intérêts Privés. Cass. com. 12 juin 2012, n° 11-11424
Enfant parricide et succession

Droit des successions : le droit de l'enfant parricide
Dans un Arrêt en date du 28 mars 2012, la Cour de Cassation admet que l'enfant parricide déclaré irresponsable peut prétendre à la succession de ses parents.
Les faits :
En l'espèce et le 03 novembre 2000, M. Richard X... avait mortellement poignardé ses deux parents Henri et Sylvaine X.
Mis en examen, il avait bénéficié, par un Arrêt confirmatif de la Chambre de l'Instruction en date du 14 novembre 2002, d'une décision de non-lieu fondée sur les dispositions de l'article 122-1 du Code Pénal, les experts psychiatres ayant conclu que l'infraction était directement en relation avec la pathologie psychiatrique affectant l'auteur des faits, laquelle abolissait totalement son discernement et le contrôle de ses actes.
La procédure :
Par un Jugement en date du 12 juillet 2004, le Tribunal de Grande Instance avait ensuite condamné M. Richard X... à indemniser les ayants droit des victimes sur le fondement des Articles 489-2, ancien, et 1382 du Code Civil.
Par Jugement en date du 28 mai 2009, le Tribunal avait rejeté cette prétention et ordonné la liquidation et le partage des successions. M. Laurent X... avait alors formé appel de cette décision mais avait également soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
La Cour d'Appel de Nîmes avait confirmé le jugement de première instance dans son arrêt du 19 octobre 2010 au motif que l'indignité successorale suppose l'intention coupable. En outre, la Cour avait refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, au motif que l'Article 727 ancien du Code Civil n'avait pas été déclaré inconstitutionnel.
M. Laurent X. s'est alors pourvu en cassation en se fondant sur la violation de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans son Arrêt en date du 28 mars 2012, la Cour de cassation a rejeté ledit pourvoi et confirme ainsi la décision de la Cour d'Appel, notamment au motif :
"qu'ayant exactement relevé que l'indignité successorale suppose l'intention coupable, que la loi exige en posant comme condition à son prononcé que l'auteur du geste homicide ait été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle et constaté qu'un non-lieu à poursuivre M. Richard X. est intervenu sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal en raison de l'abolissement total de son discernement et du contrôle de ses actes.
C'est sans violer les dispositions de la Convention précitée et du premier protocole additionnel à celle-ci, invoquées par le moyen, que la cour d'appel a refusé d'appliquer à l'intéressé la sanction de l'indignité successorale".
Source : Juritravail
FICOBA, l'information des héritiers

Comptes bancaires et information des héritiers
Lors d'une succession, les services fiscaux étant tenus au secret professionnel, n'informe pas les notaires de la situation bancaire du défunt.
Ainsi, les héritiers n'ayant pas connaissance de l'adresse de l'établissement bancaire du défunt, se voit donc soumis à un redressement judiciaire pour une omission d'actifs avec remise partielle des pénalités.
C'est donc à ce sujet que fut interrogé le ministre du budget.
- Réponse ministérielle :
Le ministère du budget rappelle que bien que le notaire ne soit pas habilité à consulter les données bancaires du défunt, ce n'est pas le cas des héritiers qui ont accès aux informations en la qualité d'ayant droit (arrêt n°339147 du 29 juin 2011).
Source : JOAN 17 Avril 2012
Succession et absence de mobilier

Succession : l'absence de mobilier d'un défunt doit être prouvée.
Les faits :
Les héritiers d'un pensionnaire de maison de retraite déposent au centre des impôts une déclaration de succession établie avec l'aide d'un notaire. Estimant que le défunt n'avait pas de mobilier personnel, car en maison de retraite, la déclaration établie par ce professionnel ne mentionne aucune valeur pour les meubles. Le fisc envoie alors aux héritiers un redressement en intégrant dans la base taxable le forfait de 5%.
Les héritiers contestent cette notification de redressement.
La décision :
La cour d'appel saisie du litige leur donne raison en estimant que l'absence de mobilier appartenant au défunt a bien été prouvée. En effet, la sœur de ce dernier attestait que lors du départ en maison de retraite, sa maison avait été vidée des meubles et qu'un mandat de location avait été donné à une agence pour une location vide. Enfin, des tiers certifiaient avoir récupéré le mobilier gracieusement.
Dès lors, tous ces éléments prouvaient bien que le défunt n'avait plus de mobilier. Le fisc ne pouvait donc pas appliquer le forfait de 5% comme valeur à intégrer dans la base taxable.
Comment évaluer des meubles dans le cadre d'une succession ?
Il existe 3 modes d'évaluation en matière de droit de succession (Cf. art.764 CGI) :
- Le prix net obtenu lors d'une vente aux enchères,
- Ou l'estimation faite par un inventaire notarié,
- Ou, à défaut, du forfait de 5% de la valeur brute des autres biens du défunt.
Les textes ne prévoient donc pas la situation d'une absence de mobilier. L'administration admet cependant que les héritiers peuvent prouver l'absence de mobilier.
Ainsi, des réponses ministérielles ont notamment reconnu qu'il n'y a pas lieu à déclarer un mobilier quand le défunt résidait à l'hôtel !
Dans le cas vu plus haut, « la circonstance que le défunt était pensionnaire dans une maison de retraite, ne fournissait pas à elle seule la preuve de l'inexistence des meubles. »
Dès lors, il fallait fournir au fisc des documents ou invoquer des faits vérifiables comme la vente du domicile antérieur.
Source : mieux vivre
Succession et honoraires de généalogiste
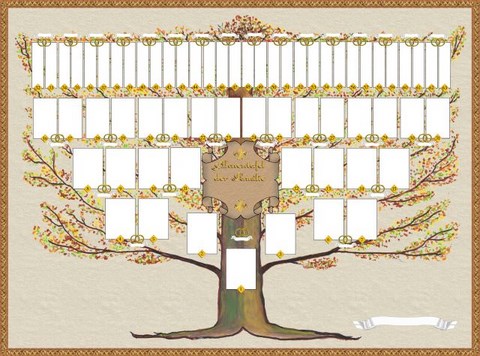
Sur le caractère excessif des honoraires du généalogiste au regard du service rendu
Les faits :
Une femme étant décédée sans postérité en 2005, une société de généalogie (la société) a été chargée par le notaire appelé à régler la succession de procéder à des recherches en vue d'identifier les héritiers.
Le 1er février 2007, la société a fait signer à un héritier un contrat de révélation de succession moyennant le versement d'une quotité de l'actif devant lui revenir et lui a révélé qu'il était l'héritier de la défunte. L'héritier a assigné la société en réduction des honoraires convenus.
La procédure :
Pour rejeter la demande de l'héritier et fixer les honoraires à la somme contractuellement prévue, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 7 oct. 2010) énonce que la société justifie de réelles démarches accomplies, que l'héritier ne prouve pas qu'il a eu connaissance de ses droits successoraux autrement que grâce à l'intervention de cette société, qu'il s'agissait d'une succession en ligne collatérale, au quatrième degré, dont rien ne permet de dire qu'il en aurait eu connaissance et que le calcul de la rémunération a été effectué en exacte application des stipulations contractuelles.
La Cour de cassation casse cet arrêt au visa de l'article 1134 du Code civil : La cour d'appel n'a pas recherché si, nonobstant la réalité des démarches accomplies, les honoraires réclamés par la société n'étaient pas excessifs au regard du service rendu
Source : Lexisnexis
Cass. 1re civ., 6 juin 2012, n° 11-10.052 F-D
Validité d'un compromis de vente

A qui incombe la charge de la preuve en cas d'annulation d'un compromis de vente ?
La Cour de Cassation indique "qu'après avoir relevé qu'il résultait des conclusions de l'expert que la pathologie mentale dont est atteinte Mme X... depuis l'âge de trente ans était de nature à la priver de tout discernement, qu'elle a connu une aggravation depuis 2004 et que cette pathologie existait dans la période immédiatement antérieure à la signature du compromis de vente et dans la période postérieure, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il incombait à M. Y... d'apporter la preuve que l'acte litigieux avait été souscrit par Mme X... dans un intervalle de lucidité".
Motivation d'une curatelle renforcée

Contrôle de motivation d'une curatelle renforcée
La Cour de cassation considère qu'une mesure de curatelle renforcée ne peut être maintenue par le juge qu'après avoir vérifié que le majeur concerné n'est pas "apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale".
Les faits :
En l'espèce, un majeur placé sous curatelle renforcée en 2007, et maintenu sous ce régime de protection en 2009 par le juge des tutelles de Bobigny, a formé un recours contre cette dernière décision.
La procédure :
Les juges du fond ont confirmé cette mesure de curatelle. Le tribunal de grande instance de Bobigny énonçant, par jugement du 17 décembre 2009, qu' "il ressort du rapport d'expertise du médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil que M. X. présente, d'une part, des problèmes physiques, surtout moteurs, liés à l'âge et à des problèmes vertébraux et, d'autre part, un état dépressif pour lequel il est suivi par un spécialiste et que, sans être incapable d'agir par lui-même, il a besoin d'être conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile".
Le majeur incapable s'est alors pourvu en cassation au moyen de l'article 472 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 relatif au régime de la curatelle renforcée.
La décision de la cour de cassation :
La Cour de cassation a cassé la décision des juges du fond dans un arrêt du 29 février 2012 au motif "qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X. était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé".
Source : Legalnews.
Exclusivité: enfin la solution d'épargne dédiée au handicap

Solution Epargne Handicap: c'est quoi?
Les personnes atteintes d'un handicap, leurs parents, leurs familles, leurs tuteurs ont plus que d'autre besoin de se préoccuper de l'avenir.
La Solution Epargne Handicap est un placement exclusivement réservé aux personnes atteintes d'un handicap ou d'une infirmité les empêchant de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
La Solution Epargne Handicap est la réponse la plus adaptée aux besoins des personnes en situation de handicap. Elle offre des solutions exclusives d'épargne et permet d'anticiper au mieux l'avenir mais aussi de garantir un confort financier.
Parce que votre handicap n'est pas une option, SOLUTION EPARGNE HANDICAP devient le premier contrat uniquement dédié aux personnes atteintes d'un handicap ou d'une infirmité, les empêchant de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
On trouve, aujourd'hui, sur le marché de nombreux contrats d'épargne handicap, pourtant dés les premiers clics, les mots qui apparaissent le plus sont « adapté » ou « option ». JD Consultant et Abripargne vous proposent une solution « dédiée » et « réservée » au monde du handicap.
Déduction de pension à une fratrie

Les pensions versées par un contribuable à sa fratrie ne sont pas déductibles de son revenu.
Le Conseil d'Etat rappelle que "la circonstance qu'un versement d'aliments à une personne autre qu'un ascendant soit susceptible de donner naissance, par transformation d'une obligation naturelle, à une obligation civile à laquelle son auteur pourrait être tenu sur le fondement des dispositions de l'article 1134 du code civil n'est pas de nature à permettre la déductibilité d'un tel versement sur le fondement de l'article 156 du CGI".
Elle rajoute que "le seul fait que l'administration n'ait pas remis en cause, lors d'un précédent examen de la situation fiscale de M. et Mme Cerovic, la déduction des pensions alimentaires que ceux-ci avaient versées au frère et à la soeur de M. Cerovic ne pouvait être regardé comme une prise de position formelle de l'administration sur la situation fiscale des intéressés au sens des dispositions des articles L 80 A et L 80 B du livre des procédures fiscales".
Source : Club.Patrimoine
Référence : CE 28 mars 2012 n° 323852, 10e et 9e s.-s., Cerovic
Lettre d'avocat et vente parfaite
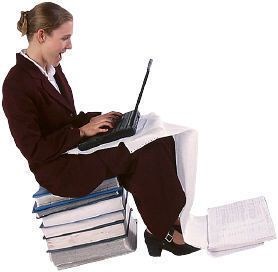
La lettre d'avocat rend la vente d'un bien immobilier ferme et parfaite
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 09/05/2012, au sens du Code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'ont été convenus la chose et le prix, même si la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé.
Pour la Cour de cassation, une lettre d'avocat comportant l'ensemble des informations et mentions relatives à l'acceptation de l'offre au prix proposé par l'acquéreur, constitue un document permettant de qualifier la vente parfaite.
Dès lors, l'acquéreur est en droit d'exiger la vente forcée si l'un des vendeurs entend se rétracter.
Source : club patrimoine
Les conséquence d'un défaut ou d'un retard de déclaration IR

Rappel des pénalités en cas de retard ou défaut de déclaration
"En 2012, les dates limites de télé déclaration sont fixées en fonction du département de résidence, soit : le 7 juin (départements 01 à 19), le 14 juin (départements 20 à 49 avec la Corse), et le 21 juin (départements 50 à 974). En cas de défaut ou de retard dans la souscription de déclaration, et sauf motif légitime (ex : hospitalisation), l'administration est en droit de sanctionner cette infraction par l'application d'un intérêt de retard. Ce sont les articles 1727 et 1728 du Code général des impôts qui prévoient que ces infractions sont sanctionnées par le cumul de l'intérêt de retard de 0,40% par mois et d'une majoration de 10%.
Le taux de la majoration est porté :
- à 40% lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d'une première mise en demeure ;
- à 80% lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les 30 jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure.
En cas d'insuffisances, d'omissions ou d'inexactitudes relevées dans la déclaration de l'impôt sur le revenu, l'administration fiscale est en droit de procéder à un redressement fiscal, après contrôle, sur lequel s'applique des pénalités. Les infractions relatives au recouvrement de la taxe donnent lieu à l'application, en sus de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du Code général des impôts, d'une majoration de 10% du montant des sommes dont le versement a été différé."
Source : net-iris
Contestation d'une assurance vie
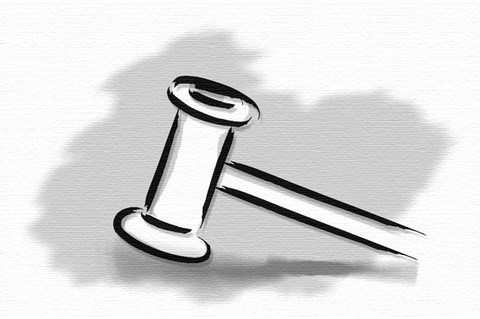
Est-il possible de contester la clause bénéficiaire un contrat d'assurance vie ?
Légalement, il n'existe aucun recours permettant de contester directement la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.
Aussi, c'est sur le seul terrain des primes versées dans le cadre du contrat qu'un recours peut être formé. En effet, la loi prévoit la possibilité d'un recours lorsque les primes versées au contrat d'assurance-vie s'avèrent exagérées compte tenu des facultés de l'assuré (Article L132-13 du code des assurances).
Peuvent former un tel recours toute personne physique ou morale ayant intérêt à former un recours contre des primes manifestement exagérées est en droit de le faire.
Souvent, ce sont les héritiers de l'assuré défunt qui sont à l'initiative de la procédure.
Ces derniers doivent saisir le Tribunal de Grande Instance du lieu où se règle la succession de l'assuré défunt. Il revient à la personne physique ou morale formant le recours de prouver le caractère manifestement exagéré des primes versées.
Pour cela, il est nécessaire de considérer le montant des primes versées au contrat d'assurance au regard:
- de l'ensemble des revenus de l'assuré défunt ;
- de l'ensemble du patrimoine de l'assuré défunt ;
- de l'utilité du montant des primes versées par rapport à la situation de l'assuré défunt.
S'il s'avère que les primes versées sont manifestement exagérées, tout ou partie de ces primes est réintégré dans le patrimoine servant de base au calcul de la succession.
Source : Le Figaro Patrimoine
pension alimentaire non déductible

Non déductibilité d'une pension versée à un collatéral
Les pensions versées par un contribuable à ses frères et sœurs ne sont pas déductibles du revenu global.
Dans un récent arrêt (CE, 28.03.2012, n° 323852), le Conseil d'Etat s'en est tenu à la loi : les articles 205 à 211 du Code civil n'établissant aucune obligation alimentaire entre collatéraux, la déduction de la pension alimentaire prévue par l'article 156 du Code général des impôts, qui renvoie à ces articles, n'est pas possible.
Ce principe s'applique quand bien même les tribunaux, sur le plan civil et en dehors de toute obligation légale, ont reconnu l'existence d'une obligation naturelle fondée sur le devoir moral d'entraide, notamment entre un frère et une sœur, entre concubins ou entre ex-époux.
Source : Patrimoine.com
Troubles du voisinage et mesure de protection

Troubles du voisinage et mesure de protection : Quelles conséquences ?
L'article 426 du Code civil réaffirme le principe de la protection du logement et des objets à caractère personnel de la personne vulnérable.
L'objectif poursuivi est de laisser à la disposition de la personne protégée son logement et les meubles dont il est garni, aussi longtemps qu'il est possible, c'est-à-dire tant que l'état de l'intéressé autorise son maintien ou son retour dans son domicile.
Cet article protège expressément la résidence principale mais également la résidence secondaire (ce dernier point est une nouveauté de la loi du 05 mars 2007).
Rappelons que cette protection du logement ne joue qu'à l'égard de la personne chargée d'administrer les biens du majeur (MJPM, curateur, tuteur) et ne crée aucune insaisissabilité vis-à-vis des tiers.
De plus, le propriétaire d'un bien loué peut toujours résilier le contrat de bail en cas d'inexécution des obligations du majeur protégé locataire.
C'est ce que vient de rappeler la Cour d'appel de PARIS dans un arrêt du 8 décembre 2011 à propos de la résiliation du bail d'une personne sous curatelle renforcée
Rappel des obligations du locataire :
Conformément à l'article 7 b de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Il en résulte que la méconnaissance de cette obligation doit être sanctionnée.
La personne protégée et son curateur, soutiennent que le logement d'une personne protégée doit être conservé aussi longtemps que cela est possible conformément à l'article 426 du code civil et qu'au surplus, depuis la décision rendue, il n'existe aucune nouvelle plainte.
Le bailleur soutient que les faits sont caractérisés et justifient la résiliation du bail avec toutes ses conséquences et que l'article 426 du code civil est en l'espèce, inopérant.
La décision des juges :
En première instance, le juge a justement constaté que les nombreuses attestations versées par le bailleur et même une pétition établissaient que la personne sous curatelle occasionnait de nombreux troubles de voisinage aux autres locataires et à la gardienne de l'immeuble tels que, à de nombreuses reprises, tant le jour que la nuit des hurlements et l'écoute de la musique très fort.
Il a également fait état de l'agressivité de ce dernier envers ses voisins (sonnettes arrachées, injures, frappe à toutes les portes).
Il a observé également que l'intervention de tiers tels que bailleur et la médiatrice de la ville de Paris n'avaient pas suffi à faire cesser les troubles et que dans ces conditions la législation relative au domicile de la personne protégée ne pouvait pas s'appliquer.
La cour d'appel constate que les faits circonstanciés ont été établis entre mai 2008 et octobre 2009 mais que depuis l'audience devant le premier juge de novembre 2009 aucune autre plainte n'est versée par le bailleur.
En conséquence et pour ce motif uniquement, le jugement qui a résilié le bail et ordonné l'expulsion du locataire sous curatelle a été infirmé, car les troubles de voisinage n'avaient pas perduré.
A contrario, si ces nuisances avaient persisté, la Cour d'appel aurait confirmé la résiliation du bail et l'expulsion du locataire fauteur de trouble, fusse-t-il sous curatelle renforcée.
Source: CA Paris, 3e ch., 8 déc. 2011: JurisData n° 2011-027924/Me CANINI.
Lettre d'avocat et vente parfaite

La lettre d'avocat rend la vente d'un bien immobilier ferme et parfaite
Selon un Arrêt de rejet de la Chambre sociale de la Cour de cassation rendu le 09/05/2012, au sens du Code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'ont été convenus la chose et le prix, même si la chose n'a pas encore été livrée ni le prix payé.
Pour la Cour de cassation, une lettre d'avocat comportant l'ensemble des informations et mentions relatives à l'acceptation de l'offre au prix proposé par l'acquéreur, constitue un document permettant de qualifier la vente parfaite.
Dès lors, l'acquéreur est en droit d'exiger la vente forcée si l'un des vendeurs entend se rétracter.
Validité d'un compromis de vente

A qui incombe la charge de la preuve en cas d'annulation d'un compromis de vente ?
La Cour de Cassation indique "qu'après avoir relevé qu'il résultait des conclusions de l'expert que la pathologie mentale dont est atteinte Mme X... depuis l'âge de trente ans était de nature à la priver de tout discernement, qu'elle a connu une aggravation depuis 2004 et que cette pathologie existait dans la période immédiatement antérieure à la signature du compromis de vente et dans la période postérieure, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il incombait à M. Y... d'apporter la preuve que l'acte litigieux avait été souscrit par Mme X... dans un intervalle de lucidité".
vers une Hausse de la Fiscalité
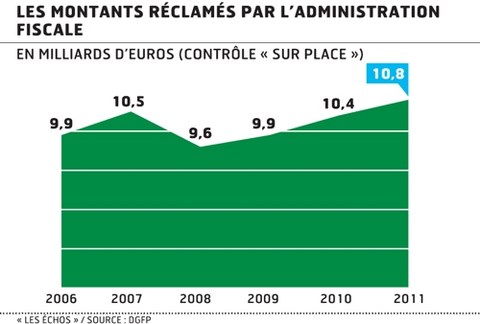
Vers une hausse de la fiscalité
Concernant l'ISF :
Le PS veut rétablir l'ancien barème dès cette année, ce qui apportera 2,3 milliards supplémentaires à l'Etat.
Mais il ne sait pas encore s'il fera payer les plus hauts patrimoines en deux temps (juin et septembre) ou en un seul.
C'est pour les patrimoines supérieurs à 1,3 million d'euros que tombe la mauvaise nouvelle. Eux qui devaient bénéficier d'une forte baisse du barème, cette année, devraient finalement en être privés.
Pour eux, l'ancien barème sera rétabli (de 0,55 % à 1,8 %) cet été. Ils seront non plus taxés au premier euro, mais sur la valeur de leur patrimoine excédant 800.000 euros. Premiers visés : les quelque 6.000 ménages détenant de très hauts patrimoines (supérieurs à 7,5 millions d'euros), qui verront leur taux d'imposition tripler (de 0,5 % à 1,65 %, voire à 1,8 %) sans pouvoir prétendre, comme avant, au bouclier fiscal. A défaut, le PS a néanmoins l'intention de rétablir le plafonnement Rocard, garantissant que les impôts ne représentent pas plus de 85 % des revenus.
Concernant les droits de succession :
Le régime des droits de succession sera aussi modifié dès cet été.
La hausse des droits de succession s'appliquera, elle aussi, dès le vote du collectif budgétaire, cet été. La gauche en attend 1,6 milliard d'euros supplémentaires en année pleine. L'exonération pour le conjoint survivant ne bougera pas. Mais, dans les autres cas, l'exonération sera rabaissée de 159.325 à 100.000 euros.
Bail de location et RSA

Les titulaires du RSA bénéficient du préavis réduit d'un mois.
La loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit (article 12) a tiré les conséquences de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA) dans le domaine des rapports locatifs en donnant la faculté aux locataires bénéficiaires du RSA de donner congé à leur bailleur avec un délai de préavis réduit à un mois, faculté dont disposaient les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
Voir http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-68424QE.htm
Référence : Réponse ministérielle à la question n°68424 parue au JO du 24/04/12
Source : Club Patrimoine
Dépôt de déclaration IR ou ISF et le Notaire

Les notaires autorisés à souscrire les déclarations de revenus et d'ISF après décès
1/ L'article 53 de la quatrième loi de Finances rectificative pour 2010 a simplifié les formalités administratives des héritiers d'une personne décédée, en prolongeant, au bénéfice des ayants droit d'un contribuable décédé, le délai de production de la déclaration des revenus imposables à l'impôt sur le revenu (IR).
Désormais, les ayants droit tenus d'effectuer la déclaration d'impôt sur le revenu au titre des revenus du défunt, peuvent le faire dans le délai de droit commun (et non plus dans le délai de 6 mois à compter du décès), prévoit l'article 204 du Code général des impôts.
Si la succession n'est pas liquidée au moment où les déclarations fiscales doivent être effectuées, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit.
2/ La rédaction de l'article 885 W, relative à la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), est également modifiée afin de tenir compte de la souplesse introduite ci-dessus lorsque la succession n'est pas liquidée.
La déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune doit être produite par les ayants droit du défunt dans les 6 mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit, si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration.
Lorsqu'ils ont accepté à la demande des ayants droit d'assumer les obligations déclaratives, les notaires sont passibles des pénalités proportionnelles pour absence de dépôt dans le délai légal des déclarations d'ISF et d'IR du défunt (article 1840 C du Code général des impôts).
Ces dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 en matière d'impôt sur le revenu et à compter du 1er janvier 2011 en matière d'impôt de solidarité sur la fortune.
Commentaire :
S'agissant de la nouvelle disposition permettant aux notaires de souscrire les déclarations fiscales après le décès, la portée pratique devrait être limitée à certains cas particuliers.
En effet, lorsque le notaire établira la ou les déclarations d'impôts, il se substituera aux héritiers et donc endossera la responsabilité du dépôt.
Néanmoins, la possibilité existe dorénavant et est prévue dans les textes.
Pour plus d'information, la dernière circulaire :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2012/5fppub/textes/5b1312/5b1312.pdf
Nouveau décret: MJPM hospitaliers

Gestion des biens : mandataire judiciaire préposé d'une personne morale de droit public
Le décret n° 2012-663 du 4 mai 2012 tire les conséquences des modifications introduites par la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique, codifiées notamment aux articles 427 et 451 du Code civil.
Il définit, à compter du 7 mai 2012, le rôle du comptable public dans la gestion des fonds des personnes dont la mesure de protection est confiée à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs relevant d'une personne morale de droit public.
A ce titre, le décret distingue selon qu'il y a gestion des biens des personnes qui sont ou ne sont pas soignées ou hébergées en établissement public de santé ou social et médico-social.
Source
D. n° 2012-663, 4 mai 2012 : JO 6 mai 2012
AAH, Augmentation dès Avril 2012

Allocation aux adultes handicapés : 759,98 euros depuis le 1er avril 2012.
Le montant maximum de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est porté à 759,98 euros par mois à compter du 1er avril 2012 (contre 743,62 euros au 1er septembre 2011). C'est ce que précise la fiche pratique concernant l'AAH en ligne sur le site du ministère des solidarités et de la cohésion sociale.
L'AAH a pour objet de garantir un revenu minimum aux personnes handicapées pour qu'elles puissent faire face aux dépenses de la vie courante. L'allocation est attribuée à partir d'un certain taux d'incapacité, sous réserve de remplir des conditions de résidence, de nationalité, d'âge et de ressources. Son montant varie en fonction des ressources de la personne handicapée. Ainsi, une personne ne disposant d'aucune ressource peut percevoir le montant maximum de l'AAH.
La demande d'allocation doit être faite auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH), qui aidera la personne et la renseignera sur ses autres droits éventuels.
Source : Service-public.fr
Parricide et succession

L'enfant parricide peut prétendre à la succession de ses parents
Un enfant a mortellement poignardé ses deux parents en 2000. Mis en examen, il a bénéficié d'une décision de non-lieu, les experts psychiatres ayant conclu que l'infraction était directement en relation avec la pathologie psychiatrique affectant l'auteur des faits, laquelle abolissait totalement son discernement et le contrôle de ses actes. Il a été condamné à indemniser les ayants-droits des victimes. En 2008, il a assigné son frère en liquidation et partage des successions de leurs parents. Ce dernier a alors soutenu que son frère parricide n'avait aucun droit dans les successions et devait être frappé d'indignité successorale sur le fondement de l'article 727 ancien du Code civil. Sa prétention a été rejetée par le tribunal, qui a ordonné la liquidation et le partage des successions. Il a donc fait appel et a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
La cour d'appel (CA Nîmes, 19 oct. 2010) a confirmé le jugement et dit qu'il n'y avait pas lieu à question prioritaire de constitutionnalité.
La Cour de cassation approuve la cour d'appel :
- d'avoir refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, l'article 727 ancien du Code civil n'ayant pas été déclaré inconstitutionnel,
- d'avoir refusé d'appliquer la sanction de l'indignité successorale. Celle-ci suppose une intention coupable, que la loi exige en posant comme condition à son prononcé que l'auteur du geste homicide ait été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle. Or en l'espèce, un non-lieu était intervenu en raison de l'abolissement total du discernement du fils et du contrôle de ses actes.
Source : Lexisnexis
Cass. 1re civ., 28 mars 2012, n° 11-10-393, F-D
Location et régularisation des charges

Le bailleur engage sa responsabilité en ne réclamant pas la régularisation annuelle des charges à son locataire.
Les faits :
Plusieurs courriers avaient été adressés au bailleur par la locataire par l'intermédiaire de sa fille et de son gendre, ce dernier étant caution solidaire, s'inquiétant de n'avoir reçu aucun état des charges et donc aucun état récapitulatif débiteur ou créditeur de sa situation. Aucune réponse du bailleur à ces courriers. Cinq ans après, le bailleur demande à la locataire une régularisation des charges dues au titre des cinq années écoulées, et réclame un rappel d'indexation et une régularisation de loyers.
La décision de la cour de cassation :
La Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant qu'en l'état de l'obligation légale d'une régularisation annuelle des charges pesant sur le bailleur, la réclamation présentée sur une période écoulée de cinq ans de plus du triple de la somme provisionnée, si elle est juridiquement recevable et exacte dans son calcul est, dans ce cas, déloyale et brutale et constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat.
Il en résulte que le bailleur a, par son comportement, engagé sa responsabilité envers la locataire et sa caution solidaire pour le dommage occasionné.
Source : lexisnexis
Cass. 3e civ., 21 mars 2012, n° 11-14.174, FS-P+B : JurisData n° 2012-004884
Exonération des assurances vie

Exonération d'impôt sur le revenu pour les assurances-vie dont le bénéficiaire est licencié
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI), les produits des bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie sont exonérés d'impôt sur le revenu, quelle que soit leur durée, lorsque le rachat ou le dénouement du bon ou du contrat résulte notamment du licenciement du bénéficiaire des produits ou de son conjoint ou partenaire à un pacte civil de solidarité (PACS)*.
L'exonération ne s'applique que si l'intéressé s'est trouvé privé d'emploi pour une raison indépendante de sa volonté et a été inscrit comme demandeur d'emploi au Pôle emploi.
Ce qui implique que le bénéficiaire des produits ou son conjoint qui a été licencié et qui est inscrit comme demandeur d'emploi, ne doit pas avoir retrouvé un emploi avant la fin de la période au titre de laquelle il prétend à cette exonération, sous peine d'en perdre le bénéfice.
L'exonération d'impôt sur le revenu s'applique à la totalité des produits perçus par le bénéficiaire au titre du bon ou du contrat jusqu'à la fin de l'année qui suit celle du licenciement (instruction administrative publiée au Bulletin officiel des impôts le 31 décembre 1984 sous la référence 5 I-3-84 n° 10).
* les autres cas d'exonération de cet article : « (…) ou de sa mise à la retraite anticipée ou de son invalidité ou de celle de son conjoint correspondant au classement dans la deuxième ou troisième catégorie prévue à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. »
Référence : Réponse ministérielle à la question n°97715 parue au JO du 03/04/1. Club Patrimoine.
Les héritiers continuent les actions judiciaires

Les héritiers doivent continuer les actions intentées par le défunt
Les faits :
Un père de famille est décédé en 2003, laissant à sa succession sa veuve et ses deux enfants. Quelques mois avant le décès, le couple avait assigné une SCI en annulation et résolution de la vente d'un immeuble. Un des enfants a repris l'instance pendante, et, avec sa mère, a assigné son frère aux mêmes fins.
La procédure :
Pour décider que l'action intentée par l'enfant et sa mère est irrecevable, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 4 mars 2010) se fonde sur les dispositions de l'article 815-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et relève l'absence de consentement de tous les indivisaires.
La décision :
La Cour de cassation casse cet arrêt.
En statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que les demandeurs étaient héritiers désignés par la loi, et, comme tels, chacun saisi de plein droit de l'action introduite par le père, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 724 du Code civil.
Source : Lexisnexis
Cass. 1re civ. 28 mars 2012, n° 10-30.713, F P+B+I
Retraite: date des versements

Versement des retraites le 1er du mois : Xavier Bertrand ne "lâche pas l'affaire"
Le ministre du Travail, Xavier Bertrand, a confirmé sa promesse de faire verser les pensions de retraite le 1er de chaque mois. "Je ne lâche pas l'affaire", a-t-il déclaré la semaine dernière au micro de BFM-TV/RMC.
Le ministre s'est félicité que, depuis 2010, on avait gagné trois jours dans le paiement des pensions : "aujourd'hui on est au 8, je suis en train de voir comment on passe de la deuxième semaine à la première semaine, et de la première semaine au début".
Il a indiqué que la Caisse des dépôts pourrait être mise à contribution afin de pouvoir "grignoter encore un jour ou deux" : "l'informatique suivra, mais en attendant il faut que nous puissions emprunter tous les mois pour ne pas demander aux entreprises de cotiser et de verser plus tôt".
Source : Patrimoine.com
Pensions alimentaires déductibles

Pensions alimentaires déductibles : plafonds 2012 (30/03/12)
Compte tenu de la non indexation du barème de l'impôt sur le revenu pour l'année 2012, les limites de déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs pour l'imposition des revenus de 2011 sont identiques à celles retenues pour l'imposition des revenus de l'année 2010, soit 5 698 € (ou 11 396 € dans le cas où le parent justifie qu'il participe seul à l'entretien du jeune ménage fondé par son enfant).
Par ailleurs, les avantages en nature consentis aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable peuvent sous certaines conditions être déduits du revenu global dans une limite qui est également inchangée : 3 359 €.
Enfin, la loi ne fixe pas de limite chiffrée pour la déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants au titre de l'obligation alimentaire. Dans ce cas, le montant de la pension déductible est déterminé en fonction des besoins de son bénéficiaire et des ressources de celui qui la verse.
Source : Patrimoine. com
Testament et contestation de la signature
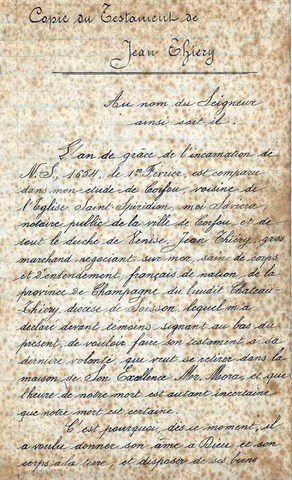
Testament : quand la signature est contestée, le juge doit demander tous documents utiles
Les faits :
Une femme décède en 1999, laissant comme seuls héritiers un neveu et une nièce. Quelques mois plus tard, est déposé entre les mains d'un notaire un testament olographe, daté du 28 juin 1997, instituant les deux filles de sa nièce légataires universelles : elles sont alors envoyées en possession par une ordonnance du juge. En 2007, le neveu les a assignées pour voir annuler le testament, dont il déniait l'écriture et la signature.
La procédure :
La cour d'appel (CA Toulouse, 14 sept. 2010) a cru pouvoir rejeter sa demande : l'héritier ne rapporte pas la preuve de circonstances rendant le testament suspect, et la simple dénégation de l'écriture ne peut suffire à justifier l'organisation d'une expertise.
La Cour de cassation casse cet arrêt. Il appartenait à la cour d'appel, avant de trancher la contestation, d'enjoindre aux parties de produire tous documents utiles à comparer à l'écrit contesté, et au besoin, d'ordonner une expertise.
(Violation par la cour d'appel de l'article 1324 du Code civil)
Source :LexisNexis
Le domicile d'une gouvernante

Particulier employeur : libre choix du domicile du salarié
Le principe :
Toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Attention, donc, aux clauses insérées dans un contrat de travail.
Les faits :
Une salariée a été engagée à compter du 23 janvier 1999 par une association en qualité d'employée gouvernante, ses fonctions consistant à veiller au confort physique et moral des majeurs sous tutelle ou curatelle, logés par l'association dans un appartement.
La durée de travail de la salariée était fixée à 35 heures dans les plages horaires obligatoires de 8h00 à 12h30 et 18h00 à 19h30, sur 5 jours à raison de 6 heures par jour et d'une demi-journée de 3h30, outre un temps de 6h30 destiné tous les mois à participer aux activités, réunions, visites psychiatres, accompagnement, sans astreintes.
La salariée a été licenciée par lettre du 30 janvier 2007 pour avoir méconnu l'obligation contractuelle de résider à proximité de son lieu de travail.
La procédure :
Pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel de Reims (CA Reims, 31 mars 2010, n° 09/00874) a retenu « qu'en s'éloignant de son lieu de travail de 20 km, soit un parcours de 25 minutes en véhicule personnel, la salariée n'était plus en mesure de respecter l'obligation de résidence insérée dans le contrat de travail lui imposant d'avoir son domicile à moins de 200 mètres de son lieu de travail qui est une condition substantielle de son contrat de travail et que cette obligation est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'association et des personnes auprès desquelles la salariée a pour objet d'intervenir et proportionnée, compte tenu de la nature de l'emploi occupé, au but recherché ».
La cassation est prononcée, au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail.
Après avoir rappelé que toute personne dispose de la liberté de choisir son domicile et que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, la chambre sociale retient que les juges d'appel ont violé les textes susvisés, en statuant « par des motifs impropres à établir que l'atteinte au libre choix par la salariée de son domicile était justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but recherché ».
Source: Cass. soc., 28 févr. 2012, n° 10-18.308, FS-P+B, Mme C. c/ Association Maison départementale de la famille : JurisData n° 2012-003036
Logement en indivision et paiement de la taxe foncière
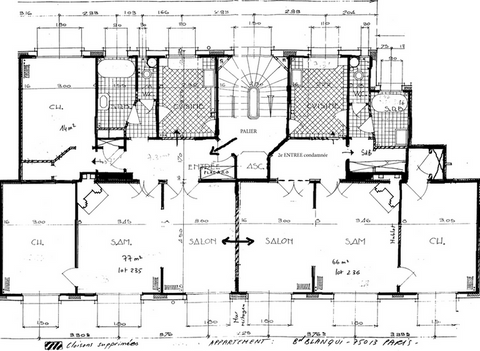
Comment payer la taxe foncière d'un bien indivis ?
Pour un bien en indivision, l'Administration fiscale émet un avis d'imposition au nom des indivisaires.
S'ils sont au maximum 3, ils sont nommément désignés sur l'avis d'imposition. Sinon, c'est le nom l'indivisaire dont la part est prépondérante qui figure sur l'avis d'imposition avec la mention « et consorts » ou « et copropriétaires ».
Celui qui s'acquitte de la taxe auprès du Fisc doit ensuite faire son affaire de la répartition de la charge entre les indivisaires et se faire rembourser la part réglée pour le compte des autres (DB 6C421).
Source : Intérêts privés
Dépôt de garantie: tout savoir

Retenue sur dépôt de garantie : c'est au bailleur de prouver qu'il a raison.
Les faits :
Après son départ du logement qu'elle louait, une locataire qui avait versé 900 € au titre du dépôt de garantie s'est vu restituer la seule somme de 293,23€ !
S'estimant lésée, elle a saisi la juridiction de proximité pour obtenir remboursement de l'intégralité de la somme déposée, en vain.
La procédure :
Pour écarter la demande de l'ancienne locataire, le juge a retenu qu'elle n'avait pas justifié en quoi le bailleur aurait dû lui rendre les 606,66 € manquant. Une inversion de charge de la preuve qui n'a pas échappé à la Cour de Cassation, laquelle a rappelé « qu'il incombe au bailleur de justifier des sommes lui restant dues qui viendraient en déduction du dépôt de garantie ».
Commentaire :
Le propriétaire d'un logement loué est tenu de restituer le dépôt de garantie dans un délai de 2 mois à compter de la remise des clés par le locataire.
Il peut néanmoins retenir tout ou partie du dépôt de garantie, à condition d'être en mesure de le justifier, comme le prévoit l'article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
Cour de Cassation, 3eme chambre civile, 15/02/2012 n° 11-13014
Source : Intérêts Privés
Déclaration de succession: la taxation d'office

Succession : dépôt d'une déclaration incomplète
Le dépôt d'une déclaration de succession ne fait pas obstacle à l'application de la procédure de taxation d'office lorsque le document déposé s'avère incomplet.
La cour d'appel suivie de la cour de cassation confirme la taxation d'office aux motifs que les héritiers, légataires ou donataires sont tenus de souscrire une déclaration détaillée et signée comportant une affirmation de sincérité.
Or la déclaration déposée par le notaire ne comportait ni signature des parties, ni affirmation de sincérité. Elle indiquait uniquement des informations relatives à la défunte et à ses héritiers ainsi qu'une liste d'éléments d'actif et de passif successoral sans préciser leur qualification de biens propres ou communs
Cass. Com. 14 février 2012, n° 11-10765
Source : revue fiduciaire.
Bien des mineurs et établissements bancaires

Responsabilité des banques dans le cadre des biens des personnes mineures
S'agissant des sommes déposées sur un compte ouvert au nom de l'enfant, seuls ses représentants légaux peuvent procéder à un retrait jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 16 ans.
Aucune autorisation préalable n'est nécessaire.
Faisant application des principes rappelés ci-dessus, la Cour de cassation a jugé que les établissements bancaires ne sont pas responsables s'ils répondent aux demandes des administrateurs légaux.
Toutefois, dans certains cas particuliers, afin de protéger les intérêts des mineurs et, notamment des mineurs victimes, le juge des tutelles, chargé d'une mission générale de surveillance des administrations légales, a la possibilité de faire échapper la totalité ou certains biens à cette jouissance.
Par ailleurs, toujours dans le cas de l'administration légale, l'article 391 du code civil permet au juge d'ouvrir la tutelle sur les biens du mineur pour cause grave, ce qui met fin à la jouissance légale. Il appartient alors au conseil de famille de prendre les décisions et de donner au tuteur les autorisations nécessaires pour la gestion des biens du mineur.
Référence : Réponse ministérielle à la question n°116834 publiée au JO du 28/02/12
Viager, quels droits pour les héritiers?

Viager : Quels droits pour les héritiers ?
Le viager est un contrat aléatoire, puisqu'il s'appuie sur la durée de vie du vendeur (le crédirentier, qui perçoit la rente viagère en échange du logement qu'il vend en viager).
Le viager peut être occupé ou libre :
- Occupé : le crédirentier réside toujours dans le logement,
- Libre : le bien est laissé à la disposition du débirentier.
Dans ce dernier cas, le montant de la rente viagère est alors plus important que dans le premier.
Tant que le crédirentier est en vie, l'acheteur (le débirentier) doit lui verser la rente fixée dans l'acte de vente en viager.
Lorsque le crédirentier est marié, la rente peut être « réversible » : si Monsieur décède, elle doit être versée à Madame jusqu'à son décès. Si l'acheteur décède avant le vendeur, la charge de la rente passe à ses héritiers ! Ils doivent continuer de payer aux conditions prévues. La seule solution pour y échapper est de renoncer à la succession.
Source : Intérêts privés
Annuaire des médiateurs des banques

Annuaire des médiateurs des banques
Pour une bonne information des clients, la Fédération Bancaire Française met à disposition le répertoire des adresses de saisine des médiateurs établi par le Comité de la médiation bancaire.
Le recours à ce service, gratuit pour le client, intervient après épuisement des deux premiers niveaux de dialogue entre le client et sa banque (agence puis service relation clientèle).
Délai de réclamation d'une assurance vie

ASSURANCE-VIE : Délai de réclamation du bénéfice au décès de l'assuré.
Au décès de l'assuré, le bénéficiaire de l'assurance a 10 ans pour réclamer les sommes qui lui sont dues.
Les faits :
En l'espèce le mari décède en 1993 et avait souscrit une assurance-vie au profit de sa femme. Elle fait plusieurs courriers entre 1993 et 1994 à son assureur afin de réclamer les dites sommes.
En 2003, un avocat demande des pièces à l'assureur. La femme n'assigne l'assureur en paiement de la garantie décès, d'une valeur de 300 000€, qu'en 2006.
La décision :
Elle est déboutée au motif que le délai était prescrit, le courrier de l'avocat de 2003 ne demandait pas le paiement des sommes.
Cour de cassation, 2ère chambre 9r février 2012, n°10-20357.
PEL et prélèvements sociaux

PEL : les prélèvements sociaux désormais acquittés "au fil de l'eau".
Pour les plans d'épargne logement ouverts depuis le 1er mars 2011, les prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social + contributions additionnelles) sont désormais dus annuellement lors de chaque inscription en compte des intérêts, et cela dès la première année du plan.
Pour l'épargnant, cet aménagement, instauré par la 4e loi de finances rectificative pour 2010, a pour effet de réduire chaque année le montant des intérêts capitalisés et donc le rendement de son plan.
Afin de tenir compte des situations dans lesquelles la rémunération des PEL peut être révisée à la baisse (résiliation d'un PEL dans les deux ans de son ouverture ou transformation en compte d'épargne logement - CEL - à la demande du titulaire), l'administration fiscale, qui vient de commenter la mesure dans une récente instruction (5I-1-12), précise qu'un mécanisme de restitution des prélèvements sociaux payés "au fil de l'eau" est prévu.
Source : Patrimoine. com
Pension alimentaire et APL

La pension alimentaire des enfants peut entraîner la fin des APL
Interrogée sur les ressources financières des personnes âgées dépendantes, hébergées en établissement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale a précisé que les pensions reçues en exécution des obligations alimentaires (article 205 du code civil) sont considérées comme une source de revenus.
A ce titre, les pensions alimentaires sont imposables.
Elles sont prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement des personnes âgées résidant en maison de retraite.
Cette pension alimentaire est donc susceptible de conduire au dépassement du revenu au-delà duquel l'APL n'est plus attribuée.
Réponse ministérielle, Assemblée nationale, n°99024, 24 janvier 2011
Source : revue fiduciaire
Avez vous pensé à l'injonction?

Avez-vous pensé à utiliser la procédure de l'injonction ?
Les injonctions de faire et de payer vous permettent d'obtenir rapidement l'exécution de contrats.
Quand l'utiliser cette procédure ?
Lorsqu'un contrat (bail, crédit, vente, …) n'est pas respecté soit qu'elle a été mal réalisée, n'a pas du tout été exécutée ou lorsque le paiement d'un bien ou d'une prestation n'a pas eu lieu. L'injonction permet d'obliger le tiers à exécuter rapidement leurs obligations. C'est une procédure rapide et peu coûteuse.
Quelle procédure ?
La demande doit se faire sur les formulaires Cerfa utiles. Ils sont téléchargeables sur le site www.vos-droits.justice.gouv.fr , rubrique « formulaires » puis « actions en justice ».
2 tribunaux sont compétents : le juge de proximité pour les litiges dont la valeur est < 4000 € et le tribunal d'instance pour ceux compris entre 4001 € et 10000 €.
Attention !
Pour certains litiges, quel que soit le montant, le tribunal d'instance est toujours compétent. C'est notamment le cas pour les litiges locataires-propriétaires, ou les crédits à la consommation.
La demande est déposée au tribunal du lieu du domicile du défendeur. La requête au moyen du cerfa doit être renseignée et complétée de tous les copies des documents justifiant la demande.
Impôts sur les revenus 2012 : Qu'est-ce qui va changer ?

Impôts sur les revenus 2012 : Qu'est-ce qui va changer ?
Budget de rigueur oblige, la loi de finance 2012 se montre peu généreuse avec les contribuables. Gel du barème des impôts sur le revenu, coups de rabot fiscaux et crédits d'impôt en baisse… le point sur ce qui changera cette année sur la feuille d'imposition et quelques pistes pour l'alléger un peu.
Un barème inchangé…
Habituellement, le barème de l'impôt sur le revenu est actualisé chaque année : la limite de chaque tranche est relevée en fonction de l'inflation, pour tenir compte de la hausse naturelle des salaires et des prix.
En 2012, cependant, le barème reste inchangé : autrement dit, les plafonds de chaque tranche ne seront pas revus à la hausse.
Les conséquences seront minimes pour la majorité des contribuables, mais certains risquent, par le biais d'une augmentation – même légère – de leurs revenus, de voir leur situation fiscale changer sensiblement. En effet, les contribuables actuellement très proches du plafond de leur tranche risquent de :
- basculer dans la tranche d'imposition supérieure,
- devenir imposables alors qu'ils ne l'étaient pas.
- Le barème utilisé en 2012 (pour l'imposition des revenus perçus en 2011) est le suivant :
Location: Quels diagnostics sont obligatoires?

Location vide ou meublée : quels diagnostics sont obligatoires ?
En location vide ou meublée, jusqu'à 3 documents sont à remettre au locataire :
- Un diagnostic de performance énergétique (DPE),
- Un contrat de risques d'exposition au plomb (CREP) pour les immeubles bâtis avant le 1er janvier 1949,
- Un état des risques naturels et technologiques (ERNT) dans les zones à risques.
Ils doivent être annexés au contrat de bail.
Ainsi, l'absence de CREP engage la responsabilité pénale du propriétaire.
Le DPE, quant à lui, n'a qu'une valeur informative mais affiche ses résultats dès l'annonce immobilière et doit être tenu à la disposition des candidats locataires.
Ces 2 diagnostics (CREP, DPE) sont à faire réaliser par un professionnel certifié, dont une liste officielle est disponible en ligne*.
Enfin, l'ERNT peut être réalisé par le propriétaire lui-même. Son absence peut entraîner la résolution du contrat de location ou une diminution du loyer.
* http://diagnostiqueurs.application.developpement-durable.gouv.fr/index.action
Réf. :Art.3-1 loi n°89-462 du 6 juil. 1989. Art. L.134-3-1 CCH, art. L.1334-7 c.santé pub. Art. L.125-5 c.environnement.
Source: Intérêts privés
L'IFU? Qu'est ce?
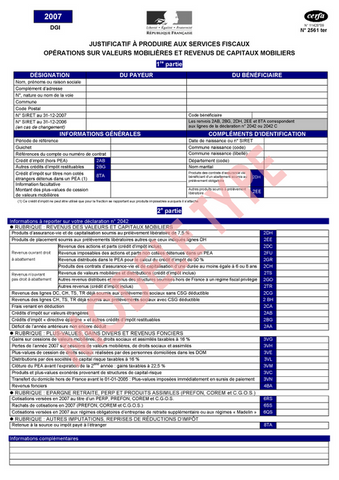
Qu'est-ce que l'IFU ?
Nous arrivons bientôt dans la période des déclarations d'impôts et les établissements financiers adressent des IFU.
Qu'est-ce que c'est ? L'IFU est l'Imprimé Fiscal Unique. Il s'agit d'une aide dans la rédaction de la déclaration d'impôts.
Il récapitule l'ensemble des intérêts perçus au cours de l'année ainsi que le montant des plus ou moins-values boursières réalisées, ou encore le montant des dividendes encaissés.
En outre, il indique également quelle case de la déclaration d'impôt sur les revenus doit être remplie. Ces montants doivent correspondre à ceux mentionnés sur la déclaration pré remplie.
Source : Guide fiscal 2012. Dossier Familial.
Ré-affirmation du principe de la réserve héréditaire

Pas de modification des règles relatives à la réserve héréditaire
Le Conseil supérieur du notariat (CSN) souhaiterait donner plus de place à la liberté testamentaire, en prévoyant une diminution de la réserve héréditaire dans certaines hypothèses.
Ce serait là une remise en cause de la réserve héréditaire.*
Interrogé par un parlementaire sur son avis sur la question, le ministère de la justice réponde que le dispositif juridique français « assure un équilibre entre le respect des droits successoraux des héritiers réservataires et la libre disposition du patrimoine. Il n'est donc pas envisagé de le modifier ».
* la réserve héréditaire est la part de la succession qui revient de droit aux enfants. Elle varie selon le nombre d'enfant. Elle permet de déterminer en contrepartie la part de succession dont on peut disposer librement: c'est la quotité disponible.
Rep min n° 118960, JO AN 7 février 2012
Source : Agefi Actifs
Assurance vie et contrat de capitalisation : quelles différences?

Assurance vie et contrat de capitalisation : quelles différences ?
Les principales différences se trouvent dans la gestion du contrat au moment de sa transmission.
Tandis que le capital placé sur un contrat d'assurance vie échappe plus ou moins largement aux droits de succession au décès de son titulaire, celui placé sur un contrat de capitalisation entre dans l'actif successoral (il n'a pas de clause bénéficiaire).
D'autre part, au décès de son souscripteur, l'assurance vie est automatiquement clôturée : on parle de contrat dénoué alors que le contrat de capitalisation peut être repris par l'un des héritiers (dans ce cas, ce dernier bénéficie de l'antériorité fiscale du contrat).
En outre, le contrat de capitalisation peut faire l'objet d'une donation alors que l'assurance vie non.
Les effets de la vente d'un bien immobilier qui a été sous-évalué lors de la déclaration de succession

Les effets de la vente d'un bien immobilier qui a été sous-évalué lors de la déclaration de succession
Lorsque la vente a lieu dans les six mois du décès, la situation est simple sur le plan fiscal.
La déclaration de succession, qui doit être déposée dans les six mois du décès et dans laquelle les biens du défunt doivent être déclarés pour leur valeur vénale, déclare le bien pour son prix de vente.
Lorsque la vente a lieu après le dépôt de la déclaration de succession, les héritiers courent alors le double risque d'avoir à acquitter la plus-value sur le différentiel entre le prix de vente et la valeur déclarée et de devoir acquitter des droits de succession complémentaires en cas de rehaussement par l'administration fiscale de la valeur déclarée (action prescrite par trois ans).
Une solution consiste à déposer une déclaration de succession rectificative indiquant la valeur vénale réelle du bien immobilier et à acquitter les droits de succession complémentaires.
Sous réserve que cette déclaration rectificative soit déposée alors que le processus de vente n'est pas encore enclenché, elle doit être prise en compte par l'administration.
Ainsi, dans la mesure de la rectification, sont évités l'impôt de plus-value (19 %) et les prélèvements sociaux (13,50 %) soit 32,50 %. Seuls sont acquittés des droits de succession complémentaires qui, en ligne directe, peuvent être bien inférieurs.
Des déclarations rectificatives pour l'ISF doivent, le cas échéant, également être déposées.
Source : Les Echos. 30/01/2012
Le prononcé d'une mesure de protection est subsidiaire aux règles du mariage

Le prononcé d'une mesure de protection est subsidiaire aux règles du mariage.
Une décision récente de la cour de cassation vient de rappeler le caractère subsidiaire des mesures de protection des majeurs, notamment au regard des règles des régimes matrimoniaux.
La Cour de Cassation indique : "Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé qu'en vertu de l'article 428 du code civil, la mesure de protection ne peut être ordonnée que lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles relatives aux droits et devoirs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, la cour d'appel, constatant que les époux avaient opté, au moment de leur mariage, pour le régime de la communauté universelle, que Mme X... était depuis 2004 substituée à son époux dans l'exercice des pouvoirs résultant de ce régime et que les actes qui lui étaient reprochés n'établissaient pas un risque de dilapidation des biens communs, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu de placer M. X... sous un régime de protection."
En conclusion, il n'est possible d'ordonner une mesure de protection que s'il ne peut pas être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par application des règles des régimes matrimoniaux.
Référence: Cass Civ 1 du 1/02/12 n°11-11346 (Date de publication : 02/02/2012).
Source : Club Patrimoine
Le régime matrimonial suffit en l'espèce à protéger la personne accidentellement touché par un coma végétatif.
Un arrêt paru sur le site de la Cour de cassation (www.courdecassation.fr) le 1er février 2012 estime qu'il n'y a avait pas lieu de placer le plaignant sous tutelle, le régime matrimonial de celui-ci suffisant à le protéger. La cour d'appel avait constaté que « les époux avaient opté, au moment de leur mariage, pour le régime de la communauté universelle, que l'épouse était depuis 2004 substituée à son époux dans l'exercice des pouvoirs résultant de ce régime et que les actes qui lui étaient reprochés n'établissaient pas un risque de dilapidation des biens communs », estime la Cour de cassation, rejetant ainsi le pourvoi formé par l'enfant de la personne atteinte d'un coma depuis le 15 août 2003 et qui souhaitait le placement sous tutelle judiciaire de son père.
Cass. civ. 1, 1er février 2012, n° 11-11346
Redevance audiovisuelle
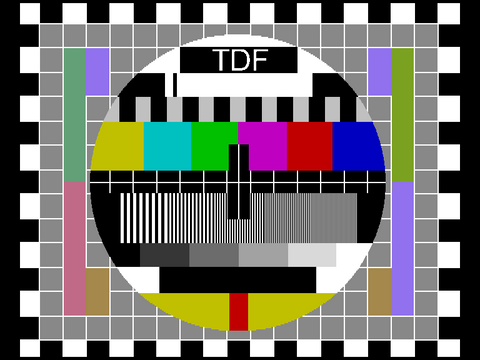
Redevance TV : 125 euros en 2012
Le montant de la contribution à l'audiovisuel public est fixé pour l'année 2012 à 125 € pour la métropole (contre 123 € en 2011) et à 80 € pour les départements d'outre-mer (contre 79 € en 2011).
Pour mémoire, la loi de finances pour 2012 a prorogé d'un an le dégrèvement total de contribution en faveur des personnes âgées de plus de 65 ans au 1er janvier 2004 (73 ans au 1er janvier 2012) accordé sous certaines conditions de ressources notamment.
Pour pouvoir bénéficier du dégrèvement en 2012, les personnes concernées ne doivent pas être sorties de son champ d'application durant les années 2005 à 2011.
Source : Patrimoine.com
Décret : Délivrance au public d'informations cadastrales
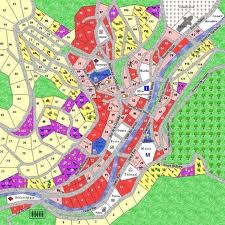
Décret : Délivrance au public d'informations cadastrales
Le décret n° 2012-59 du 18 janvier 2012, avec effet dès le 21 janvier 2012, définit, les conditions de forme et de recevabilité des demandes de communication d'informations issues de la matrice cadastrale.
Il précise les modalités de délivrance des renseignements et les services habilités à les communiquer.
Ainsi, ces demandes de communication d'informations cadastrales doivent être formulées auprès de l'administration fiscale ou des communes.
Elles doivent être faites par écrit (LPF, art. R.* 107 A-1), étant précisé que les informations sont communiquées par voie papier ou par voie électronique si les usagers en font la demande (LPF, art. R.* 107 A-6).
De façon à préserver la vie privée des personnes, le décret du 18 janvier 2012 limite le nombre de demandes effectuées par un même usager. Ainsi, le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil. Cette limitation ne peut toutefois pas être opposée à une personne dont la demande porte sur ses propres biens ou qui agit dans les cas prévus par la loi (LPF, art. R.* 107 A-3)*.
Dans le cas où une personne agit sur mandat, il lui est interdit de conserver les informations qui lui ont été délivrées au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de son mandat (LPF, art. R.* 107 A-4).
* Art. R.* 107 A-3. - I. ― Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil
.
« II. ― La limite prévue au I n'est toutefois pas opposable :
« 1° Aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;(…)
Source : D. n° 2012-59, 18 janv. 2012 : JO 20 janv. 2012 LexisNexis
Indivision : libre accès & indemnisation

Indivision : Libre accès & Indemnisation
La Cour de Cassation indique que :
"Attendu que pour condamner Mme Z... à payer à l'indivision successorale une somme de 54 465,91 euros au titre de l'indemnité d'occupation de l'appartement sis ... au Vésinet, arrêtée au 31 octobre 2007, et après cette date, une indemnité mensuelle de 1 400 euros, l'arrêt retient qu'elle ne prétend pas ni n'établit qu'elle a laissé le libre accès à l'appartement aux autres indivisaires, notamment par la remise des clés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme Z... indiquait que Mme Marie-Anne Y..., Mme Ghislaine Y... et Mme Jacqueline B..., ainsi que la belle-sœur de la défunte, Mme Marie-Antoine Y..., attestaient qu'après le décès de leur sœur, toute la famille disposait des clés de l'appartement et avait un libre accès à celui-ci qui était devenu un lieu de passage et de rencontre, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a, ainsi, violé le texte susvisé ;"
Référence : Cass. Civ 1 du 18/01/12 n°10-18839
Donation : Hébergement gratuit

Donation : Hébergement gratuit
En 1979, des époux font donation, à titre de donation-partage, de la nue-propriété d'un tiers de leurs biens, dont leur maison d'habitation, à l'un de leurs deux enfants, lequel vivait avec eux depuis 1959.
Au décès des donateurs, l'enfant non alloti assigne son frère afin de faire constater l'existence d'une libéralité comme ayant été logé gratuitement depuis 1959.
L'existence d'une libéralité supposant l'appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, la cour d'appel, en relevant l'absence d'intention libérale, dans un tel cas, voit sa décision légalement justifiée.
Source : Cass. 1e civ, 18 janvier 2012, n° 09-72.542 - LexisNexis
LEP : plafond d'IR inchangé en 2012

LEP : plafond d'IR inchangé en 2012
Le montant d'imposition à ne pas dépasser pour l'obtention ou la conservation d'un livret d'épargne populaire (LEP) est maintenu à 769 € en 2012.
En conséquence, les personnes qui ont été redevables en 2011 d'un impôt sur le revenu inférieur à cette limite peuvent obtenir en 2012 soit l'ouverture d'un LEP, soit la prolongation de leur livret si elles en possèdent déjà un. Le montant d'impôt à retenir est celui calculé avant imputation des divers crédits d'impôts.
Source : Patrimoine.com
Immobilier : La comission d'agence en cas de vente avortée

Immobilier : La commission d'agence en cas de vente avortée
La décision :
Le signataire d'un avant-contrat de vente est tenu au versement de la commission d'agence, y compris s'il se désiste au moment de l'acte authentique et ce, qu'elle qu'en soit la raison.
Telle est l'enseignement d'un récent arrêt de la cour de cassation.
Les faits :
Dans le cas d'espèce, une acheteuse avait signé une promesse de vente par l'intermédiaire d'un agent immobilier avant de renoncer à son acquisition au moment de la signature de l'acte authentique chez le notaire, son époux ayant déclaré une grave maladie.
L'agent immobilier impayé de ce fait a alors assigné l'acheteuse en paiement de ses honoraires.
La jurisprudence :
La Cour d'Appel, puis la Cour de Cassation lui ont donné raison au motif que l'acquéreur a « fait perdre sa commission à l'agent immobilier qui avait mené à bien son travail d'intermédiaire jusqu'à la signature d'un acte unique engageant toutes les parties ».
Cour de Cassation, 1ere chambre civile, 15 décembre 2011. N° 10-26911
Rappel : Prélèvement libératoire, révisez les options

Rappel : Prélèvement libératoire, révisez les options !
Compte tenu de l'augmentation des taux du prélèvement libératoire pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2012, les personnes imposées au taux marginal de 30 % ou de 40 % et ayant opté pour ce mode d'imposition ont intérêt à réviser l'intérêt à maintenir cette option, étant rappelé en outre que la CSG acquittée à la source :
- est déductible du revenu imposable à hauteur de 5,1 %, si les revenus sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- n'est pas déductible pour les revenus imposés au prélèvement libératoire.
Pour les produits des placements à revenu fixe, le taux des prélèvements libératoires et des retenues à la source est majoré de 5 points, soit 24 % (hors prélèvements sociaux de 13,5 %) au lieu de 19 % pour 2011. Le taux de 24 % concerne, par exemple, les revenus suivants :
- produits des obligations et des parts émises par les fonds communs de créances ou de titrisation de plus de 5 ans ;
- produits des autres titres de créances négociables et assimilés ;
- bons du Trésor, bons de caisse et assimilés (sauf bons placés sous le régime de l'anonymat) ;
- produits des autres créances, dépôts et cautionnement ;
- intérêts des plans d'épargne logement ;
- intérêts des comptes courants ;
- intérêts des comptes bloqués d'associés (CGI art. 125 C-I, 1er al.) ;
- boni de liquidation ;
- produits capitalisés sur un PEP (entre 4 et 8 ans).
Pour les dividendes perçus à compter de 2012, le taux du prélèvement libératoire et de la retenue à la source est également augmenté, le taux étant fixé à 21 % (hors prélèvements sociaux).
Ce taux a été préféré au taux de 24 % annoncé dans le projet de loi ; à ce niveau d'imposition, l'option pour le prélèvement libératoire, conjuguée à l'impossibilité de déduire du revenu imposable les 5,1 points de la CSG acquittée à la source, aurait été pénalisante.
Source : Revue fiduciaire
Loi 2011-1978 du 28 décembre 2011, JO du 29, art. 20
Licenciement : Attention aux délais !
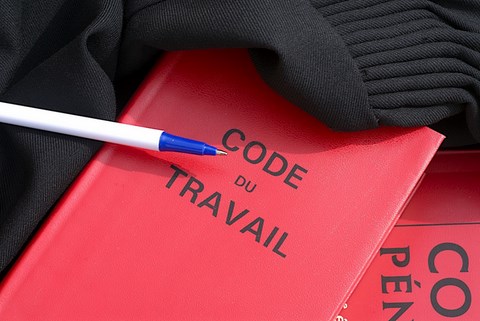
Licenciement : Attention aux délais !
L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant de prendre une décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable et assurer la tenue de cet entretien (c. trav. art. L. 1232-2).
Afin de permettre au salarié de préparer sa défense, le respect d'un délai minimum est imposé entre la présentation de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre et l'entretien (c. trav. art. L. 1232-2).
Ce délai est de 5 jours ouvrables minimum. Pour le calculer, il convient :
- de ne pas compter le jour de remise de la lettre de convocation,
- d'ignorer, le cas échéant, le dimanche et les jours fériés habituellement chômés dans l'entreprise,
- et, si le délai expire un dimanche ou un jour férié chômé, de le proroger jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Dans une affaire récente, le salarié avait été convoqué par courrier recommandé du 14 novembre 2006, présenté le vendredi 17 novembre, à un entretien fixé le mercredi 22 novembre. Compte tenu du dimanche, le salarié ne pouvait pas être reçu en entretien avant le jeudi 23 novembre.
Le non-respect du délai constitue une irrégularité de procédure qui ouvre droit à des dommages-intérêts pour le salarié.
Cass. Soc. 14 décembre 2011, n° 10-21242 D
Commentaire :
En présence d'un majeur protégé particulier employeur, la vigilance du MJPM doit être rigoureuse pour ne pas contrevenir aux intérêts du majeur protégé et/ou engager sa responsabilité.
projet de loi : Recherche des bénéficiaires d'assurance vie non réclamés

Projet de loi : Recherche des bénéficiaires d'assurance vie non réclamés
Dans le cadre de l'examen du projet de loi renforçant les droits des consommateurs, le Sénat a adopté un amendement concernant les contrats d'assurance-vie non réclamés, afin que les primes reviennent aux bénéficiaires plutôt qu'aux assureurs.
Deux lois ont déjà été adoptées en 2005 et 2007 "sans apporter de réponse vraiment satisfaisante à ce grave problème éthique et économique", a souligné le porte-parole de cet amendement.
Le dispositif adopté permet d'interroger chaque année, et sans critère d'âge, le fichier des décès.
Aujourd'hui, cette obligation ne porte que sur les assurés de plus de 90 ans qui n'ont pas eu de contact avec leur assureur depuis 2 ans et pour des contrats dépassant 2 000 €.
Le texte vise également à renforcer la transparence, d'une part, sur les recherches, en contraignant les assureurs à rendre compte des démarches effectuées, et d'autre part, sur l'état du stock des contrats non réclamés.
Les contrats en déshérence représenteraient entre 1 et 5 milliards d'euros.
Source: Patrimoine.com
PEA : Clôture du plan & Décès du titulaire

PEA : Clôture du plan & Décès du titulaire
Le décès du titulaire d'un PEA entraîne-t-il la clôture du plan ?
Le Plan épargne en Action ne peut être ouvert que par une personne disposant d'un foyer fiscal.
En outre, le PEA est attaché à son titulaire.
De ce fait, la réponse à la question est oui.
Le gain net constaté sur le plan lors de cette clôture est exonéré d'impôt sur le revenu, que le plan ait plus ou moins 5 années à la date du décès.
Mais il reste néanmoins soumis aux prélèvements sociaux, prélevés à la source par l'établissement gestionnaire les 15 premiers jours suivant la clôture du plan.
Source : Intérêts privés.
MJPM : L'expertise médicale pour une mesure de protection

MJPM : L'expertise médicale pour une mesure de protection
Cette question a fait récemment l'objet d'une réponse ministérielle :
Le principe en est simple : le coût de l'expertise est à la charge de la personne protégée ou si elle est indigente, à la charge du Trésor Public.
Ce certificat, qui ne peut être assimilé à une consultation médicale, n'est pas pris en charge par l'assurance maladie et il demeure, par principe, ainsi que le prévoyait la législation antérieure, à la charge de la personne protégée.
Si la personne protégée ou sa famille ne sont pas en mesure de financer le certificat médical décrit par l'article 431 du code civil, celui-ci peut être requis par le procureur de la République ou le juge des tutelles.
Il est alors pris en charge par le Trésor public, au titre des frais de justice, en application de l'article R. 93 du code de procédure pénale.
Référence : Réponse ministérielle à la question n°118524 parue au JO de l'Assemblée Nationale le 13/12/11
Taxation : Attention au PEL de plus de 12 ans

Taxation : Attention au PEL de plus de 12 ans
A compter du 12ème anniversaire du PEL, les intérêts annuels deviennent imposables.
Ils sont soumis au barème de l'impôt sur les revenus ou, sur option, au prélèvement libératoire forfaitaire de 19 % en 2011 (24% en 2012).
A cette première taxation, s'ajoutent les prélèvements sociaux (12,3% depuis janvier 2011 puis 13,5 % à compter du 1er octobre 2011).
Cette fiscalité s'applique chaque année jusqu'à la date de clôture du PEL.
En conséquence, pour les personnes percevant des revenus soumis à conditions de ressources, il convient de vérifier les dates de souscription des PEL dont elles sont titulaires. Leur remise en cause est alors à envisager.
Source : intérêts privés.
Successions : La situation pour 2012

Successions : La situation pour 2012
Tous les barèmes et abattements applicables aux droits de succession et de donation seront gelés en 2012 et 2013, sous réserve d'une modification ultérieure.
L'objectif de cette disposition est de ne pas réévaluer les tranches de ces barèmes en fonction de l'inflation pendant 2 ans, afin d'imposer davantage le patrimoine.
La mesure a été annoncée dans le cadre des dispositions de 2ème plan de rigueur.
Les différents abattements resteront en 2012 à leur niveau de 2011 :
- 159.325 € en ligne directe (successions et donations),
- 80.724 € entre partenaires pacsés (donations),
- 31.865 € entre grands-parents et petits-enfants (donations).
Source : intérêts privés
Immobilier : Exonération de plus-value pour les personnes âgées
Nouveau cas d'exonération de plus-value immobilière pour les personnes âgées partant en maison de retraite :
Le nouveau dispositif propose de conserver le régime de résidence principale pendant un délai maximal de trois ans, en matière de plus-values immobilières dès lors qu'au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la cession ces personnes :
- n'étaient pas passibles de l'ISF
- et n'avaient pas un revenu fiscal de référence excédant la limite prévue à l'article 1417-II du CGI.
Source : Fiscalonline
Donation au « dernier vivant » : l'option du conjoint survivant
Si le conjoint survivant, bénéficiaire d'une donation au dernier vivant, décède avant d'avoir pu exercer son option, ce sont, en principe, ses héritiers qui peuvent l'exercer à sa place.
Pourquoi ?
Ce droit d'option a un caractère patrimonial. Comme tel, il est transmissible aux héritiers. Ceux-ci peuvent alors choisir entre soit :
- La totalité en usufruit,
- Le ¼ en pleine propriété et les ¾ en usufruit,
- La quotité disponible en fonction du nombre d'enfants*.
Attention !
Si la donation au dernier vivant mentionne explicitement que l'exercice du droit d'option appartiendra au conjoint survivant et que celui-ci décède avant d'avoir pu l'exercer, la donation devient ipso facto, caduque.
*La succession comprend :
La quotité disponible (QD) : c'est la partie de la succession qui est transmissible sans condition.
La réserve héréditaire (RH) : c'est la part qui revient aux héritiers en ligne directe (enfant, petits-enfants, etc.).
Elles varient en fonction du nombre d'enfants :
1 enfant > RH ½ QD ½
2 enfants > RH 2/3 QD 1/3
3 enfants et plus > RH ¾ QD ¼
Source : intérêts privés
Droit : Personnes protégées & Consommation
L'accroissement du nombre des personnes protégées, un million en France maintenant, a un impact sur le droit bancaire en général et sur celui du crédit à la consommation en particulier.
La Cour de cassation a rendu un arrêt important le 9 novembre 2011 (pourvoi 10-14.375) qui casse un arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 14 janvier 2009 sur ce sujet.
Les faits :
Une dame X souscrit en 1992 un crédit permanent assorti d'un découvert maximum autorisé régi par l'article L.311-9 du code de la consommation. Ce découvert est reconduit tacitement jusqu'en 2006. En 1994, cette personne est placée sous curatelle. Ni Madame X, ni son curateur ne prévient l'établissement de crédit.
Ce dernier assigne la débitrice, seule, en paiement en 2007.
La procédure :
En première instance, la personne protégée est condamnée. Elle fait appel, assistée de son curateur qui se fait alors connaître devant la Cour de Paris.
La Cour confirme le jugement.
La curatélaire assistée de son curateur se pourvoit et l'arrêt d'appel est cassé au motif que l'établissement de crédit aurait dû vérifier si le jugement en 1994 décidant de la curatelle lui était opposable, en clair s'il avait été inscrit sur l'extrait d'acte de naissance de la débitrice.
Source : LegalNews.
Succession : Litige sur la rémunération de « l'aide »
Les faits :
Un particulier, qui avait souscrit un contrat d'assurance vie, décède le 8 avril 2000. Un testament olographe en date du 4 septembre 1998 désignait une femme comme légataire universelle.
Au regard d'un testament olographe du 14 décembre 1999, une autre personne a été envoyée en possession par ordonnance du 22 juin 2000.
Estimant que ce dernier testament était un faux, un ami du défunt propose à la légataire universelle du premier testament de mener pour son compte toutes les procédures judiciaires nécessaires pour faire reconnaître ses droits, d'en avancer et d'en supporter le coût en cas d'échec.
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2000, la légataire déchue prend l'engagement, en cas de succès, de verser à cette personne qui l'assistait moralement et financièrement un pourcentage des sommes nettes recouvrées à l'encontre de la société d'assurance et de la succession du défunt, et enfin de lui rembourser les frais de procédure.
Elle obtient finalement gain de cause : la compagnie d'assurance lui paye le capital garanti. De son côté, elle verse en conséquence le pourcentage convenu à l'ami du défunt.
Ce dernier l'a assigné en paiement de la rémunération convenue sur l'actif net successoral. La légataire a demandé la réduction de cette rémunération.
La procédure :
La cour d'appel rejette la demande de la légataire estimant que « l'argument tiré de la "proportion" entre l'aide financière apportée et le bénéfice retiré est dépourvu de toute pertinence puisque l'ami du défunt a pris le risque de supporter en pure perte des frais de procédure et qu'il s'agit seulement de la réalisation d'un aléa ».
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1134 du Code civil. considérant « qu'en se déterminant ainsi, alors que l'aléa exclusivement supporté par l'ami du défunt ne faisait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette rémunération n'était pas excessive au regard du service rendu, n'a pas donné de base légale à sa décision. »
Cass. civ. 1, 23 novembre 2011, n°10-16770
Assurance vie: « Primes manifestement exagérées »
Une nouvelle décision de jurisprudence vient de donner un nouveau contour à la notion de "prime manifestement exagérée".
Les Faits:
Un homme décède, laissant comme unique héritier un fils né d'un précédent mariage. Deux fois veuf, il avait souscrit 2 contrats d'assurance vie au profit de sa belle-sœur, puis lui avait légué la totalité de la quotité disponible par testament.
Quasiment déshérité, son fils évoque le caractère "manifestement exagéré" des primes versées par son père au titre des assurances vie et demande leur réintégration dans la succession.
La procédure :
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné le rapport d'une partie des primes (150.000 €) dans la succession.
Distinguant les sommes versées selon leur origine, les juges n'ont pas réintégré la prime qui constituait un « remploi d'un précédent contrat dont le défunt était bénéficiaire ». Ils ont estimé qu'elle « ne présentait pas au moment de son versement un caractère manifestement exagéré ».
La cour de cassation a approuvé cette décision.
Civ.2°, 6 Octobre 2011, pourvoi n°10-30899.
Source : Patrimoine infos
Urgent : La taxe sur les logements vacants
Les propriétaires de logements vacants à usage d'habitation peuvent être redevables du paiement de :
- la Taxe sur les logements vacants (TLV)
- ou de la Taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV).
Les propriétaires concernés ont reçu au début du mois de novembre 2011 un avis d'imposition à la TLV ou à la THLV, la date limite de paiement en ligne étant fixée au 20 décembre 2011.
Il est également possible de payer ces taxes par d'autres moyens de paiement, la date limite étant alors fixée à aujourd'hui (15 décembre 2011) :
• titre interbancaire de paiement,
• virement,
• chèque,
• espèces auprès du centre des finances publiques dans la limite de 3 000 euros.
Ces taxes touchent les logements disposant d'un confort minimum et vides de meubles.
• La TLV est à régler sur les logements vacants depuis au moins 2 années consécutives (soit depuis le 1er janvier 2009).
Ces logements sont situés dans l'une des 8 agglomérations suivantes : Bordeaux, Cannes-Grasse-Antibes, Lille, Lyon, Montpellier, Nice, Paris et Toulouse.
• Pour sa part, la THLV est dûe pour les logements vacants depuis plus de 5 années consécutives (soit depuis le 1er janvier 2006). Les logements soumis à cette taxe se trouvent dans les communes ayant mis en place la THLV avant le 1er octobre 2010 (communes pour
Pour en savoir plus : Les taxes sur les logements vacants : TLV ou THLV
Source : Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat
Dividendes : Projet d'augmentation du prélèvement libératoire
Dans le cadre de l'examen en première lecture du 4e projet de loi de finances rectificative pour 2011, les députés ont finalement relevé de 19 à 21 % le taux du prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes. Dans son projet initial, le gouvernement souhaitait relever ce taux à 24 %.
Nous vous tiendrons informé de l'adoption de cette disposition.
Rappel : Le prélèvement libératoire forfaitaire est une retenue fiscale appliquée par la banque ou l'assureur lors du versement des intérêts de votre créance. On le dit "libératoire", car il vous évite ensuite de déclarer la somme versée dans vos revenus imposables.
Source : patrimoine.com
Assurance : L'incapacité temporaire totale de travail
Les faits :
Un particulier souscrit un contrat d'assurance garantissant notamment le risque d'incapacité temporaire totale de travail.
Suite à une dépression nerveuse, il a cessé son activité. L'assureur lui sert des indemnités journalières complémentaires pendant une certaine période puis refuse poursuivre le versement des indemnités journalières pendant plusieurs mois.
L'assuré l'assigne en justice pour le non-paiement des indemnités journalières correspondant à cette période au titre de son incapacité temporaire totale de travail ainsi qu'au versement de dommages-intérêts pour le préjudice que lui aurait causé ce défaut de paiement.
Décision de justice :
Les juges ont condamné l'assureur à payer à l'assuré une certaine somme au titre de l'incapacité temporaire totale de travail pour la période non indemnisée.
Mais la Cour de cassation a précisé que pour prétendre à l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire totale de travail, l'assuré doit prouver être dans l'impossibilité momentanée absolue d'exercer une activité professionnelle quelconque.
Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-2006
MJPM : Hausse du salaire minimum des salariés à domicile
Si un majeur protégé emploie « en direct » à son domicile un salarié pour l'aider dans l'exécution de ses activités familiales et domestiques : ménage, repassage, soutien scolaire, nous vous invitons à consulter le salaire minimum à respecter (hors ancienneté).
Le salaire horaire minimum prévu à l'avenant S 36 du 9 juillet 2009 de la Convention Collective des Salariés du Particulier Employeur étant inférieur au Smic, le salaire minimum retenu est le Smic horaire.
Attention !
Le SMIC horaire change à partir du 1er décembre :
Barèmes applicables à compter du 1er décembre 2011
Option choisie Salaire horaire brut Salaire horaire net
Salaire réel 9,19 € Cas général 7,11 €
Alsace-Moselle 6,96 €
Base forfaitaire 9,19 € Cas général 7,09 €
Alsace-Moselle 6,95 €
Source : Urssaf.fr
MJPM : Tout savoir sur l'assurance vie !
L'effondrement de la Bourse, la dette grecque, les rendements pessimistes des fonds en euros … un cocktail dangereux pour une partie des placements financiers français.
Mais qu'en est-il de l'assurance vie ?
Ce placement considéré comme « sûr » est par conséquent adoré des français.
Mais malgré son attractivité l'assurance vie reste un placement complexe …
Or, de nombreux majeurs protégés en ont souscrits.
Vous souhaitez :
ü Mieux comprendre le fonctionnement de ce placement, de sa souscription à son dénouement ?
ü Assurer au mieux le suivi des contrats d'assurance vie de votre majeur protégé ?
ü Disposer de renseignements utiles dans votre gestion au quotidien ?
ü Ou avoir plus de renseignements avant d'envisager la souscription d'une Assurance vie pour le compte de vos majeurs protégés ?
JD Consultant vous propose de répondre à cette problématique, alors …
Rendez vous
Le 19 janvier à Marseille
Pour la formation sur :
« L'ASSURANCE VIE DE A à Z »
Assurance vie : La faculté de renonciation de l'assuré
Les faits :
Les enfants d'un souscripteur acceptent par courrier le bénéfice d'un contrat d'assurance vie. Quelques mois plus tard, en l'absence de l'accord des enfants sur une demande de rachat anticipé, l'assureur n'a pas donné suite à la demande du souscripteur.
Décision de justice :
Dans un premier temps, la Cour d'appel donne raison à l'assureur de refuser la demande de rachat anticipé, qui s'est faite sans l'accord des enfants.
Mais dans un deuxième temps, la Cour de cassation casse finalement la décision de la Cour d'appel (sur le fondement des articles L.132- 8, L.132-9 et L.132-23 du Code des assurances).
La Cour de cassation rappelle que « lorsque le droit de rachat du souscripteur est prévu dans un contrat d'assurance sur la vie mixte, le bénéficiaire qui a accepté sa désignation n'est pas fondé à s'opposer à la demande de rachat du contrat, en l'absence de renonciation expresse du souscripteur à son droit ».
Explication :
La Cour de cassation considère que la seule clause du contrat d'assurance ne permettait pas de faire la preuve d'une renonciation expresse.
Or lorsque la Cour d'Appel avait rejeté les demandes du souscripteur, elle avait retenu que les enfants avaient manifesté la volonté de recevoir le bénéfice du contrat. A l'époque l'assureur avait informé par une lettre le souscripteur lui rappelant que cette acceptation de ses enfants l'engageait à recueillir leur accord préalable pour toutes opérations notamment de rachat.
Par ailleurs, « si le contrat stipulait un droit de rachat du souscripteur, il stipulait également expressément que, dans l'hypothèse où le bénéficiaire aurait accepté sa désignation, ce droit de rachat était subordonné à l'accord de ce dernier, ce dont il se déduit que le souscripteur avait renoncé, en cas d'acceptation du bénéficiaire, au droit de rachat unilatéral. »
Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, 10-2536
Source : Agefi Actifs
Texte officiel :
http://www.agefi.fr/documents/11/D3YLC5N0_Cour_de_cassation_civile_Chambre_civile_2_3_novembre_2011_10-25.364_In%c3%a9dit.pdf
CAF : Attention au recouvrement des prestations indues
Les faits :
La caisse d'allocations familiales de Paris a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir le remboursement d'une allocation logement indûment versée à un assuré.
En effet, l'assuré a quitté le logement pour lequel il percevait cette aide sans en informer la CAF, qui n'a cessé ses versements que 8 mois plus tard.
La CAF a envoyé alors une mise en demeure à l'intéressé, réclamant la restitution de ces 8 mois d'allocation. Ce courrier restant sans réponse, la caisse a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale (TASS), devant lequel l'assuré n'a pas comparu, et ne s'est pas fait représenter.
Décision de justice :
Dans un premier temps, le TASS a débouté la CAF, au motif que le débiteur n'a pas été destinataire de la mise en demeure obligatoire en la matière (CSS, art. L. 244-2). Et pour cause, se défend la CAF, puisqu'il a déménagé.
Mais dans un second temps, la Cour de cassation, saisie à son tour, a estimé que « l'envoi d'une mise en demeure préalable ne constitue une condition de recevabilité ni de l'action ni de la demande », et a condamné l'assuré à rembourser le trop perçu.
Source : Jurisclasseurs
Cass. soc., 10 nov. 2011, n° 10-23.208, F-P+B, CAF de Paris c/ M. B. : JurisData n° 2011-024346
Imposition des gains de jeux
Le ministère du budget rappelle que les « gains réalisés à l'occasion de jeux, même pratiqués de manière habituelle, ne constituent pas (au sens de l'article 92 du code général des impôts) une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition ».
Le gouvernement tempère son propos en indiquant que, « selon la doctrine publiée de l'administration fiscale (référencée 5 G-116 n° 8 61 et 119), sont imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés par les joueurs professionnels dans des conditions permettant de supprimer ou d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard ».
« Cette position est pleinement applicable à la pratique habituelle du jeu de poker, y compris en ligne, dès lors que le jeu de poker ne peut être regardé comme un jeu de pur hasard et sous réserve qu'il soit exercé dans des conditions assimilables à une activité professionnelle. L'imposition des gains ainsi réalisés par des joueurs de poker est d'ailleurs confirmée par la jurisprudence (tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2010, n° 09-640, Petit).
La position de l'administration fiscale apparaît par conséquence très claire ».
Rep. Min. n° 110952, JO AN 15 novembre 2011
Texte officiel : http://www.agefi.fr/documents/11/E3ZLC5O0_Repmingainsaujeu.pdf
Source : Agefi Actifs
Le droit de retour des parents : plus ou moins contraignant
Qu'est que le droit de retour ?
Le "droit de retour" est la faculté pour le donateur de gratifier une personne sous la condition que cette dernière lui survive.
Si le donataire (bénéficiaire de la donation) décède avant le gratifiant, alors les biens donnés retournent dans le patrimoine du donateur, d'où l'expression "droit de retour ".
Il existe le droit de retour légal (institué en 2007 de l'article 738-2 du code civil) et le droit de retour conventionnel.
Le droit de retour légal :
Ce droit pose une limite au droit qu'ont les enfants de déshériter leurs parents héritiers.
En effet, si les père et/ou mère ont donné des biens à leur enfant mort sans descendance, ils ont le droit de reprendre ces biens.
Le plus souvent, ce droit s'exerce en nature, l'actif donné réintégrant leur patrimoine. Toutefois, ce droit de retour prévu par la loi n'empêche pas le bénéficiaire de la donation de le vendre, de donner ou léguer le bien. Dans ce cas, c'est le prix de vente, ou la valeur du bien, qui est « rendu » aux parents.
Ce droit de retour légal ne peut, en revanche, être remis en cause et un testament déshéritant les parents ne pourrait y faire obstacle.
Le droit de retour conventionnel :
Du fait de l'article 951 du Code civil, le droit de retour conventionnel interdit de disposer du bien. Le ou les parent(s) ont donc le droit au retour du bien dans leur patrimoine si leur enfant venait à décéder sans descendance avant eux.
Néanmoins, cette situation n'est pas intangible, le parent peut autoriser le legs en renonçant à son droit de retour conventionnel, ce qui ne veut pas dire qu'il renonce au droit de retour légal.
Dans ce cas, la valeur du bien devra retourner dans le patrimoine du parent avec les difficultés que cela entraînent. Le plus simple est alors aussi pour le parent de renoncer au droit de retour légal.
Source : Mieux vivre. Votre argent.
Réglementation lorsque le testateur est sourd et muet
Une personne sourde et muette est aujourd'hui dans l'impossibilité d'établir un testament authentique en raison de l'article 972 du Code civil.
Le ministère de la justice indique qu'il envisage « de nouvelles dispositions prévoyant pour un testateur ne pouvant parler, que celui-ci écrive un texte en présence du notaire, lequel rédigerait ensuite le testament authentique sur la base de ces notes.
Le notaire donnerait alors lecture au testateur de l'acte rédigé. Dans le cas où celui-ci ne pourrait l'entendre, il en prendrait connaissance par lui-même.
Le notaire resterait ainsi le seul rédacteur de l'acte, aucun intermédiaire n'intervenant entre lui et le testateur, et les garanties de fiabilité et de sécurité du testament authentique seraient respectées. Un amendement en ce sens sera proposé par le Gouvernement dès qu'un vecteur législatif adapté le permettra ».
Cliquez ici pour lire la réponse ministérielle
Rep. min. n° 118537, JO AN 15 novembre 2011
PERP et décès du souscripteur : Quid ?
En cas de décès du souscripteur, les sommes versées sur un Perp sont en principe perdues pour ses héritiers.
Mais, dans les faits, les Perp actuellement commercialisés comportent tous, et sans frais supplémentaires, une garantie complémentaire en cas de décès du souscripteur pendant la phase d'épargne.
Selon le Perp, le reversement des droits acquis par le souscripteur se fait de 2 manières :
- versement d'une rente à un ou des bénéficiaire(s) désigné(s) dans le contrat ou, à défaut, au conjoint. Le cas échéant, cette rente peut être temporaire, avec cependant une durée minimale variant selon les contrats.
- Versement d'une rente temporaire d'éducation versée aux enfants mineurs du souscripteur décédé, jusqu'à leur 18ème ou 25ème anniversaire.
Le choix du ou des bénéficiaire(s) se fait au moment de souscription du Perp, mais peut être modifié pendant la phase d'épargne.
Source : Mieux vivre. Votre argent
Succession et enfant unique : fin d'une faveur fiscale
Les petits enfants qui succèdent à leurs grands-parents après renonciation de l'héritage de leur père (ou de leur mère), eux-mêmes enfant unique, ne bénéficient plus que d'un abattement fiscal réduit.
Exemple :
La mère d'un enfant unique décède. Si ce dernier renonce à son héritage au profit de ces 2 enfants, ceux-ci ont droit seulement à un abattement de 1.594 € (à se partager entre eux) au lieu de 159.325 € (abattement en ligne directe) comme auparavant.
La mesure de tolérance de l'Administration fiscale demeure en cas de prédécès de l'enfant unique du défunt.
Source : Rescrit du 26 Juillet 2011
Tutelle : Evolution en matière de vérification des comptes
Le greffier en chef peut désormais être assisté par un huissier de justice dans sa mission de vérification des comptes de gestion d'une personne sous protection juridique telle que la tutelle. Un décret vient de préciser les modalités de cette mesure, notamment s'agissant de la tarification de l'intervention de l'huissier de justice qui dépendra d'un barème tenant compte «de l'importance des mouvements du compte de la personne protégée ».
Décret n° 2011-1470 du 8 novembre 2011 relatif à l'assistance du greffier en chef en matière de vérification des comptes de tutelle par un huissier de justice – JO 10 novembre 2011, texte n° 23
Défaut d'entretien des parties communes : l'assurance du syndicat joue-t-elle ?
Faits :
Un copropriétaire est victime de dégâts des eaux répétés provenant des parties communes de l'immeuble. Après expertise, il assigne en réparation le syndicat des copropriétaires et l'assureur de la copropriété, qui dénie sa garantie.
Procédure judiciaire :
Tout d'abord, la cour d'appel condamne l'assureur. Il devra verser une certaine somme au copropriétaire au titre des frais de remise en état de son appartement (avec des intérêts au taux légal à compter du rapport d'expertise).
L'assureur décide de contester cette décision de justice et fait appel. Mais la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'assureur.
Explication :
La cour d'appel a retenu que les dommages subis avaient pour origine un défaut d'entretien des parties communes, engageant donc la responsabilité du syndicat et excluant la responsabilité de l'assureur. Car une clause exclut la responsabilité de l'assureur en cas de défaut d'entretien ou de réparation.
Cependant la justice considère que cette clause ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. Par conséquent, elle ne peut être appliquée en raison de son imprécision.
(L'exclusion de garantie n'était pas formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances).
Conclusion : Finalement l'assureur versera la somme due au copropriétaire.
Cass. 2e civ., 6 oct. 2011, n° 10-10.001: JurisData n° 2011-021034
Une aide-ménagère peut-elle être héritière ?
La loi interdit les testaments au profit des personnes qui ont soigné le testateur, c'est-à-dire celui qui fait son testament. Ainsi, une infirmière ou un médecin ne peuvent être désignés comme légataire.
Qu'en est-il d'une aide-ménagère ?
La restriction légale vise les professionnels de santé qui soignent le testateur pendant sa dernière maladie. Elle s'applique également aux ministres du culte, aux propriétaires, administrateurs et employés des établissements sociaux et médico-sociaux hébergeant des personnes en situation de faiblesse, ainsi qu'aux accueillants familiaux et à leur conjoint, ascendants ou descendants.
En dehors de ces professions, il est possible, en l'absence d'héritier(s) réservataire(s), de désigner un tiers comme légataire universel.
Une aide-ménagère peut donc hériter dès lors qu'elle n'est pas auxiliaire médicale.
Comment gérer les conflits de succession, en cas de démembrement de propriété ?
Les faits :
Un père donne à son fils en avance de part successorale, c'est-à-dire à titre d'avance sur son héritage, la nue-propriété* d'une maison dont il conserve l'usufruit.
Après le décès du père, ses deux enfants s'opposent sur la liquidation et le partage de la succession.
Rappel:
*la nue-propriété est le droit de disposer de son bien à sa guise, et éventuellement de le modifier ou de le détruire.
Usufruit est le droit de se servir d'un bien et/ou d'en recevoir les revenus.
.
Procédure judiciaire & Conclusion :
Dans un premier temps, la cour d'appel décide que le fils doit rapporter à la succession de son père la valeur de la seule nue-propriété de l'immeuble qu'il a reçue, évaluée en tenant compte de l'âge du donateur lors de la donation.
Cependant, l'arrêt est cassé par la Cour de Cassation : en cas de donation en nue-propriété avec réserve d'usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété du bien.
Cass. 1e civ. 28 septembre 2011 n° 10-20.354 (n° 871 F-D)
Info 3 : Lancement de l'annuaire européen des notaires
Avec le soutien de la Commission européenne, les notaires d'Europe (CNUE) ont créé le site internet www.annuaire-des-notaires.eu permettant aux citoyens de l'Union européenne de trouver un notaire qui parle leur langue partout en Europe. Le citoyen sera désormais en mesure, par exemple, de trouver un notaire à Prague qui parle le français et pourra l'aider dans ses démarches transfrontalières telles que l'acquisition d'un bien immobilier ou le règlement d'une succession.
Le fonctionnement du site internet est très simple et permet à l'utilisateur de consulter les profils personnels des notaires correspondant à sa recherche, d'avoir accès aux coordonnées de contact du notaire (adresse postale, téléphone, courriel, site web, etc.), ainsi qu'à la localisation de l'étude du notaire sur un plan de la ville.
Source : Communiqué du Conseil des Notariats de l'Union Européenne (CNUE)
Info 2 : Renoncer à une assurance vie : quel type d'acte ?
Les faits :
Une mère avait exercé la faculté de renonciation au nom de son fils mineur. L'assureur refusait de rembourser les primes au motif que, s'agissant d'un acte de disposition, la renonciation aurait dû être autorisée par le Juge des Tutelles.
La décision :
La Cour de Cassation conclut au contraire à la qualification d'acte d'administration que la mère, en sa qualité d'administratrice légale, pouvait effectuer sans autorisation.
Dès lors, la renonciation à un contrat d'assurance vie est un acte d'administration et non de disposition, en cas d'administration légale.
Cass. 1ère civ. 18 mai 2011 n° 10-23.114
Info 1 : Adoption d'une mesure limitant la taxation des plus-values immobilières
Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2012, une exonération de la taxation des plus-values a été adoptée par les députés.
Conditions :
- il doit s'agir de la première cession d'un logement (qui n'est pas la résidence principale),
- et le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des quatre années précédant la cession.
De plus, il faut remployer la plus-value réalisée lors de l'acquisition d'une résidence principale dans un délai de 24 mois.
Cette mesure concerne les personnes propriétaires bénéficiant d'un logement de fonction.
Source : Agefi Actifs
Impôts : Procédure de relance des contribuables défaillants applicable depuis le 1er octobre 2011
Depuis le 1er octobre 2011, la procédure de relance des contribuables défaillants est unifiée pour toutes les créances fiscales recouvrées par la direction générale des finances publiques (DGFiP).
Que l'imposition soit établie par voie de rôle ou par avis de mise en recouvrement, le comptable compétent doit envoyer une lettre de relance aux contribuables considérés comme primo-défaillants, sauf cas de non application de cette procédure (CGI, LPF, art. L. 257-0 B).
Le contribuable destinataire de cette lettre dispose de 30 jours pour payer.
Est primo-défaillant le contribuable pour lequel aucune autre défaillance de paiement n'a été constatée au titre d'une même catégorie d'imposition au cours des 3 années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi (CGI, LPF, art. 257-0 b).
Trois catégories d'imposition sont définies :
- L'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux recouvrés comme l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, les taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, les impositions recouvrées comme les impositions précitées ainsi que l'ISF ;
- Les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre ;
- Les impositions autres que celles mentionnées au a et au b (décret 2011-1302, art. 9).
À défaut de paiement ou en l'absence de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement dans les 30 jours de la lettre de relance, le comptable des impôts peut adresser une mise en demeure de payer qui accorde huit jours supplémentaires au contribuable pour s'acquitter de sa dette avant l'engagement des poursuites.
Lorsque la lettre de relance n'a pas à être adressée, la mise en demeure de payer ouvre au contribuable défaillant un délai de 30 jours pour s'acquitter de son imposition avant l'engagement des poursuites (CGI, LPF, art. L. 257- 0 A).
Le décret 2011-1302 (art. 9) précise en outre que la mise en demeure de payer indique les références du ou des avis de mise en recouvrement et rôles dont elle procède ainsi que le montant des sommes restant dues.
Lorsque la mise en demeure de payer est notifiée par lettre RAR, cette notification est effectuée selon la procédure prévue pour la notification de l'avis de mise en recouvrement (CGI , LPF, R.* 256-6 et R.* 256-7 ; CGI, LPF, art. R* 257-0 A).
(Décrets 2011-1302 et 2011-1303 du 14 octobre 2011)
(Source : revue fiduciaire)
Suppression de l'avantage fiscal du compte épargne Co-développement
La réduction d'impôt qui était attachée au compte épargne Co-développement, a été supprimée par la loi de finances pour 2011 et n'est plus applicable à partir de l'imposition sur les revenus déclarés pour 2010.
Le compte épargne Co-développement permettait aux personnes ayant la nationalité d'un pays en voie de développement, vivant en France et détenant une carte de séjour, de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu équivalant à 40 % des sommes finançant des projets d'investissement dans le pays d'origine. Environ 50 pays étaient concernés par le dispositif.
L'investissement issu du compte épargne Co-développement pouvait prendre la forme de :
- création ou reprise d'entreprise,
- prise de participation dans une entreprise locale,
- achat d'immobilier commercial ou de fonds de commerce,
- contribution à des activités de micro-finance, etc.
Les comptes épargne Co-développement déjà ouverts continuent de fonctionner, mais sont transformés en comptes d'épargne ordinaires, rémunérés au même taux que celui fixé par convention lors de l'ouverture du compte.
Informations complémentaires :
- Instruction fiscale 5 B-13-11 du 4 octobre 2011 (ministère chargé des finances)
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/10/cir_33903.pdf
- Liste des pays ouverts au compte épargne Co-développement (Légifrance)
(source : Service Public )
Renoncer au bénéfice d'un contrat d'assurance vie
Le savez-vous ?
Un bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie peut renoncer au bénéfice d'un contrat d'assurance vie.
Pourquoi ?
Le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie est détenteur d'un droit propre et direct à l'encontre de l'assureur.
Il peut donc renoncer à ce droit librement et sans formalisme particulier.
Toutefois, pour des raisons de preuve ou d'opposabilité, il est préférable que cette renonciation soit directement adressée à l'assureur par écrit (lettre simple ou lettre avec AR), sans que le bénéficiaire n'indique au profit de qui il renonce.
Quel intérêt de renoncer ?
Cette renonciation, dans l'hypothèse où le bénéficiaire n'a pas besoin des capitaux, peut présenter plusieurs avantages.
Cet avantage peut être de nature fiscale : le bénéficiaire peut renoncer à un contrat en particulier, lorsque plusieurs contrats le désignent, afin d'éviter de dépasser les abattements et de payer des droits.
L'avantage peut être de nature patrimoniale : le conjoint survivant, par exemple, peut renoncer à un contrat qui le désigne en premier rang et à défaut ses enfants, en considérant que ces derniers en ont plus l'utilité.
Dans cette hypothèse, les capitaux sont versés aux bénéficiaires de second rang (sans passer par le patrimoine du bénéficiaire de premier rang qui renonce). D'où l'importance d'être vigilant dans la rédaction des différents rangs de la clause.
Nos formations à la carte
Notre cabinet vous propose en exclusivité son catalogue de formation actualisé, afin que vous puissiez anticiper vos besoins de formation à l'avance.
Nous vous rappelons que nos formations sont à destination de toutes les personnes concernées par la protection juridique des personnes vulnérables : MJPM, Tuteurs privés, Tuteurs familiaux, Service de Tutelle…
Ce catalogue vous propose 9 thèmes de formation, dont 3 nouveaux thèmes pour 2012 :
- L'assurance vie de A à Z,
- La gestion patrimoniale du majeur protégé face à la crise : définir une procédure,
- Tout savoir sur le mandat de protection future.
Le principe est le suivant :
Bénéficiant de près de 10 ans d'expérience sur la gestion patrimoniale des personnes protégées, JD consultant organise plusieurs formations en externe (le plus souvent sur Paris). Cependant vous avez la possibilité de nous contacter afin de nous communiquer les thèmes de formation que vous souhaiteriez voir au programme de nos formations.
Vous pouvez aussi contacter le cabinet afin d'organiser VOS formations en interne, dans vos services. Ce service à la carte vous permet de mieux vous organiser en fonction de vos contraintes.
Nous sommes à votre écoute afin de satisfaire au mieux vos attentes. N'hésitez plus à nous contacter pour nous communiquer vos attentes.
Découvrez dès maintenant notre catalogue 2012 :
http://www.formation-mjpm.com/catalogue/catalogue-formation.pdf
La donation-partage et l'accord des donataires
L'avantage de la donation-partage est d'organiser à l'avance comme son nom l'indique le partage de ses biens de son vivant entre ses enfants. En outre, elle permet de figer la valeur des biens, objet de la donation-partage.
Une donation-partage n'est possible qu'avec l'accord dans l'acte de toutes les personnes gratifiées. En effet, c'est seulement si tous les enfants participent et acceptent la donation-partage que l'opération produit ses effets favorables.
Il est certes possible de consentir une donation-partage à certains de ses enfants, mais en pratique cela n'est pas du tout conseillé. En effet, les biens donnés par la donation-partage seront évalués au jour du décès du donateur (celui qui consent la donation) et non au jour de la date de la donation-partage. Afin de vérifier que chacun des enfants a bien reçu la part de succession que la loi lui réserve.
En écartant un enfant de la donation-partage, il existe donc un risque de contestation de l'acte passé.
Pour éviter ces désagréments, il est conseillé, avec l'accord des gratifiés, de prévoir le règlement d'une somme d'argent (une soulte) au bénéfice de l'enfant écarté moins favorisé. De même, il sera conseillé au donataire de conserver assez de biens pour que la réserve de l'enfant non gratifié puisse être constituée.
Source : Mieux vivre votre argent.
Quid en cas de cession de valeurs mobilières en moins-value ?
La problématique :
Suite à une cession de titres en raison de la crise financière, l'opération a dégagé une moins-value. Peut-elle être déduite et sur quels revenus ?
La réponse :
Depuis la suppression du seuil des cessions en janvier 2011, le montant des ventes d'une année n'a plus d'importance. Il est possible d'imputer les moins-values sur les gains en bourse des dix années suivantes, et non sur le revenu global.
Source : Mieux vivre votre argent
Rappel : Paiement de la taxe foncière : échéance fixée au 17 octobre
Sauf d'être mensualisés, les propriétaires d'un bien immobilier ont jusqu'au 17 octobre pour payer leur taxe foncière et jusqu'au 22 octobre s'ils acquittent la taxe directement sur le site impots.gouv.fr.
L'Administration fiscale rappelle que la taxe foncière est due par les propriétaires ou les usufruitiers d'un bien immobilier (maison, appartement ou terrain) au 1er janvier 2011. Elle doit être acquittée même si le bien a été vendu en cours d'année 2011.
A compter du 1er octobre 2011, il faudra 35 € pour saisir la Justice
Cette contribution de 35 € sert à financer l'aide juridique (L'aide juridique permet de rémunérer un avocat pour les personnes les plus démunies).
Qui doit payer cette contribution ?
Toute personne qui saisit la Justice doit en principe s'acquitter d'une contribution de 35 €.
Les personnes qui bénéficient de l'aide juridique en sont dispensées.
Quelles procédures donnent lieu au paiement de cette contribution ?
La contribution de 35 € doit être acquittée lorsque vous saisissez la Justice pour un problème civil, commercial, prud'homal, social ou rural. C'est également le cas lorsque vous portez un contentieux devant un tribunal administratif.
Attention : A défaut de paiement, votre demande sera déclarée irrecevable.
Certaines procédures ne donnent pas lieu au paiement de cette contribution. Il s'agit notamment des procédures engagées devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le juge des tutelles ou le traitement des situations de surendettement des particuliers.
Si vous obtenez gain de cause, vous pourrez demander au juge de condamner la partie adverse à vous rembourser cette contribution.
Quelles sont les modalités de paiement ?
Vous devez acheter 35 € de timbres fiscaux chez le buraliste et les coller sur l'acte par lequel vous saisissez la Justice.
Si vous êtes représenté par un avocat ou un huissier de Justice, c'est à ce professionnel de s'en charger.
Qu'est-ce que l'aide juridique ?
C'est l'assistance qui permet aux personnes démunies ou ayant des ressources modestes, d'accéder à la Justice et d'être informées sur leurs droits et leurs obligations et sur les moyens de les faire valoir ou de les exécuter. Elle comprend l'aide à l'accès au droit, l'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat. Cette aide peut prendre en charge totalement ou partiellement les dépenses des personnes qui en bénéficient.
Donation : Les 6 chiffres essentiels :
QUAND ?
18 ans
C'est l'âge minimal pour recevoir le don d'une somme d'argent sans avoir à régler de droits de mutation (à condition de ne pas dépasser le plafond de 31.865 €).
70 ans
C'est l'âge limite avant lequel il faut effectuer une donation d'entreprise en pleine propriété dans le cadre d'un engagement collectif de conservation (pacte Dutreil). Celui-ci permet de bénéficier d'une réduction de 50 % des droits de mutation, qui passe à 30 % si le donateur a entre 70 et 80 ans.
80 ans
C'est l'âge limite (au jour de la transmission) avant lequel il faut donner une somme d'argent à un membre de sa famille pour profiter de la franchise de droits. Les bénéficiaires peuvent être les enfants, les petits-enfants, arrière-petits- enfants, ou les neveux.
10 ans
C'est le délai minimal à observer entre deux donations pour bénéficier de l'intégralité de l'abattement fiscal sur les droits de donation. Jusqu'à fin juillet 2011, ce délai était de 6 ans. Dorénavant il est de 10 années. Pour ne pas pénaliser les donations réalisées entre 6 ans et 10 ans avant l'entrée en vigueur de cette loi, un barème d'abattement transitoire a été mis en place. Il permet d'obtenir un abattement de 10 % si la donation est passée depuis 6 ans et moins de 7 ans, 20 % si la donation est passée depuis 7 ans et moins de 8 ans, 30 % si la donation a plus de 8 ans et moins de 9 ans et 40 % si la donation a plus de 9 ans et moins de 10 ans.
COMBIEN ?
31.865 euros
C'est le montant maximal des dons de sommes d'argent que l'on peut effectuer au sein de sa famille sans avoir à verser de droits, à condition de respecter les conditions d'âge du donataire et du donateur. Les dons peuvent concerner un enfant, un petit-enfant, un arrière-petit-enfant ou un neveu ou petit-neveu si le donateur n'a pas de descendance directe. Seule formalité à effectuer : remplir un imprimé fiscal spécifique (n° 2735) dans le mois qui suit pour déclarer ce don manuel : http://www.axxis.fr/pdf/declaration_don_manuel.pdf
159.325 euros
C'est le montant maximal exonéré de droits pour une donation à un enfant ou à une personne handicapée (quel que soit son lien de parenté avec le donateur). A noter : pour un enfant handicapé, le seuil est doublé, soit 318.650 € (159.325€ X 2). Ce montant peut se cumuler avec celui du don d'une somme d'argent.
FAIT: Minorité et somme d'argent: ATTENTION

Accepter une somme d'argent pour un mineur : danger
Le 25 mars 2013, la Cour de cassation a rendu un avis sur l'indemnisation d'un préjudice subi par un mineur dans le cadre d'une infraction pénale.
Les faits :
Une offre d'indemnisation a été faite aux deux parents, représentants légaux du mineur.
La Cour de cassation estime que les deux parents ne peuvent pas accepter seuls une offre d'indemnisation : ils doivent recueillir préalablement l'autorisation du Juge aux Affaires Familiales, Juge des tutelles des mineurs.
Cet avis est sans aucun doute rendu en réalité au visa de l'article 389-5 du Code civil, qui prévoit que même d'un commun accord, les parents ne peuvent pas renoncer pour le mineur à un droit. Cet article vise l'administration légale pure et simple, c'est-à-dire les cas où l'enfant a ses deux parents.
La Cour de cassation applique donc strictement cet article, en estimant que l'acceptation d'une offre d'indemnisation vaut renonciation à un droit : celui à une action judiciaire devant un Tribunal permettant d'obtenir une indemnisation (souvent plus élevée). Dès lors, le contrôle du Juge aux Affaires Familiales agissant en qualité de Juge des tutelles des mineurs est nécessaire pour éviter que les parents n'acceptent une indemnisation qui ne serait pas favorable au mineur, ce qui lui fermerait l'action en justice contre le responsable de son préjudice.
Cette règle de l'autorisation préalable du Juge s'applique également lorsqu'un seul parent a l'autorité parentale et gère les biens du mineur. Elle s'applique aussi en cas d'opposition entre les deux parents.
Selon l'avis de la Cour de cassation, la seule exception réside dans une tutelle d'un mineur avec conseil de famille.
Cet avis est donc très important car il rappelle une règle qui pourtant est très souvent oubliée par les parents et les praticiens du droit y compris d'ailleurs certaines juridictions : lorsqu'une transaction est proposée à un mineur avec une offre d'indemnisation, il faut l'accord du Juge des tutelles des mineurs (JAF maintenant) car au final il s'agit d'une renonciation à un droit (agir en justice). A défaut d'une telle autorisation, le mineur pourrait exercer par la suite une action non seulement contre le responsable mais également contre ses parents, voire même tous les intervenants négligents.
La règle vaut également sans aucun doute à la renonciation par les parents à exercer une voie de recours, qui constitue aussi un droit. C'est le cas notamment lorsqu'au pénal une constitution de partie civile a été faite pour le mineur et qu'un délai d'appel lui est ouvert : il faut en théorie faire valider par le Juge précité la renonciation au droit d'appel, c'est-à-dire lui faire valider les sommes obtenues pour le mineur devant la juridiction de première instance.
Par Maître Franck PETIT
Avocat (Barreau de DIJON http://www.didieretpetit.com)
RSA et condition de ressources.

L’attribution du RSA est subordonnée à des conditions de ressources. L’Administration détermine la moyenne des ressources du demandeur et des membres de son foyer fiscal au cours des 3 mois précédent la demande ou la révision de l’allocation.
Sont pris en compte ses revenus professionnels, ses allocations chômage, pensions diverses, allocations familiales ainsi que les revenus tirés des biens mobiliers et immobiliers.
On y ajoute aussi les revenus fictifs.
Cette disposition est prévue par les articles R262-6 et R132-1 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, une personne détenant un bien qui n’est pas sa résidence principale (et qu’elle ne loue pas) est tenue de déclarer ce bien ainsi que de transmettre l’avis de taxe foncière et/ou de taxe d’habitation.
S’agissant d’un bien immobilier, il est tenu compte d’un revenu fictif égal à 50% de la valeur locative.
En conséquence, la prise en compte de ce revenu fictif peut effectivement conduire à une diminution ou à la suspension du versement du RSA.
Il faut savoir que les textes ne prévoient pas la situation des bénéficiaires du RSA détenteurs de la seule nue-propriété d’un bien.
Il convient dès lors de se rapprocher de l’Administration pour savoir si elle raisonnera comme si le nu propriétaire avait la pleine propriété ou si elle ne tiendra pas compte de son statut de nu-propriétaire, puisque seuls les usufruitiers sont susceptibles de percevoir les revenus issus du bien immobilier.
Source : Mieux Vivre. Votre argent.
Rémunération des MJPM Privés : une décision récente du conseil d’état
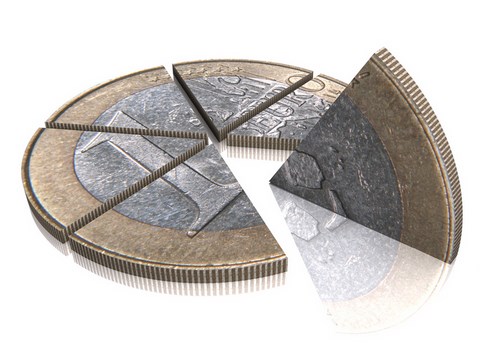
Le conseil d’état dans un arrêt en date du 24 avril 2012 (n°352979) a rejeté les recours pour excès de pouvoir formés par la Chambre nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs contre :
- Le décret n°2011-936 du 1er août 2011 (JO du 4) qui a fixé les nouvelles règles de rémunération des MJPM à titre individuel ;
- L’arrêté d’application du 3 août 2011 (JO du 6), qui avait précisé le barème de la rémunération MJPM à titre individuel.
Entre temps, l’arrêté du 3 août 2011 a été entretemps modifié par l’arrêté du 6 janvier 2012. La ministre des affaires sociales et de la santé a récemment annoncé, en réponse à une question parlementaire (Rép.min.n°18608, JOAN Q du 9 avril 2013, p.3790), entre autres, que « des travaux sont prévus en 2013 concernant certaines dispositions, notamment celles relatives au système de participations des personnes protégées au financement de leur mesure de protection, qu’elle soit exercée par un service mandataire ou un mandataire individuel ». Source : AJ Famille, n°6
Il ne serait pas étonnant que les règles de financement des mesures de protection exercées par les MJPM exerçant à titre libéral soient à nouveau modifiées dans un proche avenir ; ce qui montre à quel point il s’agit d’une question sensible.
Les débats, lors de l’atelier sur la participation financière des majeurs protégés durant la Convention Abripargne 2013, ont mis en exergue les difficultés et les différences de traitement en pratique. Au détriment des majeurs protégés ?
Connaissez-vous la fiscalité des bons anonymes ?
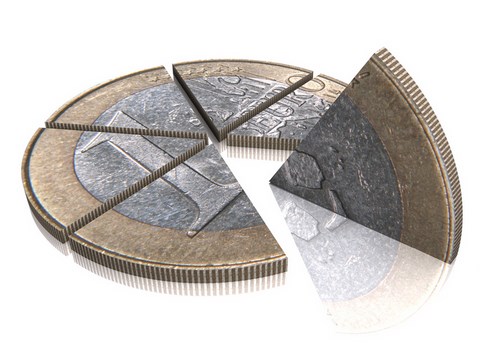
La fiscalité des bons anonymes est pénalisante.
Un prélèvement fiscal libératoire de 60 % sur les intérêts est applicable auxquels s’ajoutent les 15,5% de prélèvements sociaux.
En plus, une taxe de 2% est perçue sur le montant nominal du bon autant de fois que la date du 1er janvier est comprise entre l’émission du bon et son remboursement. Par exemple, pour un bon souscrit en 1997 et remboursé en 2013, on arrive à un total de 30%...
Attention donc, car on peut ainsi payer plus de taxes que le montant du bon et des intérêts !
Source : Mieux vivre. Votre argent
La rémunération du mandataire peut être une dette de la succession.

L'article 419 du code civil prévoit la possibilité pour le juge des tutelles ou le conseil de famille, s'il a été constitué, d'allouer, après avoir recueilli l'avis du procureur de la République, une indemnité pour l'accomplissement d'un acte ou d'une série d'actes requis par la mesure de protection et impliquant des diligences particulièrement longues ou complexes.
Il s'agit d'une indemnité à caractère exceptionnel, mise à la charge de la personne protégée, qui s'ajoute à la rémunération perçue par le mandataire à la protection juridique des majeurs au titre du financement des mesures de protection, également prévue par l'article 419 en son deuxième alinéa, lorsque cette dernière est manifestement insuffisante.
En application des dispositions de l'article 443 du code civil, la mesure de protection prend fin au décès de la personne protégée.
Cependant, le mandataire a toujours la faculté de solliciter la prise en charge des frais qu'il a engagés au titre des actes requis par la mesure de protection impliquant des diligences particulièrement longues ou exceptionnelles qui n'auraient pas été prises en compte au titre du financement des mesures de protection prévu à l'article 419, alinéa 2, la dette devenant à son égard une dette de succession.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-7341QE.htm
Source : Club Patrimoine. Réponse ministérielle à la question n°7341 parue au JOAN du 07/05/13
Surendettement du majeur protégé et logement

Les faits :
Une personne en curatelle a saisi la commission de surendettement. Les mesures recommandées étaient en autre de vendre le bien immobilier.
Ne pouvant se résoudre à quitter son logement, assistée de son curateur, elle saisit le juge de l’exécution aux fins d’obtenir l’annulation de la recommandation, le constat de son insolvabilité et la possibilité de conserver son logement en payant chaque mois sa mensualité. Sans succès.
La procédure :
La cour d’appel approuve le premier juge d’avoir homologué les mesures recommandées par la commission (Aix, 20.01.2011).
La cour de cassation s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fonds.
Le commentaire :
Le logement du majeur protégé bénéficie d’une protection renforcée. Mais ce dogme doit-il céder lorsque le majeur est par ailleurs surendetté ? La Cour répond par l’affirmative.
En définitive, le droit du surendettement l’emporte sur le droit des majeurs protégés. L’intérêt du majeur vulnérable cède devant celui des créanciers. La cour pour fonder sa décision a déterminé la part des ressources aux dépenses courantes du ménage et la mentionner dans sa décision. Source : AJ Famille, n°4
Le logement de la personne vulnérable est un sujet très épineux en pratique. Les situations sont extrêmement variées et génèrent souvent des difficultés en pratique pour les intervenants. C’est ce qui est ressorti de l’atelier sur le patrimoine immobilier du majeur protégé de la Convention Abripargne des 20 et 21.06.2013.
Outre, les difficultés pratiques rencontrées par les intervenants tutélaires, ces derniers comme le démontre cette récente affaire se retrouvent en sus confrontée à des dispositions extérieures au champ tutélaire.
De nouvelles règles pour l’ouverture d’un Livret A
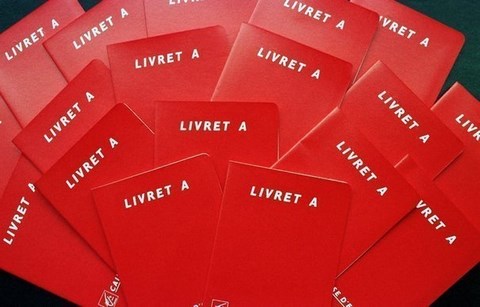
Depuis le 1er janvier 2013, toute demande d’ouverture de Livret A est soumise à validation par l’administration fiscale.
Le banquier doit vérifier que le souscripteur ne possède pas déjà un Livret A – ou un compte spécial sur livret du Crédit Mutuel (Livret Bleu) – dans un autre établissement (décret 2012-1128 du 4/10/2012).
La validation d’ouverture d’un Livret A se fait sous 48 heures via l’interrogation du fichier des comptes bancaires (Ficoba).
En l’absence de doublon, l’ouverture est validée.
Dans le cas contraire, le client (ou son représentant légal) doit renoncer à l’ouverture de ce livret, ou apporter dans les 90 jours la preuve de la clôture de l’ancien livret. Il ne peut en aucun cas s’opposer à la vérification de l’existence d’autres Livret A ou Livret Bleu à son nom, et s’expose, en cas de doublon, à l’imposition des intérêts du livret supplémentaire et à une amende fiscale égale à 2 % des sommes placées !
Il peut en revanche refuser que le fisc fournisse à la banque des informations plus précises sur ce compte surnuméraire, et notamment dans quel établissement il est détenu. Source : JeTutelle.
Lors de la Convention Abripargne des 20 et 21 Juin 2013, les échanges lors de l’atelier sur les comptes bancaires ont été riches et vifs. De nombreuses questions ont été soulevées.
La communication établissements bancaires – intervenants tutélaires est à améliorer dans l’intérêt du majeur protégé.
Les nouvelles règles applicables lors de l’ouverture d’un Livret A sont un exemple de la nécessité de communication entre les interlocuteurs : si l’information est donnée au tuteur, alors il pourra prendre les mesures utiles et en conformité avec la législation en vigueur !
Attention : règlement dès septembre des prélèvements sociaux !

La date de paiement des prélèvements sociaux avancée
Les prélèvements sociaux habituellement exigibles en novembre devront cette année être réglés dès septembre.
Sur le site du ministère des Finances , la nouvelle figure en bonne place : «Les prélèvements sociaux ne font plus l’objet d’un avis d’impôt spécifique mais sont intégrés sur un avis commun avec l’impôt sur le revenu».
Ce nouvel avis sera adressé aux contribuables entre août et septembre. Cet avis unique présentera le total du montant à payer cumulant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, le détail et le calcul de ces deux impositions étant clairement indiqués.
Conséquence directe de cette innovation : le paiement des prélèvements sociaux dus, par exemple, sur les revenus fonciers sera exigible dès le 16 septembre, au lieu de mi-novembre comme habituellement. En résumé, septembre sera un cap particulièrement difficile pour les contribuables qui ont choisi le paiement par tiers.
Bercy précise que les usagers concernés par cet avis d’impôt unique pourront payer les montants dus en utilisant les différents modes de paiement actuellement réservés à l’impôt sur le revenu : mensualisation ou paiement en deux acomptes avec solde. Ils pourront également payer directement en ligne ou opter pour le prélèvement à l’échéance.
Source : Les Echos
Attention : règlement dès septembre des prélèvements sociaux !

La date de paiement des prélèvements sociaux avancée
Les prélèvements sociaux habituellement exigibles en novembre devront cette année être réglés dès septembre.
Sur le site du ministère des Finances , la nouvelle figure en bonne place : «Les prélèvements sociaux ne font plus l’objet d’un avis d’impôt spécifique mais sont intégrés sur un avis commun avec l’impôt sur le revenu».
Ce nouvel avis sera adressé aux contribuables entre août et septembre. Cet avis unique présentera le total du montant à payer cumulant l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux, le détail et le calcul de ces deux impositions étant clairement indiqués.
Conséquence directe de cette innovation : le paiement des prélèvements sociaux dus, par exemple, sur les revenus fonciers sera exigible dès le 16 septembre, au lieu de mi-novembre comme habituellement. En résumé, septembre sera un cap particulièrement difficile pour les contribuables qui ont choisi le paiement par tiers.
Bercy précise que les usagers concernés par cet avis d’impôt unique pourront payer les montants dus en utilisant les différents modes de paiement actuellement réservés à l’impôt sur le revenu : mensualisation ou paiement en deux acomptes avec solde. Ils pourront également payer directement en ligne ou opter pour le prélèvement à l’échéance.
Source : Les Echos
Le gouvernement en faveur d'une plus large promotion du mandat de protection future

Un député interpelle le ministère de la justice concernant le manque d'informations statistiques s'agissant des personnes sous protection juridique telle qu'une tutelle.
Le parlementaire demande au Garde des sceaux si la création d'une Observatoire national de protection juridique des majeurs est envisagée par le gouvernement.
Dans une réponse ministérielle du 23 juillet 2013, la ministre déléguée aux personnes âgées et à l'autonomie indique que « le ministère des affaires sociales et de la santé et le ministère de la justice ont décidé d'engager en 2013 un travail conjoint en la matière qui examinera notamment l'opportunité de créer un système d'information commun comportant une dimension prospective ».
Le Gouvernement ajoute qu'il souhaite faire progresser les sujets suivants :
- l'information aux tuteurs familiaux,
- le développement d'études-enquêtes sur la protection juridique pour réajuster les schémas régionaux de protection juridique,
- l'unification des dispositifs en matière de plafonnement de la participation financière des personnes protégées,
- la plus large diffusion de l'information sur le mandat de protection future.
Pour voir la réponse ministérielle
Commentaire :
Cette réponse ministérielle est dans la continuité des débats qui ont eu lieu dans l’atelier sur le mandat de protection future lors de la Convention ABRIPARGNE des 20 et 21 juin dernier.
Madame MINETTI le définissait comme d’un testament de vie en s’interrogeant sur le fait qu’il n’existe pas de recueil de registre des mandats ou de publicité spécifique.
Espérons que les travaux du ministre permettent une plus connaissance de cette innovation de la loi du 05.03.2007.
Si vous souhaitez en débattre: cliquez ici pour aller sur le forum Abripargne
Successions : La renonciation des parents à l’héritage n’en prive pas les enfants
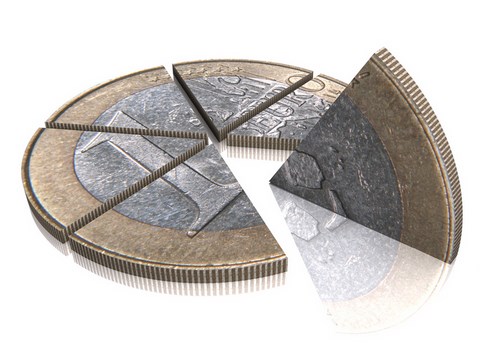
L’héritier qui renonce à la succession transmet sa part à ses descendants si la succession a été ouverte après le 1er janvier 2007.
Dans le cas contraire (succession ouverte avant 2007), la loi applicable est celle qui prévoyait la répartition de sa part entre ses cohéritiers.
C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans une affaire qui opposait une tante à ses neveux et nièces à propos de la propriété d’un bien immobilier.
Un seul des enfants (la sœur) avait accepté l’héritage de ses parents, tous les autres enfants (les frères) l’ayant refusé. Elle estimait de ce fait être seule propriétaire du terrain faisant partie de cette succession ouverte en 2004. Les enfants des frères (les neveux et nièces) le contestaient. Ils considéraient que la renonciation de leur père les avait rendus héritiers de sa part.
Or, si c’est bien ce que la loi prévoit aujourd’hui (la part de l’héritier qui renonce à la succession va à ses propres descendants) ce n’était pas le cas en 2004, date d’ouverture de la succession (la part de celui qui renonçait était alors partagée entre ses cohéritiers).
En effet ces dispositions nouvelles résultant de la loi du 23 juin 2006 s’appliquent uniquement aux successions ouvertes à partir de son entrée en vigueur (1er janvier 2007).
Voir la décision
Article 805 du code civil
source : service-public.fr
Limite absolue de la saisie des rémunérations : la fraction insaisissable est modifiée

Dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations, le créancier saisissant doit toujours laisser à la disposition du salarié une fraction de sa rémunération égale à la partie forfaitaire du RSA pour un foyer composé d'une seule personne (c. trav. art. R. 3252-5).
Suite à la revalorisation du RSA au 1er septembre 2013, ce montant est désormais de 492,90 € par mois.
Décret n°2013-793 du 30 août 2013.
Source : RF paye
La mensualisation des retraites complémentaires enfin sur les rails

Au mois d'octobre 2013, ce sera le dernier versement trimestriel des retraites complémentaires Arrco et Agirc. A partir de janvier 2014, les ex-salariés du secteur privé encaisseront chaque mois leur pension des régimes complémentaires (y compris les pensions de réversion).
Ce passage à la mensualisation se fera automatiquement : les retraités n’ont aucune démarche à effectuer, ni auprès de leur caisse de retraite, ni auprès de leur banque. Cela n’aura aucune implication sur le montant des cotisations sociales qui continueront à être prélevées à la source.
L'objectif est d'harmoniser les versements avec ceux du régime de base.
Ceux-ci sont en effet versés tous les mois, à terme échu, vers le 10 du mois suivant, alors que les pensions versées par l'Arrco et l'Agirc étaient jusqu'à présent payées d’avance tous les trimestres.
Cette mensualisation ne concernera, toutefois, que les retraités dont le compte en banque est domicilié en France, dans les collectivités d’Outre-mer et dans la plupart des pays d’Europe.
Pour les retraités dont le compte bancaire est domicilié hors-Europe, les retraites continueront à être versées trimestriellement en raison du coût des frais bancaires.
Source : Capital.Fr
De quel délai dispose-t-on pour contester un testament ?

Monsieur T. apprend que sa mère, décédée l’an passé, n’avait sans doute pas toute sa tête lorsqu’elle a rédigé son testament. Peut-il contester la succession, alors que ce document date d’il y a vingt ans ?
La réponse :
Monsieur T. est encore dans les temps pour faire valoir ses droits. L’action en nullité de testament pour insanité d’esprit obéit en effet à une prescription de cinq ans.
Assez logiquement, ce délai court à compter de la date de révélation du document, et donc du décès du testateur, et non du jour de rédaction de l’acte.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de cassation dans le cas d’un héritier qui contestait un testament attribuant toute la quotité disponible à son frère (1re chambre civile, arrêt n° 11-28.318 du 20 mars 2013). Alors que ce dernier estimait l’action prescrite, le document ayant été rédigé près de dix ans auparavant, les juges ont donné raison au premier frère, le décès de leur père ne remontant qu’à deux ans. Ainsi, la succession de sa mère datant de l’an passé, monsieur T. pourra contester la validité du testament. Même s’il lui sera sans doute difficile de démontrer l’insanité d’esprit de son auteur au moment de sa rédaction, il y a vingt ans.
Source : Capital.
Les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle sont inéligibles au conseil municipal !

En application des dispositions de l’article L230 2° du Code électoral : « Ne peuvent être conseillers municipaux : les majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ».
Dans cette affaire, l'intéressée a été élue au Conseil Municipal alors qu’elle avait été placée sous curatelle par un jugement du tribunal d'instance devenu définitif.
Le jugement de mainlevée de la curatelle n'est intervenu qu’après la date à laquelle se sont déroulées les opérations électorales dans la commune.
Décision du Conseil d’État : l'élue était donc manifestement inéligible à la date des élections municipales.
Par suite, ont été annulées les élections municipales dans la commune et, donc, l'élection du maire (CE 22 août 2007 - Élections municipales d'Anchamps).
Source : Legavox.
Le gouvernement met fin au gel du barème de l'impôt sur le revenu

Pour mémoire, ce gel, instauré par le gouvernement Fillon, devait normalement s'appliquer jusqu'au retour du déficit public en dessous du seuil de 3 % du PIB, soit jusqu'en 2013, selon les prévisions de l'époque.
En pratique, il a donc affecté l'imposition des revenus des années 2011 et 2012.
Source : Patrimoine.Com
Imposition des plus-values immobilières : les changements au 1er septembre 2013

Une instruction du ministère de l’économie et des finances précise les modalités de la réforme de l’imposition des plus-values immobilières qui sera intégrée au projet de loi de finances pour 2014.
Ces nouvelles mesures sont applicables dès le 1er septembre 2013.
Elles concernent les ventes réalisées à compter du 1er septembre 2013, à l’exclusion de celles des terrains à bâtir.
À compter de cette date, les ventes de biens immobiliers bénéficient d’une exonération totale de la plus-value au titre de l’impôt sur le revenu, au bout de 22 ans seulement au lieu de 30 ans actuellement.
L’exonération au titre des prélèvements sociaux (CSG et CRDS) va intervenir de manière progressive chaque année et sera totale (comme auparavant) au bout de 30 ans.
De plus, pour les ventes réalisées entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014, un abattement exceptionnel supplémentaire de 25 % est appliqué pour la détermination du montant imposable à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values résultant de ces ventes.
La vente de la résidence principale reste quant à elle totalement exonérée d’impôt sur la plus-value.
Source : Service public.fr
Trop d’épargne en déshérence !

C’est selon la Cour des Comptes, le montant des contrats d’assurance vie et des avoirs bancaires, en déshérence, c'est-à-dire non réclamés par les héritiers et les bénéficiaires après le décès de détenteurs.
En cause : les assureurs qui ne rechercheraient pas suffisamment les bénéficiaires des contrats d’assurance vie non réclamés, et l’ACP (leur autorité de contrôle) qui ne les sanctionne pas pour leurs défaillances ! (Source : intérêts privés)
Commentaire de JD Consultant :
Néanmoins, de nouvelles obligations risquent de peser sur ces établissements afin de limiter cette situation. Nous vous tiendrons informés des nouvelles modalités légales.
Contribution aux charges du mariage : la portée d’une clause usuelle

Quel que soit leur régime matrimonial, les époux s’obligent par le fait même du mariage à contribuer aux charges de leur vie commune, c’est-à-dire aux dépenses de la vie courante.
Faute de précision dans leur contrat, ils sont censés y participer « à proportion de leurs facultés respectives » (article 214 du code civil), ce qui les dispense d’avoir à procéder à des comptes entre eux au cours du mariage.
En cas de divorce, il est fréquent que l’un des époux cherche à contester la portée de cette règle : s’il a financé une acquisition immobilière ou des travaux dans la résidence principale, par exemple, il soutiendra que ces dépenses allaient bien au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, et que par conséquent l’autre époux doit lui en rembourser une partie.
Une décision récente de la Cour de cassation illustre ce contentieux.
Les faits :
Un couple s’était marié sous le régime de la séparation de biens et son contrat de mariage comportait une clause selon laquelle les époux ne seraient assujettis à aucun compte entre eux, les charges étant réputées avoir été réglées au jour le jour. Après le prononcé du divorce, le mari avait invoqué une créance à son profit, au titre du remboursement de l’emprunt ayant servi à financer l’acquisition, en indivision, du logement du couple et les travaux de réparation et d’aménagement de ce bien, le tout pour un montant supérieur à 140 000 €.
La procédure :
La cour d’appel de Bourges, en 2011, avait rejeté sa demande, en considérant qu’il ne s’agissait pas d’une créance, mais de sa contribution aux charges du mariage.
La Cour de cassation confirme cette analyse.
Selon elle, s’agissant du logement de la famille, le paiement des dépenses d’acquisition et d’aménagement du bien participait de l’exécution par le mari de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Pendant toute la durée de la vie commune, celui-ci avait disposé de revenus confortables, tandis que ceux de son épouse, qui avait travaillé de manière épisodique, avaient été beaucoup plus faibles et irréguliers.
Les juges ont souverainement estimé que les paiements effectués par l’époux l’avaient été en proportion de ses facultés contributives.
Source : Intérêts privés.
Pour voir la décision
Le testament d’une personne âgée au profit de son aide-ménagère est valable

Une aide-ménagère peut recevoir des dons ou legs de la personne âgée dont elle s’est occupée, même si son contrat de travail le lui interdit.
C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans une récente affaire.
Un homme décède en laissant pour lui succéder son fils.
Par testament, il avait consenti divers legs particuliers, dont un terrain à son aide-ménagère, salariée d’une association d’aide à domicile. Son fils, puis ses petits-enfants demandent l’annulation du testament.
La cour d’appel prononce la nullité du testament au motif qu’une clause du contrat de travail de l’aide-ménagère lui faisait interdiction de recevoir un don ou un legs de la personne chez qui elle travaillait.
La Cour de cassation casse l’arrêt.
Pour la Cour, aucune disposition légale n’interdit à l’aide-ménagère de recevoir des dons ou des legs. En effet, l’aide-ménagère n’entre pas dans la catégorie des personnes auxquelles la loi interdit de recevoir des dons ou legs comme les membres des professions médicales et de la pharmacie et les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle est décédée.
Par ailleurs, selon la Cour, le non-respect des obligations prévues à son contrat de travail ne peut affecter la validité du legs qui lui a été consenti.
Cette solution donnée par la Cour de cassation n’exclut pas qu’un tel testament serait susceptible d’être annulé si l’état mental du testateur l’empêchait de tester valablement.
Pour voir l’arrêt
Source : service-public.fr
Découverts bancaires : plafonnement des commissions d'intervention

Un décret paru samedi au Journal officiel confirme les montants des plafonds annoncés lors des débats parlementaires, à savoir :
- 8 € par opération
- et 80 € par mois.
La loi prévoit également des plafonds réduits pour les personnes qui bénéficient des services bancaires de base ou qui ont souscrit à une offre bancaire spécifique réservée aux personnes se trouvant en situation de fragilité eu égard au montant de leurs ressources, plafonds fixés à 4 € par opération et à 20 € par mois. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Source : Patrimoine.com
Qu’est-ce que le justificatif d’impôt sur le revenu ?

Pour justifier de vos revenus auprès de certains organismes sans avoir à fournir un avis d’impôt complet, vous pouvez dorénavant utiliser un document simplifié, le « justificatif d’impôt sur le revenu ».
Ce document reprend uniquement les données principales de l’avis d’impôt sur le revenu nécessaires aux organismes pour traiter les demandes de leurs usagers.
Ce document est disponible en ligne, à partir de votre espace fiscal, même si vous n’avez pas opté pour la dématérialisation de votre avis d’impôt papier. Vous pouvez également l’obtenir auprès de votre centre des finances publiques, en présentant votre avis d’impôt papier et une pièce d’identité.
Pour en savoir plus : Le justificatif d’impôt sur le revenu
Source : Service-public.fr
Le critère jurisprudentiel du libre choix, par le majeur protégé, de son lieu de résidence

Le choix de la résidence du majeur protégé est une décision qui lui appartient personnellement.
Le juge des tutelles n’a pas à autoriser le retour à domicile dès lors qu’une personne en curatelle manifeste le choix réel et stable, en rapport avec ses revenus et son état de santé.
Le curateur ne peut s’y opposer que s’il soulève des difficultés réelles et sérieuses, ce que n’est pas le risque d’une rechute de consommation massive d’alcool.
Une décision de la cour d’appel de Douai en a fait une récente manifestation.
Les faits :
Agée de 60 ans, Mme X. a été hospitalisée à la suite d’une absorption massive d’alcool. A la demande du parquet, elle a été examinée par un médecin expert qui conclut à une détérioration de ses facultés mentales consécutive à cette absorption en février 2010.
Un juge a alors placée Mme X. sous curatelle en septembre 2010 en désignant une association tutélaire.
Par requête en février 2012, Mme X. demande l’autorisation au juge de quitter le foyer où elle réside pour aller vivre dans une maison individuelle dont elle est propriétaire en indivision avec sa mère. La maison est vacante.
Le curateur est opposé à ce projet et s’oppose à la requête, faisant valoir que Mme X. n’est pas, eu égard à ses précédentes expériences apte à vivre seule. Sa thèse est complétée d’un certificat médical confirmant sa faiblesse de caractère précisant en outre que son état de santé n’est pas compatible avec une orientation dans un logement individuel et exige une structure plus « contenante » pour éviter toute déviance et mise en danger de la patiente.
La procédure :
Le juge des tutelles rejette la demande de Mme X. en dépit de sa forte volonté au motif que la demande de Mme X. est prématurée car elle n’a pas démontré son aptitude à l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne.
Mme X. fait appel de la décision.
La cour d’appel de Douai dans un arrêt ne date du 08 février 2013, a infirmé l’ordonnance du juge des tutelles.
Sa motivation est rigoureuse : « une telle approche, si elle peut paraître légitime de la part du curateur et du médecin au regard du passé de Mme X. (…) ne permet pas, en l’absence de toute difficulté effectivement constatée et avérée, de porter atteinte au droit de la personne protégée de choisir son lieu de vie, sauf à instaurer un régime d’autorisation préalable du juge de toute situation de retour à domicile présentant un risque potentiel pour la santé de la personne protégée ; or, tel, n’est ni l’esprit, ni la lettre de la loi ».
Commentaires de M. Gilles RAOUL-CORMEIL :
La volonté du majeur est le 1er élément à prendre en compte (cf. art.459-2 c.civ.).
Si le juge estime que le majeur protégé est apte à exprimer un choix réel et stable, alors il faut respecter sa volonté. Ce qui était le cas en l’espèce.
Pour lever l’objection médicale très alarmiste sur la situation, la cour a jugé que la position du médecin, comme celle du curateur, relevait d’un « principe de précaution » dont l’application aboutirait à des conséquences extrêmes en matière de protection des personnes.
2ne point à vérifier :
Le logement doit être habitable, décent et adapté à l’état de santé de la personne protégée, mais aussi présenter un coût en rapport avec ses biens. Le choix du logement éprouve évidemment les ressources financières du majeur protégé.
Les juges ne peuvent ignorer le volet patrimonial de cette décision.
Le choix de Mme X. était moins couteux que de rester en foyer.
Mais comme le précisent Mesdames PETERKA et CARON-DEGLISE, « un coût estimé excessif ne pourra à lui seul constituer une limite à la conservation du logement ».
Source : AJ Famille.n°4. avril 2013. CA Douai, Ch. Protection juridique des mineurs et des majeurs, 08.02.13, RG n°12/06650
Perte du bénéfice de la mensualisation de l’impôt : A quel moment ?

Comment çà marche concrètement ?
Le 1er rejet du prélèvement du Fisc (pour insuffisance de provision) entraîne un report de prélèvement sur le mois suivant.
Cependant, dès le deuxième incident de paiement, le contribuable perd pour l’année le bénéfice de la mensualisation.
Pensez donc à bien vérifier que le compte des majeurs protégés que vous suivez soient bien approvisionnés !
Source : Mieux vivre
Plafonnement de la récupération sur succession de l'APSA (Allocation de solidarité aux personnes âgées)

La ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille rappelle tout d'abord que l'ASPA est versée à toute personne dont les ressources annuelles sont inférieures à 9 447 euros.
Elle indique de plus : "Vous l'avez mentionné, monsieur le sénateur, les ressources sont également prises en compte après le décès de l'allocataire. Ainsi, si le montant de la succession est supérieur à 39 000 euros, la puissance publique récupère sur celle-ci un montant maximal de 6 087 euros.".
Source : Club Patrimoine. Réponse ministérielle à la question n°0376S parue au JO du Sénat du 16/10/13
Pour voir la réponse, clic ici
Publication du guide ARS-DRJSCS-Justice d’accompagnement des majeurs protégés en établissements et services sanitaires et médico-sociaux
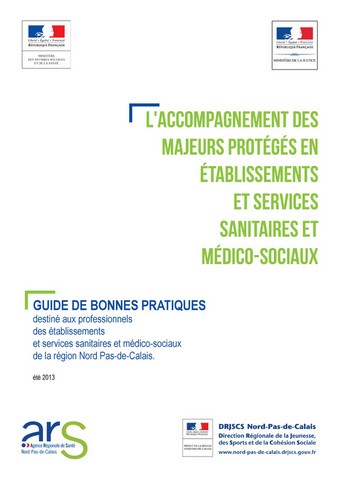
Suite à la concrétisation d’un partenariat entre la DRJSCS du Nord Pas de Calais et l’Agence régionale de Santé, dans le cadre de leur plan d’action, a abouti à la création d’un outil d’information destiné à l’ensemble des professionnels du secteur sanitaire et médico-social :
« Guide d’accompagnement des majeurs protégés en établissements et services sanitaires et médico-sociaux »
En effet, une enquête menée en 2012 par l’ARS NPDC auprès des établissements et services médico-sociaux sur les besoins des professionnels de la région Nord Pas de Calais, a démontré que 50 à 70% des personnels (soignant, encadrement, éducateur…) souhaitaient une information plus précise et pratique sur la protection juridique des majeurs.
L’ensemble des partenaires (Justice, MJPM…) ont été sollicités pour l’écriture du document. Le guide a fait l’objet d’une validation par la Cour d’Appel de Douai et bénéficie ainsi d’une labellisation par le Ministère de la Justice.
« Le guide d’accompagnement des majeurs protégés en établissements et services sanitaires et médico-sociaux » contient des éléments sur la fonction de mandataire judiciaire et sur les mesures de protection judiciaires. Il propose aussi des grilles de situation pour mieux comprendre le droit et les obligations concernant la prise en charge des majeurs sous tutelle ou curatelle.
Source : DRJSCS Nord Pas de Calais
Pour le télécharger clic ici